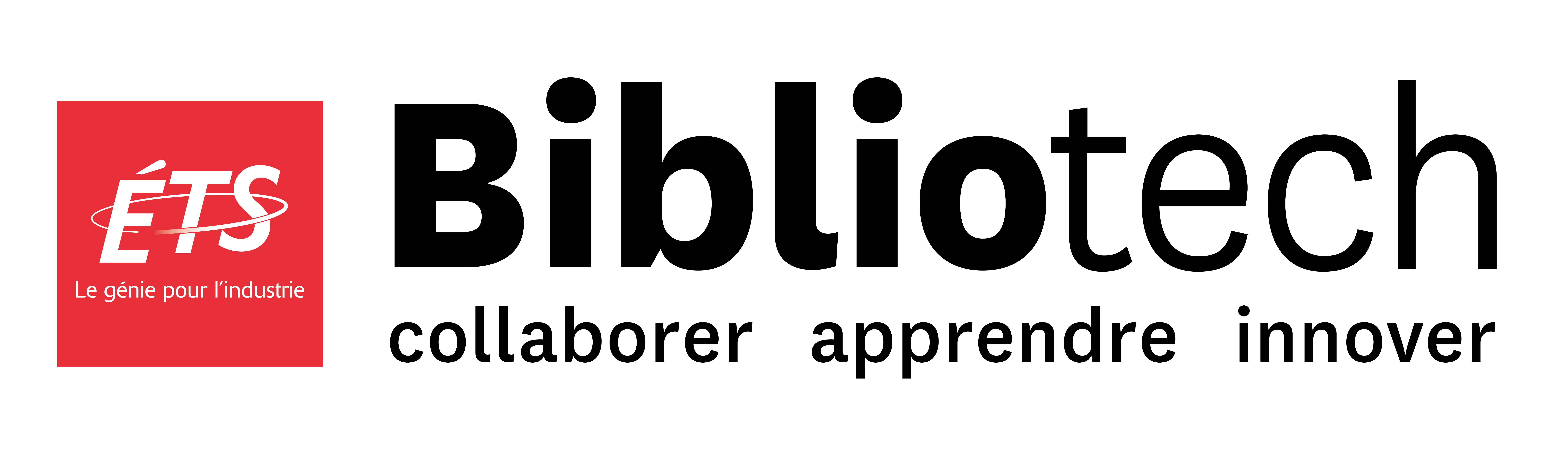8. La vie de biologiste – Unité 1
Entrevue avec Dr. Michelle Tseng
Le thème de cette unité est « Causes et conséquences de la variation phénotypique ». J’ai fait cette entrevue avec la Dr. Michelle Tseng, professeure aux départements de Zoologie et de Botanique à University of British Columbia, afin d’illustrer le thème de cette unité. En effet, les travaux de son groupe de recherche combinent l’évolution, l’écologie et la physiologie afin d’étudier la réponse des organismes aux changements climatiques.
La vidéo est sous-titrée en anglais et en français.
Aubin-Horth, N. (2023). Écophysiologie évolutive: Dr. Michelle Tseng. [Vidéo]. Youtube. CC-BY. https://youtu.be/BvbEYpD31Nc?si=PtQjjm2Er0cGDJ4_
Transcription de l’entrevue
Vous pouvez cliquer ce lien pour accéder à la transcription. Transcription Tseng en format word