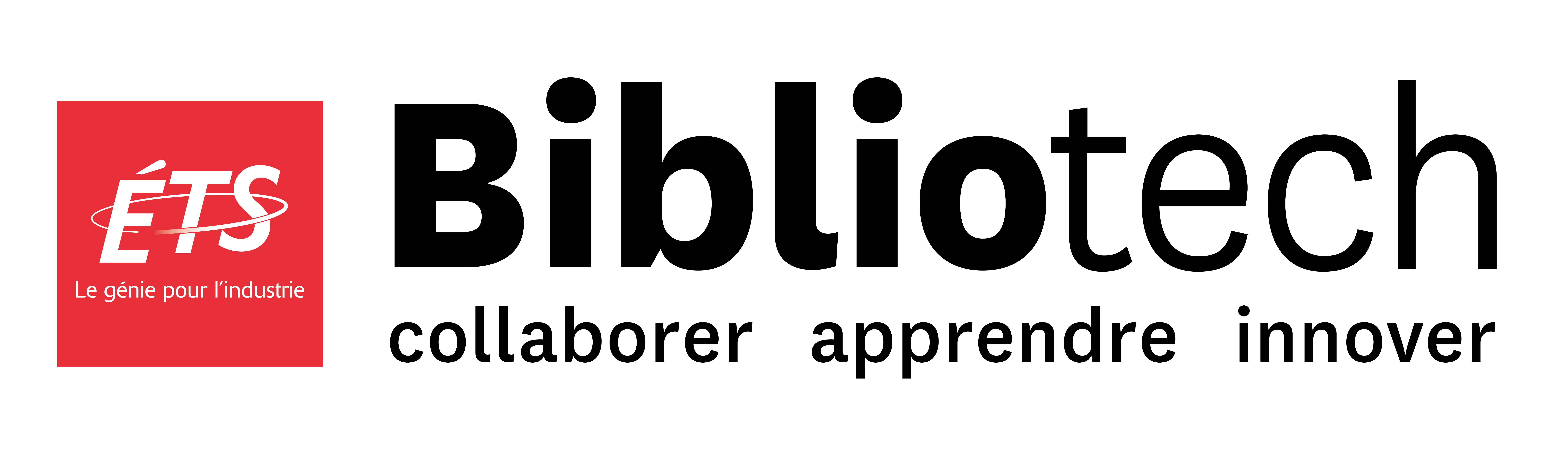3.5 Projets transversaux
3.5.1 Métabolisme urbain du secteur de la construction de Montréal
Une étude initiée par Claudiane Ouellet- Plamondon (prof.), Annie Levasseur (prof.), Marie Vigier (étudiante), Thomas Elliot (postdoctorant) de l’ÉTS en collaboration avec la Ville de Montréal a été menée pour évaluer l’impact environnemental du secteur de la construction et analyser le métabolisme urbain montréalais. Cette étude s’intéresse au secteur de la construction à Montréal qui, comme dans d’autres villes, joue un rôle prépondérant dans la consommation de ressources.
L’analyse du métabolisme urbain liée au secteur de la construction représente un outil de mesure complet et dynamique pour accompagner les décideurs urbains dans l’élaboration de plans d’action d’économie circulaire dans le domaine de la construction. Cet outil intègre les flux entrants et sortants de la ville conjointement à l’évaluation des indicateurs d’impacts environnementaux tels que l’empreinte hydrique, écologique et carbone. Cette approche permet de quantifier les matériaux consommés par le secteur, d’évaluer leur circularité et les impacts environnementaux associés, tout en visualisant leur évolution dans le temps. Par le biais de différents scénarios modélisés, il est alors possible d’identifier les pratiques les plus efficaces pour réduire l’impact environnemental du secteur de la construction. Ce dernier point est d’ailleurs le fondement de l’objectif général du présent projet de recherche.
Celui-ci comporte également quatre objectifs précis :
- quantifier les flux de matériaux de construction à Montréal sur une période d’un an,
- quantifier les impacts environnementaux générés par ces flux en regard de différents indicateurs et d’une ACV,
- analyser le lien entre impacts environnementaux et circularité, et
- déterminer le potentiel de mitigation environnementale de certaines stratégies circulaires.
L’équipe de recherche a développé au préalable un modèle de métabolisme urbain dynamique et prospectif puis l’a appliqué au secteur de la construction de la Ville de Montréal (voir Figure 27[1]). Le manque de disponibilité des données concernant les flux de matériaux et la difficulté à adapter des données nationales à l’échelle locale de Montréal ont été un des enjeux majeurs dans la réalisation du projet.
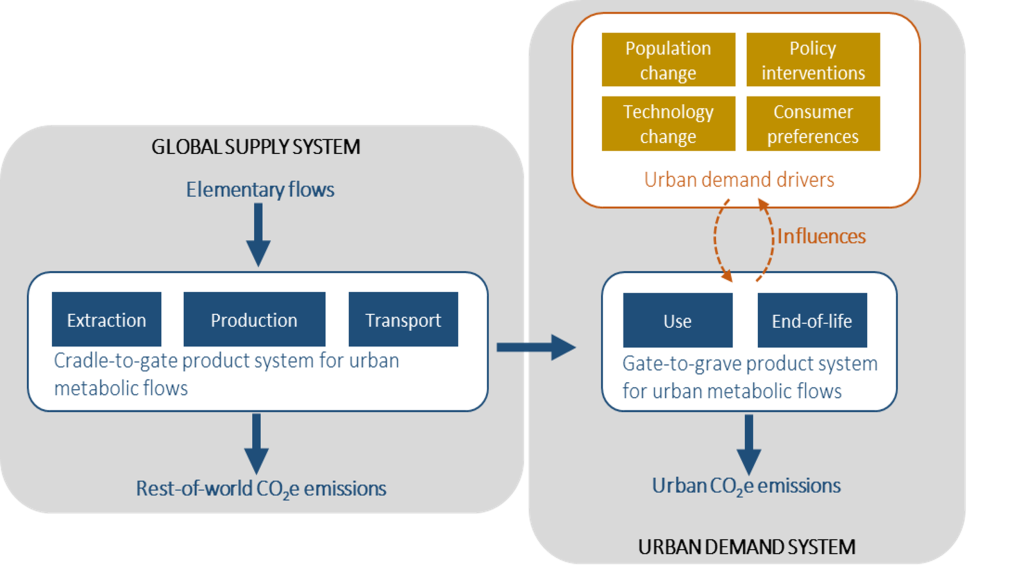
Le projet a tout de même pu mettre en exergue plusieurs constats :
- L’augmentation de l’indice de circularité des matériaux de construction entraîne des réductions d’impacts environnementaux qui peuvent se manifester en dehors du territoire où les matériaux sont utilisés ;
- Les impacts varient en fonction des lieux de production et d’utilisation des matériaux.
Toutefois, une approche équilibrée et contextualisée, voire systémique, est nécessaire pour éviter des augmentations d’impacts environnementaux localement. De plus, il convient de souligner que même avec un indice de circularité très élevé, une forte demande en matériaux vierges peut subsister en raison de la croissance future, ce qui met en évidence la complexité des interactions entre circularité et croissance économique.
En conclusion, le projet a démontré la pertinence du modèle de métabolisme urbain dynamique et prospectif pour étudier l’impact de stratégies circulaires sur des indicateurs d’impact environnemental (empreinte hydrique, écologique, carbone…) de la région de Montréal. Le scénario d’augmentation de la circularité des flux du secteur de la construction a également mis en lumière des bénéfices importants pour toutes les catégories d’impacts par rapport au scénariocroissance économique traditionnel. Dans une perspective de pérennisation et de déploiement du modèle à d’autres municipalités, les futures recherches devront affiner les données de flux de matière à l’échelle des municipalités et décomposer les chaînes de valeur des matériaux.
Consulter le projet et les livrables via : https://constructioncirculaire.com/projet/metabolisme-urbain-du-secteur-de-la-construction-de-montreal/
3.5.2 Pouvoirs municipaux et circularité
Le projet, mené par Cain Lamarre, en partenariat avec Ismaël Ouatara et Marc-J Olivier (prof.) du Centre universitaire de formation en environnement et développement durable (CUFE) de l’Université de Sherbrooke et du Centre de Transfert technologique en Écologie Industrielle (CTTEI), en collaboration avec Fanny Tremblay-Racicot de l’École nationale d’administration publique (ENAP), vise à identifier les défis et opportunités pour accroître la circularité des matériaux de CRD grâce aux pouvoirs municipaux. L’équipe a consulté huit municipalités impliquées dans le projet Villes et régions circulaires, une initiative du National Zero Waste Council, de la Fédération canadienne des municipalités, du Recycling Council of Alberta et de RECYC-QUÉBEC[2]. pour prioriser et travailler sur des pistes d’action concrète favorisant la circularité à l’échelle municipale. À l’issue de cette analyse, une liste d’actions a été proposée pour que les municipalités puissent, dans le cadre réglementaire actuel, favoriser l’économie circulaire.
Bien que les municipalités possèdent des outils de gestion des résidus de CRD, les incitatifs financiers et réglementaires visant à réduire la quantité de déchets à la source sont peu déployés. Le secteur bénéficierait de normes réglementaires et d’incitatifs pour promouvoir l’économie circulaire.
Le projet s’inscrit dans le cadre juridique applicable aux municipalités québécoises et permet donc de proposer des solutions concrètes, applicables dès maintenant, favorisant l’économie circulaire dans le secteur CRD, notamment par l’adoption de règlements ou la mise en place d’incitatifs. Afin d’aboutir à des actions concrètes et réalisables dans le cadre réglementaire actuel et répondant aux besoins des municipalités, le projet s’est déroulé en trois étapes.
Lors de la première étape, une analyse des interventions existantes au Québec a été menée. Cette étape a abouti à un sommaire de mesures réglementaires. L’analyse se base sur la réglementation et la législation québécoises, ainsi que sur les règlements adoptés par certaines municipalités québécoises et hors Québec. Les résultats montrent que les municipalités ont divers pouvoirs pour favoriser la circularité des matériaux dans le secteur des CRD, notamment par des dispositions réglementaires, des mesures incitatives et des mesures d’écofiscalité. Elles ont des compétences en aménagement et urbanisme, incluant la régulation de la construction, de l’entretien et de la démolition des bâtiments, et peuvent adopter des règlements flexibles (usages conditionnels). Elles peuvent aussi accorder des aides financières pour la revitalisation de milieux existants, avec des programmes de rénovation. De plus, les municipalités gèrent les matières résiduelles via des plans de gestion des matières résiduelles (PGMR), qui orientent les initiatives locales. Bien que les lois québécoises et les règlements municipaux n’intègrent pas explicitement la terminologie de l’économie circulaire, des mesures favorisant la circularité existent, telles que l’incitation à utiliser des matériaux de réemploi, recyclés ou écoresponsables, à favoriser les rénovations, à intensifier l’usage des bâtiments municipaux, à favoriser les partenariats avec des entreprises d’économie sociale, à encadrer les démolitions, à valoriser les résidus CRD, et à établir des partenariats et élaborer une liste d’actions pour les villes. Ainsi, malgré l’absence de l’économie circulaire dans le droit, une variété d’outils est à disposition des municipalités pour évoluer vers un modèle d’économie circulaire dans le secteur des CRD.
La seconde étape du projet de recherche concerne une enquête par questionnaire et entrevues avec six villes participantes, identifiées lors de la première édition de Villes et Régions circulaires . Le questionnaire aborde :
- les réalités réglementaires et les mesures d’encadrement appliquées,
- les initiatives municipales et les projets pilotes en cours, achevés ou prévus,
- les leviers de chaque ville et les défis rencontrés dans leur exécution.
Les entrevues ont révélé que plusieurs actions et initiatives sont encore au stade de planification. Ces deux méthodes de recherches réalisées successivement ont permis de mettre en lumière plusieurs constats, dont le manque d’usage des leviers d’action existants, la prédominance des pratiques de démolition sur celles de déconstruction et le manque de mesures incitatives ou dissuasives pour améliorer la gestion des résidus de CRD.
Les villes participantes rencontrent plusieurs obstacles dans la réduction et la gestion des résidus tels que :
- la volonté politique insuffisante,
- le tri à la source difficile,
- le manque de débouchés locaux,
- des défis économiques pour les entreprises et promoteurs,
- le manque de ressources pour les inspections,
- la démolition prédominante et,
- la dépendance sur les initiatives environnementales citoyennes.
Enfin, la troisième étape du projet s’est matérialisée par un atelier participatif en vue d’élaborer une liste d’actions pour les villes. Lors de cet atelier, trois actions principales ont été travaillées par les villes. Elles concernent :
- l’institutionnalisation de la déconstruction des bâtiments municipaux,
- l’obligation de dépôt de frais de gestion des déchets remboursables selon le taux de récupération et
- l’imposition de taux de récupération lors de la déconstruction.
Ces actions permettent d’identifier les bénéfices, les alignements avec les politiques publiques et les barrières à lever pour leur mise en œuvre.
À l’issue de ce travail, quatre catégories d’actions prioritaires sont identifiées (chacune contenant de trois à sept actions) :
- utiliser le permis de construction et de démolition comme levier de circularité,
- décourager l’enfouissement,
- favoriser la déconstruction et le tri sur chantier, et
- allonger la durée de vie des bâtiments.
Consulter le projet et les livrables via : https://constructioncirculaire.com/projet/pouvoirs-municipaux-et-circularite/
3.5.3 Économie circulaire à l’échelle d’un quartier
L’étude a examiné les stratégies d’économie circulaire applicables au développement urbain dans le secteur de Lachine, LaSalle et Ville Saint-Pierre à Montréal. Elle a été menée par une équipe interdisciplinaire constituée de Claudiane Ouellet-Plamondon (prof.) de l’École de technologie supérieure, Daniel Pearl (prof.) de l’Université de Montréal, Cécile Bulle (prof.) et Camille Chabas (étudiante au doctorat) de l’Université du Québec à Montréal, ainsi que leurs étudiants. Elle s’inscrit dans une volonté de promouvoir des pratiques durables mises en œuvre à l’échelle d’un territoire pour répondre aux enjeux climatiques et de rendre ce secteur plus résilient. Les stratégies innovantes et durables proposées, ainsi que la quantification des bénéfices environnementaux associés, peuvent effectivement aider les villes à atteindre leurs objectifs de réduction des émissions de gaz à effet de serre.
L’objectif général est de concevoir un projet pilote d’aménagement du territoire basé sur les principes de l’économie circulaire et de la durabilité. Pour ce faire, trois actions majeures ont été mises en avant :
- une analyse du contexte actuel,
- la proposition de stratégies innovantes de développement, et
- l’évaluation de la performance environnementale des stratégies proposées.
Pour y parvenir, le projet a été réalisé en partenariat avec trois départements de recherche et divers acteurs de terrain. Une analyse écosystémique urbaine et une étude du cadre bâti ont été réalisées, soutenues par une perspective d’ACV.
Dans un premier temps, un portrait global du quartier a été réalisé par des étudiants et étudiantes en architecture de l’Université de Montréal. Cette analyse a mis en lumière des éléments essentiels pour contextualiser les stratégies proposées tout en se concentrant sur des bâtiments emblématiques du canal de Lachine tels que la grue LaSalle-Coke, la Dominion Car & Foundry et le pont Gauron-Lafleur. Parallèlement à l’analyse du patrimoine bâti, l’équipe a aussi étudié les infrastructures vertes, la biodiversité et le potentiel de développement durable, comme le montre les exemples de stratégies présentés en figure 28. Les résultats des analyses ont permis de souligner d’une part le manque de résilience et de protection de la biodiversité sur les trois territoires à l’étude, et d’autre part le manque d’investissements majeurs dans les infrastructures. Ce faisant, la zone entre Lachine et LaSalle est en phase de devenir une friche industrielle. Cette zone commerciale et industrielle monofonctionnelle offre ainsi une opportunité d’imaginer et de construire un quartier plus vert et résilient.
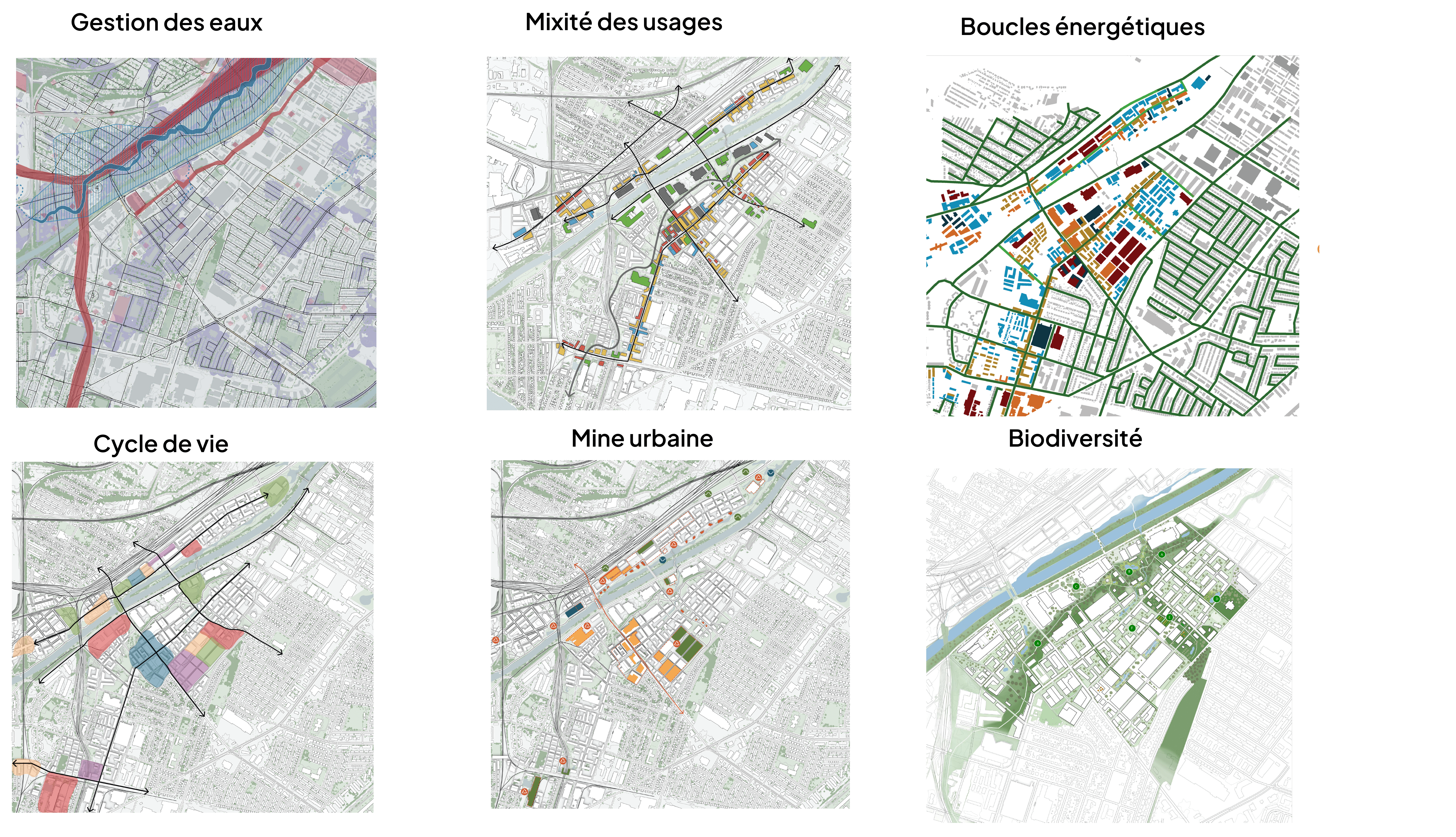
À l’issue de l’analyse, le projet a émis plusieurs propositions stratégiques de développement pour le territoire. L’équipe de projet a notamment proposé de concevoir un quartier expérimental où le canal servirait de levier pour introduire un nouveau tissu urbain diversifié, sécuritaire et résilient. Considérant le territoire comme une série de lieux imbriqués et interconnectés, le projet s’est concentré sur la métamorphose des friches bordant le canal, tout en tenant compte des patrimoines bâtis et naturels, des infrastructures vertes et de l’économie circulaire. Cette transformation a le potentiel d’enclencher un processus régénérateur sur les sites d’intervention et leurs quartiers environnants.
Pour chacun des trois territoires étudiés, sept stratégies ont été proposées et analysées :
- identifier des avantages d’un changement de zonage,
- présenter des stratégies inspirées des principes de l’économie circulaire pour le patrimoine bâti, le système alimentaire, les infrastructures vertes et le transport actif,
- améliorer les infrastructures vertes,
- dimensionner des bassins de biorétention pour un des territoires à l’étude,
- mettre de l’avant des réflexions sur la résilience de la zone,
- analyser des composantes telles que des chaussées ou des bâtiments à renforcer ou remplacer selon les règles de l’ingénierie et
- intégrer la résilience face aux changements climatiques.
Il convient de souligner que deux doctorants du CIRAIG qui sont experts en ACV ont contribué à l’analyse de la performance environnementale des stratégies proposées, cela à différentes étapes pour identifier les éléments des scénarios qui pourraient entraîner des déplacements d’impacts environnementaux.
Consulter le projet et les livrables via : https://constructioncirculaire.com/projet/economie-circulaire-a-lechelle-dun-quartier/
Lire la suite : IV. Les leviers à activer pour faciliter la transition vers plus de circularité
- Elliot, D., & Levasseur, A. (2022). System dynamics life cycle-based carbon model for consumption changes in urban metabolism. Ecological Modelling, 456, 109714. https://doi.org/10.1016/j.ecolmodel.2022.109714 ↵
- National Zero Waste Council, Fédération canadienne des municipalités, Recycling Council of Alberta, & RECYC-QUÉBEC. (n.d.). Villes et régions circulaires. https://canadiancircularcities.ca/ ↵
Ensemble des transformations et des flux de matières et d'énergie qui résultent des activités industrielles et socioéconomiques ayant lieu au sein d'un milieu urbain.
Analyse du cycle de vie : analyse visant à déterminer et à mesurer les impacts environnementaux, les conséquences sociales ou les coûts d'un produit ou d'un procédé tout au long de son cycle de vie.
Ensemble des moyens qui peuvent être mis en place pour progresser vers l’économie circulaire.
Mesure de la quantité de ressources provenant de matières circulant en boucle dans un système économique défini, pour une période donnée, par rapport à la quantité totale de ressources utilisées dans ce système, pendant cette même période.
Augmentation sur une longue période du produit intérieur brut d'un pays exprimé en monnaie constante.
Construction, Rénovation, Démolition. Par extension, le sigle CRD désigne les matières résiduelles issues des activités de Construction, Rénovation, Démolition.
Résidus, substances ou objets qui sont abandonnés ou destinés à l'abandon, et qui sont susceptibles d'être valorisés.
Système de production, d’échange et de consommation visant à optimiser l’utilisation des ressources à toutes les étapes du cycle de vie d’un bien ou d’un service, dans une logique circulaire, tout en réduisant l’empreinte environnementale et en contribuant au bien-être des individus et des collectivités.
Démantèlement sélectif d'un bâtiment ou d'un ouvrage, effectué de manière à récupérer certains de ses éléments constitutifs en vue de leur remploi ou de leur recyclage.
Rapport entre la quantité de résidus récupérée et la quantité de résidus générée.
Dépôt définitif de matières résiduelles sur ou dans le sol.
Développement qui répond aux besoins du présent sans compromettre la capacité des générations futures à répondre aux leurs en s'appuyant sur une vision à long terme qui prend en compte le caractère indissociable des dimensions environnementale, sociale et économique des activités de développement.
Centre international de référence sur l'analyse du cycle de vie et la transition durable.
Le fait de transférer des impacts environnementaux d'une étape du cycle de vie à l'autre ou d'un critère d'impact à l'autre.