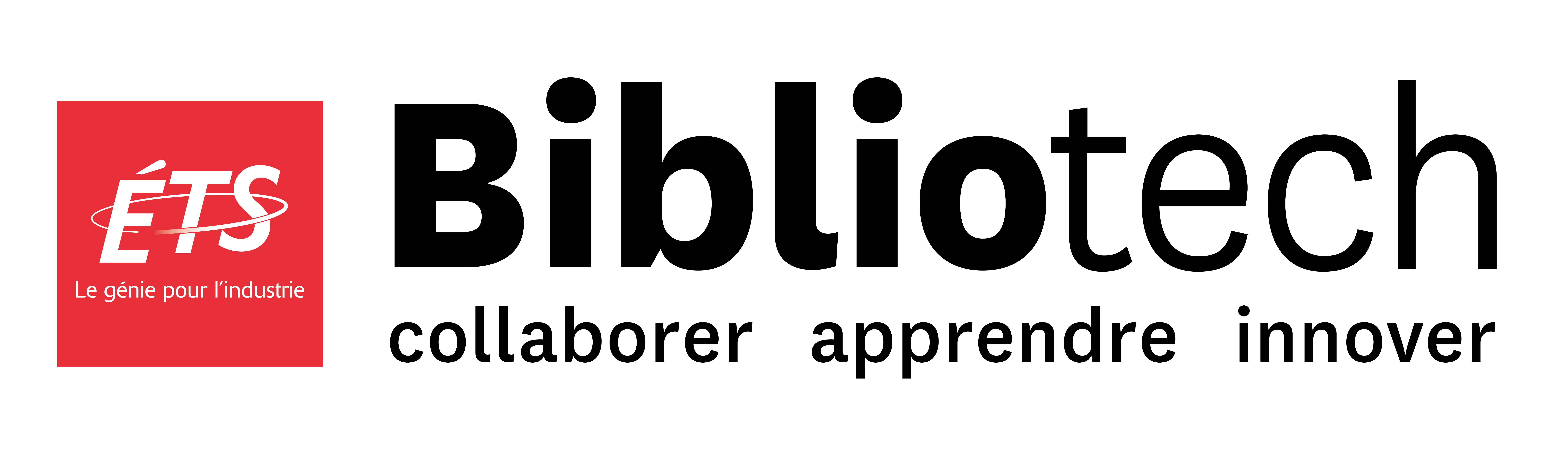Introduction
0.1 Pourquoi parler d’engagement social?
Loin d’être en marge de la société, l’engagement social joue un rôle primordial au cœur de celle-ci. Que seraient nos collectivités sans les organismes à but non lucratif et les organismes de bienfaisance? Le secteur de l’action communautaire et de l’économie sociale regroupe 18 643 organisations (incluant les coopératives) qui emploient un total de 438 931 personnes (Binhas, 2023, p.6). Que seraient ces dernières sans leurs bénévoles? On estime d’ailleurs que les bénévoles ont consacré au Canada « environ 5 milliards d’heures à des activités bénévoles, un nombre d’heures qui équivaut à plus de 2,5 millions d’emplois à temps plein à l’année » (Hahmann, 2021, p.5). Que ferait-on sans l’argent donné à Centraide Québec et Chaudière-Appalaches pour qu’elle puisse appuyer les organismes communautaires de son territoire?
Non seulement l’engagement social est essentiel à nos collectivités, mais les besoins auxquels il répond sont en croissance. Nos sociétés sont confrontées à des crises politiques, sociales, économiques, sanitaires, démographiques et environnementales, allant de la crise de la confiance à l’égard du domaine politique, aux inégalités sociales en passant bien sûr par la crise climatique. S’ajoutent à celles-ci les problèmes sociétaux complexes qui font interagir les systèmes politiques, sociaux, économiques et écologiques. Les solutions à ces crises et à ces problèmes ne peuvent reposer que sur la responsabilité des gouvernements et appellent aux actions individuelles et collectives.
0.2 Réflexions étymologiques
Pourquoi utiliser l’expression « engagement social », plutôt qu’une autre? Tout d’abord, certains concepts apparentés à celui d’engagement social auraient pu être utilisés, mais n’ont pas été retenus. La philanthropie est un de ceux-là. Bien que cela soit intéressant d’un point de vue étymologique (phílos « ami »/« aimer » et ánthrôpos « humain »/« genre humain »), la philanthropie est historiquement et culturellement trop associée au don monétaire des mieux nantis. La charité est pour sa part dirigée vers les pauvres alors qu’il est intéressant de cibler un plus vaste éventail de causes.
Le choix du mot « engagement » n’est pas accidentel. Parmi les sens étymologiques que lui donne Le Robert (2025), on retrouve le fait d’être engagé dans quelque chose et l’action d’engager et de commencer une action. Le verbe « engager » peut référer au fait de « faire entrer » et à l’action de « mettre (qqn) dans une situation qui crée des responsabilités et implique certains choix » (Le Robert, 2025). Le choix du mot « engagement » reflète une volonté de s’investir dans l’action et d’aller plus loin que l’intention.
Pourquoi utiliser l’adjectif « social » plutôt qu’un autre adjectif? Il aurait effectivement été possible d’utiliser les expressions engagement citoyen, engagement civique, engagement organisationnel (ou au travail), engagement communautaire, engagement climatique, engagement environnemental, etc. Le mot « social » a été retenu puisqu’il se rapporte aux liens que des individus (au sens très large d’« êtres organisés vivant une existence propre » et pouvant donc également désigner des individus non humains) établissent et entretiennent entre eux au sein d’un écosystème. Il est à noter que l’adjectif « social » renvoie à la nature de l’engagement (c.-à-d., des liens) plutôt qu’à l’objet de l’engagement (p. ex. : l’organisation, la cité, la communauté, l’environnement). Des individus seuls ou en groupe établissent et entretiennent des liens avec d’autres individus (leurs proches, leur communauté, l’humanité, ou l’ensemble du vivant).
L’expression « engagement social » permet de couvrir un éventail de situations : le père de famille qui est bénévole pour l’équipe de soccer de sa fille, un auteur célèbre qui prête sa plume pour défendre une cause, la professeure qui entreprend un projet de recherche participative avec des groupes de femmes immigrantes, la diplômée qui fait un don planifié à son alma mater, un groupe étudiant qui démarre une association étudiante, la comptable agréée qui partage ses compétences avec un organisme communautaire, un citoyen qui dépose ses vêtements usagés à la ressourcerie de sa ville, la retraitée qui donne son sang à Héma-Québec, etc.
0.3 Notre définition de l’engagement social
La définition de l’engagement social, telle que construite par la Chaire de leadership en enseignement sur l’engagement social, a été structurée en suivant la méthode proposée par Sinek (2015). La réflexion derrière la définition provient d’une suite de questions en cascade qui commence avec le pourquoi, enchaîne avec le pour qui, suivie du comment, du qui et ensuite du quoi.
L’engagement social renvoie ainsi à un ensemble de gestes volontaires et concrets par lequel une personne, un groupe ou une organisation consacre, entre autres choses, une partie de son temps, de son expertise, de son argent, de ses biens ou de sa notoriété à une cause conforme à ses valeurs et aspirations, afin de contribuer au mieux-être de ses proches, d’une communauté, de l’humanité ou plus largement de la vie sur Terre.
Pourquoi s’engage-t-on? Afin de soutenir des causes, des valeurs et des aspirations. Souvent associée à un problème (ou un enjeu ou un défi) social, une cause est un ensemble d’intérêts que l’on soutient ou que l’on défend en faveur d’une personne, d’une communauté ou de la société dans son ensemble. Une valeur est un principe qui guide l’action. Une aspiration est un élan qui mène vers un idéal, vers un but ultime.
Pour qui ou pour quoi s’engage-t-on? Afin de contribuer au mieux-être de ses proches, d’une communauté, de l’humanité ou plus largement de la vie sur Terre. Le mieux-être, comme son nom l’indique, vise l’amélioration du bien-être, ce qui implique dans certains cas une guérison, une cicatrisation, mais dans d’autres cas, un progrès ou une transformation. Souvent, la cause pour laquelle une personne décide de s’engager la touche directement ou touche ses proches (qu’il y ait un lien familial ou non). L’engagement peut également se faire auprès d’une communauté à laquelle une personne appartient ou non, dont les membres se reconnaissent comme faisant partie d’un même ensemble (ex. : communauté culturelle) ou non (personnes atteintes d’une même maladie). Certaines personnes ciblent un niveau encore plus large en s’engageant dans des causes universelles visant l’ensemble de l’humanité (ex. : les droits de la personne) ou la vie sur Terre (ex. : les causes environnementales). Comme nous le verrons dans ce manuel, cette quête du mieux-être collectif ne s’inscrit pas pour autant dans une logique de sacrifice. Il importe de promouvoir l’importance de la bienveillance à l’égard des personnes engagées, trop souvent à risque de surmenage. En contrepartie, il est également pertinent de valoriser les bienfaits de l’engagement social, comme l’approfondissement des savoirs, du savoir-faire, du savoir-être, du savoir-agir ou du savoir-apprendre, ainsi que les effets sur la santé physique, mentale ou sociale. À cet effet, ce manuel met de l’avant l’engagement social en tant que saine habitude de vie.
Comment s’engage-t-on? En consacrant, entre autres choses, une partie de son temps, de son expertise, de son argent, de ses biens ou de sa notoriété. Sans se restreindre à celui-ci, le temps réfère notamment au bénévolat. Lorsqu’une expertise particulière est consacrée au bénévolat, on parle d’un bénévolat de compétences. L’engagement peut se concrétiser de façon monétaire à travers le don d’argent. Il est également possible de céder une pléiade de biens, allant du don de vêtements au don de sang en passant par le don de mobilier. D’autres personnes ont la capacité de s’engager à travers leur notoriété, c’est notamment le cas des artistes et des athlètes.
Qui s’engage? Des personnes, des groupes et des organisations. Les gestes d’engagement peuvent être réalisés par une personne, de manière individuelle. Ils peuvent également être concrétisés au sein d’un groupe. Ces mêmes gestes peuvent aussi être accomplis par des organisations formelles, qu’il s’agisse d’une organisation entièrement dévouée à une cause (comme c’est le cas pour les organismes communautaires) ou par une organisation dont la mission première n’est pas l’engagement social.
Qu’est-ce qui caractérise l’engagement (le quoi)? Un ensemble de gestes volontaires et concrets. La question du geste réfère ici à l’importance de l’action et va donc au-delà de la simple intention. L’adjectif volontaire implique que le geste se fait délibérément et sans contrainte, alors que l’adjectif concret signifie que le geste est tangible et manifeste.
Figure 0.1 Qu’est-ce que l’engagement social?
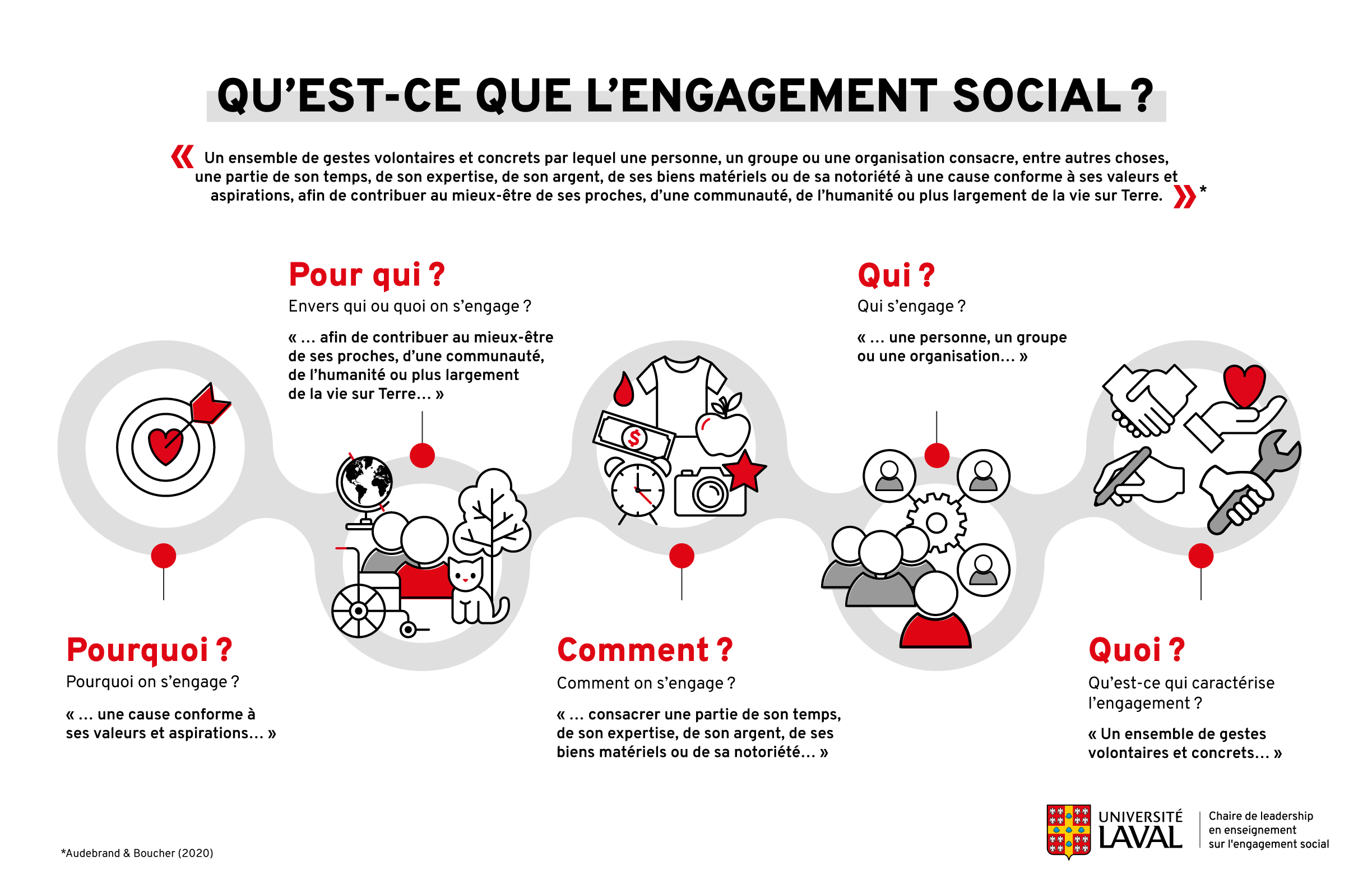
La première partie de cet ouvrage suivra la même séquence que celle du schéma de la figure 0.1 : ainsi, le chapitre 1 abordera le pourquoi, le chapitre 2, le pour qui, le chapitre 3, le comment, le chapitre 4, le qui et finalement, le chapitre 5 traitera du quoi.
La vision proposée accorde une importance à la bienveillance à l’égard des personnes engagées et valorise les bienfaits de l’engagement social. Ainsi, la deuxième partie de cet ouvrage traitera de l’apprentissage par l’engagement social et ensuite des liens entre l’engagement social et la santé des personnes engagées.
Bibliographie
Binhas, L. (2023). Enquête repères 2022. Comité sectoriel de main-d’œuvre – Économie sociale – Action communautaire. https://www.csmoesac.qc.ca/assets/medias/documents/REPERES-2022_VF.pdf
Hahmann, T. (2021, 23 avril). Le bénévolat, ça compte : aide encadrée et aide informelle apportées par les Canadiens et les Canadiennes en 2018. Statistiques Canada. https://www150.statcan.gc.ca/n1/pub/75-006-x/2021001/article/00002-fra.htm
Le Robert (2025, 9 mai). Engagement. Dans Dico en ligne Le Robert https://dictionnaire.lerobert.com/definition/engagement
Le Robert (2025, 9 mai). Engager. Dans Dico en ligne Le Robert https://dictionnaire.lerobert.com/definition/engagement
Sinek, S. (2015). Commencer par pourquoi. Performance Édition.