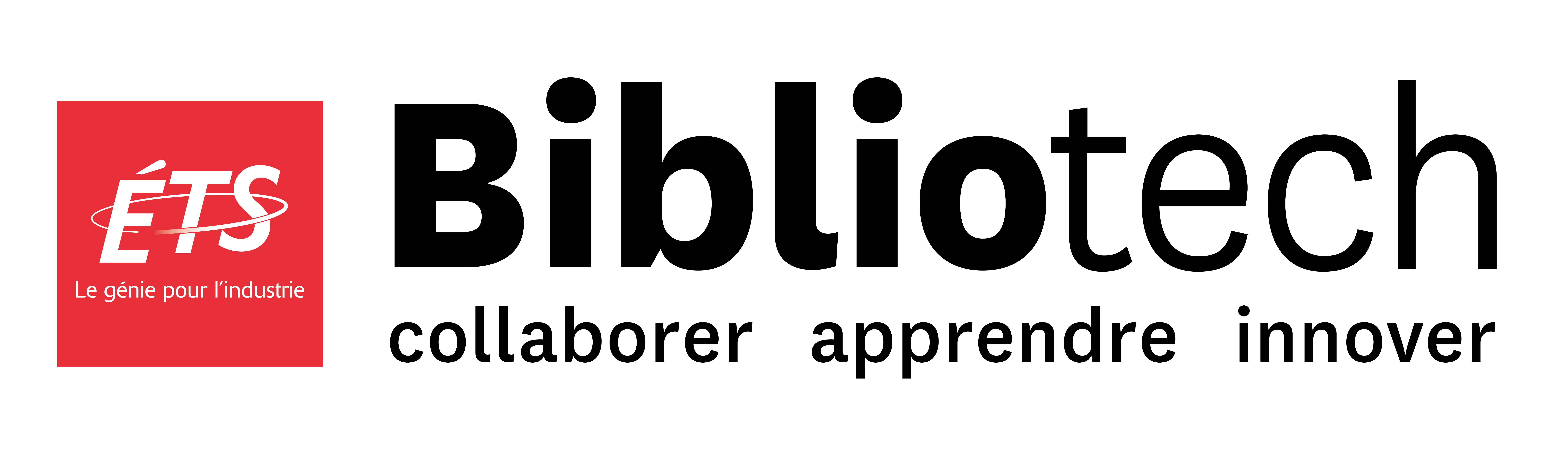Chapitre 5: QUOI
Luc K. Audebrand; Patrice C. Ahehehinnou; et Gabriel Huot
Introduction
Dans ce chapitre, nous analyserons les premiers termes énoncés au début de la définition de l’engagement social, soit « un ensemble de gestes volontaires et concrets ». Nous allons, dans un premier temps, développer la notion de gestes volontaire en abordant plusieurs théories tirées de la littérature, notamment celle de l’action sociale. Dans un deuxième temps, nous décrirons successivement les caractéristiques d’une action concrète. Cette description nous permettra d’énumérer les principaux critères permettant de qualifier une action d’engagement social. Enfin, avec ces critères, nous allons, dans un troisième temps, évoquer certains cas limites d’engagement social.
5.1 Un geste volontaire
Le Robert (s. d.-a) définit le geste de la façon suivante :
Mouvement du corps (surtout des bras, des mains, de la tête), révélant un état d’esprit ou visant à exprimer, à exécuter quelque chose. S’exprimer par gestes. Faire un geste de la main. Au figuré Acte, action. Un geste d’autorité, de générosité. Les faits et gestes de quelqu’un, sa conduite, ses actes. Faire un geste, une bonne action.
C’est donc à la seconde définition du geste que renvoie la définition, en tant que synonyme de l’action. Que ce soit en s’engageant bénévolement pour une organisation luttant contre l’homophobie, en participant à une manifestation pour la justice climatique, en partageant des publications sur les réseaux sociaux pour dénoncer les injustices sociales dont sont victimes certaines minorités ethniques ou en faisant des dons à un orphelinat, une personne pose avant tout une action, un geste. Joule et Beauvois (2010) définissent d’ailleurs l’engagement comme « une situation donnée, aux conditions dans lesquelles la réalisation d’un acte ne peut être imputable qu’à celui qui l’a réalisé. » (p. 60). Cette définition permet d’établir un lien entre une personne et l’action qu’elle a posée. L’existence de ce lien ne justifie pas forcément l’intentionnalité de la personne. Il est évident que pour être jugée comme volontaire ou intentionnelle, une action doit répondre à certains critères bien précis.
5.1.1 L’intention et la volonté
Proust (1998) distingue une action d’un simple mouvement par le fait qu’une action est guidée par les intentions, les désirs et les croyances de la personne qui la réalise. Le concept d’action et la notion d’intention sont interreliés. En s’appuyant sur cette interrelation, Ajzen (1985) précise que toute intention ne conduit pas nécessairement à des gestes volontaires; un geste volontaire sera toutefois dirigé par une intention. On ne peut bien sûr pas qualifier d’engagement social l’exemple d’une personne qui aurait accidentellement perdu un billet de 20 $, somme retrouvée par la suite par une mère de famille monoparentale aux prises avec de graves difficultés financières. Selon von Wright (1979, 1981a, 1981b), toute action est définie par son caractère intentionnel. La compréhension d’une action résiderait alors dans la compréhension de l’intentionnalité qui la sous-tend. La compréhension de l’intentionnalité, quant à elle, repose sur deux éléments essentiels : le but de la personne qui pose l’action et sa croyance envers les moyens pour atteindre ce but (Neuberg, 1990). C’est pourquoi, en droit, l’intentionnalité d’une action repose sur sa préméditation, un processus qui amène une personne à visualiser en amont les résultats ou les conséquences de son action.
Il existerait donc un lien entre le caractère intentionnel d’une action et son caractère volontaire. Durkheim (2023) identifie cinq moments clés dans le processus conduisant à un acte volontaire : (a) la conception du but, (b) la conception des motifs, (c) la délibération, (d) la décision et, enfin, (e) l’exécution ou l’action.
- Conception du but : Le premier moment, correspond à l’instant où une personne visualise les objectifs visés par son action. Par exemple, lorsqu’une personne fait un don de sang, elle le fait initialement dans le but d’aider une autre personne qui a besoin de sang pour sa survie.
- Conception des motifs : une fois que la personne a en tête le but à atteindre, le deuxième moment est celui de la conception des motifs où elle cherche au fond d’elle les raisons ou les motivations qui la poussent à agir. Cette personne veut donner son sang, par exemple, parce qu’elle a été témoin de situations dans sa vie où le manque de sang a causé du tort à une personne proche. Pour chaque but à atteindre, une personne trouvera plusieurs raisons et motifs pour justifier son action. Tous ses motifs n’ont pas le même degré d’importance.
- Délibération : le troisième moment correspond au moment où une personne classe ses motifs en les comparant pour mettre en évidence les plus importants à ses yeux. Une personne accorderait davantage d’importance aux motifs qui la concernent personnellement ou qui affectent ses proches plutôt qu’à ceux ayant trait à la société ou à l’humanité.
- Décision : Le moment de la décision intervient dès que la personne fait le choix d’un motif particulier et prioritaire qui va la pousser à poser l’action. Une personne décidera, finalement, de donner son sang pour sauver des vies, car cela correspond à ses valeurs de contribuer au mieux-être des autres.
- Exécution ou action : Le dernier moment offre à la personne l’occasion de concrétiser sa décision en accomplissant une action tangible, soit donner son sang.
Ces cinq moments permettent de saisir plus facilement la responsabilité d’une personne dans une action volontaire. Bien que les quatre premiers moments soient des étapes mentales et cognitives (c’est-à-dire qu’elles sont internes à la personne et ne dépendent pas d’une influence externe), l’exécution physique de l’action vient concrétiser tout le processus aboutissant à une action volontaire.
Ainsi, pour Durkheim (2002), la volonté désigne « la faculté par laquelle nous sommes la cause déterminante de certaines de nos actions; c’est grâce à elle que certains de nos actes se produisent sous notre impulsion, émanent de nous » (p. 169). Pour qu’une action soit qualifiée de volontaire, il faut qu’elle chemine à travers ces cinq moments.
5.1.2 La théorie du comportement planifié
Proposée par Ajzen (1991), la théorie du comportement planifié fait également un lien entre le geste volontaire et l’intention. Cette théorie est une extension de la théorie de l’action raisonnée d’Ajzen et Fishbein (1980). Selon la théorie du comportement planifié, l’intention est le déterminant le plus direct d’une action sous-tendue par un contrôle volitionnel (Fenouillet, 2023). L’intention d’une personne est elle-même déterminée par trois éléments essentiels : (a) l’attitude envers le comportement, (b) les normes subjectives ainsi que (c) la perception du contrôle sur le comportement.
L’attitude envers le comportement est liée aux résultats (positifs ou négatifs) de l’évaluation de la réalisation effective du comportement. L’attitude d’une personne est associée à ces croyances et à ses valeurs. L’attitude envers un comportement équivaut à « l’ensemble des conséquences favorables ou défavorables amendées du poids des croyances qui consiste à estimer que le fait de réaliser le comportement va avoir telle ou telle conséquence » (Fenouillet, 2023, p. 187).
Les normes subjectives sont, quant à elles, liées aux croyances de la personne concernant les attentes des autres acteurs et actrices de son environnement proche sur la façon appropriée ou non de se comporter dans diverses circonstances. Les normes subjectives sont établies par les croyances normatives d’une personne et sa motivation à se conformer aux normes.
La perception du contrôle sur le comportement renvoie à la perception qu’une personne a de ses capacités personnelles et de la faisabilité du comportement et de l’action (Ajzen, 2012). La perception positive ou négative qu’a une personne de ses capacités à atteindre les objectifs par l’action et le contrôle que celle-ci peut avoir sur ses différentes ressources (les informations, l’intelligence, les compétences, les capacités financières ou tout élément nécessaire pour poser l’action) affecte son intention d’adopter un certain comportement. Une médecin qui décide de s’engager, par exemple, dans du bénévolat d’expertise s’est assuré en amont qu’elle a le contrôle sur ses compétences, ses qualités et son expertise dans les tâches qu’elle aura à assumer au sein de l’organisme communautaire dans lequel elle interviendra. Une personne ayant un contrôle comportemental élevé, sera plus encline à s’engager dans l’action (Ajzen, 1991 et 1985; Ajzen et Fishbein, 1980). La théorie de l’action planifiée est fondée sur le concept d’auto-efficacité de Bandura (1977) qui part du principe qu’une personne s’engage plus facilement et persévère davantage dans une activité lorsqu’elle croit en ses propres capacités à mener à bien une action pour atteindre les résultats escomptés
L’action sociale
Weber (1971) ainsi que Parsons et Shils (1951) ont abordé un concept pertinent à traiter en lien avec ceux de l’action et de l’engagement social, soit celui d’action sociale. L’action est définie par Weber (1971) comme « un comportement humain (peu importe qu’il s’agisse d’un acte extérieur ou intime, d’une omission ou d’une tolérance), quand et pour autant que l’agent ou les agents lui communiquent un sens subjectif » (p. 4). Cette définition met donc en valeur l’importance du sens (l’interprétation, la signification personnelle) qu’une personne attribue à son comportement afin de pouvoir qualifier celui-ci d’action. Weber (1971) définit ensuite l’action sociale en tant que telle comme « toute action qui, d’après son sens visé par l’agent ou les agents, se rapporte au comportement d’autrui, par rapport auquel s’oriente son déroulement » (p. 4). Ainsi, un comportement pourra être qualifié d’action si la personne lui attribue un sens et il pourra être qualifié d’action sociale si ce sens est lié à autrui.
Selon Parsons et Shils (1951), l’action sociale est toute conduite humaine dont la motivation se retrouverait dans les objets sociaux présents dans le milieu de vie d’une personne, auxquels elle accorde une importance tout en essayant d’y apporter une réponse. Les objets sociaux en question sont les autres actrices et acteurs sociaux avec lesquels elle est en interaction dans son environnement, mais également d’autres éléments, comme les objets culturels et symboliques ainsi que les normes, les règles de conduite et les valeurs qui orientent l’action de l’acteur ou de l’actrice. Pour Parsons, l’interprétation que l’on peut avoir de l’action sociale d’un acteur ou d’une actrice doit se faire en tenant compte de sa subjectivité qui englobe les objectifs souhaités, ses motivations, son regard sur son milieu de vie, ses valeurs, ses sentiments et ses émotions face à ses propres actions (Rocher, 1972).
La théorie de l’action sociale de Parsons repose principalement sur quatre éléments (Rocher, 1972) :
« 1) Un sujet-acteur, qui peut être un individu, un groupe ou une collectivité;
2) Une situation, qui comprend des objets physiques et sociaux avec lesquels l’acteur entre en rapport;
3) Des symboles, par l’intermédiaire desquels l’acteur entre en rapport avec les différents éléments de la situation et leur attribue une signification;
4) Des règles, normes et valeurs, qui guident l’orientation de l’action, c’est-à-dire les rapports de l’acteur avec les objets sociaux et non sociaux de son environnement » (p. 37).
L’action sociale d’un acteur ou d’une actrice ne s’analyse plus uniquement sur le prisme de l’acte posé et de ses effets, mais elle se fait désormais sur la base de la dualité entre l’acteur ou l’actrice et la situation (Rocher, 1972). Toute action d’un acteur ou d’une actrice est ainsi associée à une situation présente dans son environnement proche ou dans sa communauté. Par exemple, lorsqu’une personne s’engage dans la lutte contre les violences faites aux femmes, il est fort possible qu’elle le fasse parce que de nombreuses femmes subissent cette injustice dans son environnement proche ou éloigné et que son engagement touche ses valeurs, ses sentiments et ses émotions en tant qu’être humain.
5.1.3 La conscience des circonstances et des conséquences
En plus d’être associée à l’intention, l’action volontaire est également associée à la conscience; une action volontaire est donc une action consciente. Aristote estime d’ailleurs qu’une action volontaire suppose que la personne concernée connaisse les circonstances précises à travers lesquelles l’action se déroule. À ceci s’ajoute la conscience des conséquences de l’action (sans écarter que certaines actions peuvent entraîner des conséquences au-delà de ce que la personne avait prévu). Aristote (année) définit ainsi l’action volontaire :
« tout ce qui, parmi les choses qui sont au pouvoir de l’agent (eph’hautô), est accompli en connaissance de cause (eidôs), c’est-à-dire sans ignorer la personne subissant l’action, ni l’instrument employé, ni le but à atteindre (par exemple, l’agent doit connaître qui il frappe, avec quelle arme et en vue de quelle fin), chacune de ces déterminations excluant au surplus toute idée d’accident ou de contrainte. » (paragr. 8).
5.1.4 L’absence de contrainte
La citation précédente met en lumière une autre des caractéristiques essentielles de l’action volontaire, soit l’absence de contrainte. En effet, le mot « contrainte » figure parmi les antonymes du terme « volontaire » (Larousse, s. d.). Poser une action de façon volontaire, comme faire un don de biens à un organisme communautaire dans le but que ceux-ci soient mis à la disposition gratuitement d’autres personnes dans le besoin, ce serait d’agir de manière libre, sans aucune contrainte. L’Agence du revenu du Canada (2018) définit d’ailleurs le don comme « un transfert volontaire de biens, sans contrepartie de valeur pour le donateur » (21e entrée du lexique). Une personne qui effectue des heures de service communautaire obligatoire au sein d’un organisme vient en appui à la cause soutenue par celui-ci. Toutefois, il ne s’agit pas d’un geste volontaire et ceci ne peut donc pas constituer une forme d’engagement social. Cet exemple diffère effectivement du choix libre et éclairé d’une personne qui s’engage bénévolement dans le même organisme.
5.1.5 L’ego et l’essence
Les raisons de l’engagement social d’une personne sont multiples et dépendent le plus souvent de ses valeurs et de son vécu. Toutefois, les perceptions des autres par rapport à la non-implication d’une personne dans une cause peuvent aussi influencer les motifs de son engagement. Par exemple, dans certaines communautés, le soutien moral ou financier à un membre de la famille n’est pas volontaire, mais presque obligatoire. Il est fréquent d’entendre certaines personnes dire « Je l’ai fait, car je n’avais pas le choix. C’est mon devoir. ».
De nombreuses personnes s’engagent dans des causes sociales par obligation. Bien que ces expériences aient été et soient encore une source de motivation pour certaines personnes, elles peuvent aussi être perçues comme une contrainte. Malgré l’absence d’une quelconque force externe qui exercerait une violence physique ou morale sur elles, les obligeant à agir contre leur propre volonté, les raisons ou les motifs de leur engagement pourraient malgré tout constituer une sorte de contrainte voilée.
Il semble que l’action volontaire puisse être exempte de toute contrainte physique externe, mais qu’elle puisse être accompagnée d’une contrainte sociale qui incite une personne à agir de manière explicite dans certaines situations. Ce sentiment d’obligation pourrait nuancer le caractère volontaire d’un engagement social.
Sans avancer qu’un engagement social fondé sur des obligations ne peut pas être considéré comme un engagement social, il est toutefois intéressant de se pencher sur les actions qui s’appuient sur une volonté encore plus authentique.
L’engagement social peut émaner de deux parts en nous, il peut prendre deux formes différentes. D’un côté, il y a l’engagement qui émane de l’ego et qui se traduit par une ambition personnelle à s’engager. Cette motivation vient du fait que l’engagement est valorisé dans la société et qu’il peut conférer un certain statut. D’un autre côté, l’engagement peut émaner d’une volonté plus profonde, c’est-à-dire de notre essence. À ce moment-là, l’engagement honore une part essentielle en nous, soit celle qui est prête à prendre soin de nos propres besoins ainsi que de ceux des autres. Cet engagement social est celui que je valorise le plus puisque les actions qui seront entreprises serviront la vie en nous et autour de nous.
Charles Baron, professeur titulaire, Faculté des sciences de l’administration, 2022
L’ego, développé à travers la socialisation et les expériences passées, peut être décrit, selon Charles Baron (communication personnelle, 23 septembre 2016, 31 octobre 2016, 17 septembre 2017), comme un amalgame cohérent de façons de voir, de penser et d’agir qui assure à une personne sa survie et maximise ses bénéfices personnels. Comme il est composé d’habitudes inconscientes auxquelles la personne finit par s’identifier, l’ego peut être comparé autant à un pilote automatique qu’à un masque.
S’il assure la survie de la personne, l’ego ne facilite pas la réalisation de son plein potentiel, c’est-à-dire son épanouissement, sa créativité ou encore sa contribution à l’avènement d’un monde plus sain, plus beau et plus juste. Pour y arriver, l’être humain est appelé à adopter un mode d’existence qui correspond à sa façon naturelle d’être au monde : son essence, aussi appelée le soi authentique. On qualifie ce mode d’existence d’« authentique », car il échappe aux apriorismes, aux habitudes et au pilote automatique générés par l’ego. Il repose sur un rapport différent au monde, à la vie et aux êtres humains. Il est perçu comme une abondance de possibilités et est basé sur l’interdépendance des parties et le développement organique des systèmes. En vertu de cette perspective, l’engagement social sera donc associé à l’ego lorsque les actions seront motivées par des raisons normatives plutôt que par une véritable volonté authentique.
Afin d’éclaircir les liens entre une volonté authentique d’engagement social et les obligations, il est intéressant d’aborder le stade préconventionnel, le stade conventionnel et le stade postconventionnel :
- Le stade préconventionnel est associé à une pensée opportuniste. La personne ne se soucie à ce stade que de son propre intérêt. Les conventions et les règles ne sont perçues qu’à travers la punition et la récompense.
- Le stade conventionnel est marqué par l’intégration des conventions sociales dominantes, où la moralité des actions est liée aux attentes de la société.
- Le stade postconventionnel est pour sa part caractérisé par une analyse approfondie des conventions, une prise de conscience accrue de l’interdépendance des problèmes ainsi qu’un engagement envers la transformation individuelle et sociétale.
Selon ces perspectives, l’engagement social sera possible au stade préconventionnel, mais il ne viserait ici qu’à servir l’intérêt personnel et fonctionnerait sur le principe de punition/récompense. L’engagement social au stade conventionnel sera la plupart du temps associé aux obligations. La vision du stade postconventionnel présente donc une perspective où l’engagement social peut naître d’une volonté authentique, non assujettie à l’intérêt personnel ou au sentiment d’obligation. Ce stade est également marqué par la capacité à remettre en question les normes sociales et à améliorer celles-ci de manière créative. Une personne peut choisir les valeurs en fonction desquelles elle agira, d’où l’utilisation de l’expression « conforme à ses valeurs » pour définir l’engagement social.
À titre d’exemple, une personne peut s’engager dans la promotion de la réconciliation avec les communautés autochtones après avoir pris conscience des injustices passées et présentes dont elles ont été victimes. Son engagement ne découlerait pas d’une obligation d’agir, mais d’une profonde motivation à apporter son soutien à cette cause
5.1.6 Le sens du devoir et la société contemporaine
Selon Lipovetsky (2000), la notion du devoir est perçue comme appartenant davantage au passé qu’à la société d’aujourd’hui. Une conception moderne de l’engagement social, qui met de l’avant son caractère volontaire, permet donc de proposer une perspective plus contemporaine, se distinguant des pratiques antérieures où l’engagement reposait davantage sur le sens de l’obligation. L’alternative au devoir n’est pas nécessairement la quête exclusive du mieux-être individuel, il est possible de poser des gestes volontaires et authentiques en faveur du mieux-être collectif (comme l’illustre notre définition de l’engagement social).
5.1.7 Le lien entre le geste volontaire et la nature sociale de l’engagement
Il est important de souligner que le geste volontaire peut être favorisé soit par l’absence d’obstacle, soit par la présence d’une aide. Une conception autarcique de l’individu pourrait considérer autrui comme étant uniquement des entraves au geste volontaire. Toutefois, l’engagement social remet en question ce point de vue atomiste : l’engagement social d’une personne, à travers un geste volontaire, facilite le geste volontaire d’une autre personne. Le mot « social » renvoie à la nature de l’engagement plutôt qu’à son objet.
5.2 Un geste concret
Au-delà de son caractère volontaire, l’engagement social doit être concret. Par exemple, opiner avec ses collègues sur la nécessité pour la société d’apporter un soutien aux personnes désaffiliées est plus abstrait et moins efficace qu’un don de 500 $ à un organisme communautaire venant en aide à ces mêmes personnes.
Le terme « concret » utilisé dans ce contexte renvoie à celui de « visible », qui lui-même renvoie à ceux d’ « observable » et de « manifeste ». Cependant, il est important de faire une nuance entre « observable » et « observé » : un engagement social peut être considéré comme tel même s’il n’est pas observé par une tierce personne. Le terme « concret » renvoie également à celui de « tangible », particulièrement lorsque celui-ci signifie « dont la réalité est évidente ». Le terme « concret » est d’ailleurs associé à celui de « réel ». Il s’oppose à « abstrait » et implique donc que l’engagement ne doit pas demeurer dans l’abstraction. De plus, le terme « abstrait » est généralement associé aux termes « spéculatif » et « théorique » et signifie notamment « qui recourt à l’abstraction, n’opère pas sur la réalité » (Le Robert, s. d.-b).
Nous avons vu que l’engagement social s’appuie sur des causes, des valeurs et des aspirations, et que la personne engagée aura à cœur le mieux-être de ses proches, d’une communauté, de l’humanité ou plus largement de la vie sur Terre. Toutefois, selon la définition, ces caractéristiques ne sont pas nécessairement suffisantes pour distinguer ce qui relève de l’engagement social ou non.
Des gestes concrets devront effectivement être posés, que ce soit en consacrant, entre autres, une partie de son temps, de son expertise, de son argent, de ses biens ou de sa notoriété. L’engagement ne demeurera pas dans l’abstraction, dans la théorie ou dans la spéculation. Il opérera sur la réalité; des gestes engagés seront donc visibles, tangibles, observables et manifestes.
Pour qu’un engagement social soit considéré comme tel, la volonté d’engagement ne peut pas demeurer vaporeuse, elle devra mener à des gestes précis. Par conséquent, la personne, le groupe ou l’organisation doit s’engager dans l’action. L’un des deux sens du terme « engagement » selon Le Robert (s. d.-c) réfère d’ailleurs au « fait d’être engagé (dans qqch) » et à « l’action d’engager, de commencer (une action) ». Dans le même ordre d’idée, le deuxième sens du verbe « engager » (le premier signifiant « mettre en gage ») réfère au fait « d’introduire » et de « commencer » (Le Robert, s. d.-d). Un geste pourra effectivement être qualifié de concret une fois l’action initiée.
Pour moi, l’engagement social découle du constat des failles, des problèmes, des injustices ou des inégalités. Il s’agit aussi de la volonté de ne pas rester en mode observation et de la capacité d’imaginer qu’il est possible d’agir.
Nancy Charland, vice-présidente au développement social, Centraide Québec et Chaudière-Appalaches, 2022
On peut utiliser le verbe « engager » pour décrire un véhicule qui s’engage dans une rue. Le verbe « engager » peut effectivement référer au fait de « faire entrer » et à l’action de « mettre (qqn) dans une situation qui crée des responsabilités et implique certains choix » (Le Robert, s. d.-d). L’engagement social peut également être associé à un choix. Poser un geste concret dans un contexte d’engagement social sous-entend effectivement de choisir une certaine direction. C’est à ce moment que les termes « engagement » et « engageant » se rejoignent. La section suivante analysera d’ailleurs la question des actions engageantes.
L’engagement social, c’est un choix. C’est prendre conscience des retombées de nos actes sur la société, autant sur le plan individuel, qu’organisationnel.
Caroline Housieaux, chargée d’enseignement, Faculté des sciences de l’administration, 2022
Des actions engageantes
Il est intéressant d’explorer les actions engageantes, non pas à titre de caractéristique essentielle de l’engagement social, mais plutôt en tant que guide permettant de qualifier le degré d’un engagement. Dans leur théorie de l’engagement, Joule et Beauvois (2010) ont développé des conditions ou caractéristiques situationnelles pour qu’une action donnée soit qualifiée d’action engageante. Deux grandes catégories de conditions situationnelles devraient être réunies : la taille de l’action d’une part et les raisons de l’action d’autre part. La taille de l’action se divise en deux sous-catégories, soit sa visibilité et son importance.
La visibilité d’une action est définie par quatre facteurs essentiels : son caractère public, son caractère explicite, son irrévocabilité et sa répétition.
Le caractère public d’une action signifie qu’on s’identifie soi-même pour la mener à bien. Selon cette perspective, un don anonyme peut tout de même être considéré comme un engagement social, en particulier s’il est motivé par une valeur telle que l’humilité. Cependant, il pourrait être moins engageant qu’un don public.
D’autres critères peuvent compenser l’anonymat du geste. Le caractère explicite d’une action renvoie à la prise de position nette et sans équivoque d’une personne face à une cause sociale. Avoir une position claire et précise est plus engageant que rester vague.
Une action irrévocable est une action qui ne peut pas être annulée ou contestée par son auteur. Par exemple, donner de l’argent à un organisme communautaire de lutte contre l’homophobie sans possibilité d’annulation est plus engageant que donner son accord pour participer à une manifestation contre l’homophobie avec la possibilité de se rétracter à la dernière minute.
Enfin, une action répétée sera plus engageante qu’une action ponctuelle réalisée une seule fois. Le caractère répétitif de l’action tend à associer la personne à la cause. Martin Luther King n’est pas devenu une figure de la lutte contre la ségrégation aux États-Unis en participant à une seule manifestation, mais en répétant ses actions militantes.
L’exemple du combat de Martin Luther King montre qu’une action est plus engageante quand elle cumule les quatre facteurs qui donnent de la visibilité à un engagement social. Toutes les actions de lutte de Martin Luther King contre la ségrégation étaient publiques, explicites, irrévocables et répétitives. Ainsi, l’importance de ses actions les rendait encore plus engageantes.
L’importance d’une action dépend de ses conséquences et du coût de sa réalisation. Les conséquences désignent ici les répercussions, les retombées ou encore les résultats de cette action sur soi, sur autrui ou sur l’environnement. Une action dont les conséquences sont positives est plus engageante qu’une action ayant des conséquences négatives. Par exemple, une personne qui fait un don d’appareils électroménagers à des familles vivant dans des situations de précarité est pleinement consciente que cette action permettra à ces familles de satisfaire certains de leurs besoins. Cette prise de conscience des conséquences positives de son action renforcera son engagement. Ainsi, comme nous l’avions mentionné dans la sous-section précédente, l’intention de s’engager devient plus grande lorsqu’une personne arrive à établir un lien entre ses actions et leurs conséquences. Le coût d’une action, pour sa part, revient à la quantifier sur le plan de l’argent, du temps, de la distance, du nombre de participations à des manifestations, etc. Donner 50 dollars à un organisme semble plus engageant que verser 5 dollars pour les mêmes buts. Participer à dix manifestations contre les mauvaises conditions de travail des enseignants témoigne d’un engagement plus profond envers cette cause que participer à une seule. Quantifier une action semble lui attribuer un caractère objectif, toutefois, selon Joule et Beauvois (2010), le tout doit être relativisé. Il est plus significatif de consacrer du temps à des activités bénévoles dans un organisme communautaire lorsqu’on dispose de peu de temps libre. Plusieurs facteurs peuvent donc influencer le coût de l’action d’une personne.
Pour ce qui est de la deuxième condition situationnelle, c’est-à-dire les raisons de l’engagement, Joule et Beauvois (2010) en ont identifié deux grands types : les raisons d’ordre externe et les raisons d’ordre interne. Les raisons d’ordre externe sont les motivations qui proviennent de sources autres que soi-même. Parmi les raisons d’ordre externe, on compte les récompenses, les punitions et les raisons de type fonctionnel liées à la dualité moyen/but. Les récompenses et les punitions renvoient au caractère volontaire ou non de l’action posée. Les actions qui sont influencées par des récompenses et des punitions sont donc moins engageantes que celles qui ne le sont pas. Les raisons de type fonctionnel moyens/but concernent les actions dont l’accomplissement est nécessaire pour permettre à une autre personne d’atteindre un objectif. Plus les raisons d’ordre externe sont fortes, moins les actions réalisées sont engageantes. Cette corrélation est positive dès lors que les raisons sont d’ordre interne. Les raisons d’ordre interne sont celles qui sont liées directement à la personne qui réalise l’action. Elles peuvent découler de ses valeurs, de ses aspirations ou de son expérience de vie. À travers ces raisons, une personne arrive à trouver les motivations de son engagement en elle-même et dans ses caractéristiques personnelles. Plus les raisons d’ordre interne sont fortes, plus les actions de la personne sont engageantes. Les raisons d’ordre interne renforcent le caractère volontaire et la liberté de choix de l’engagement social.
La théorie de Joule et Beauvois (2010) a permis de définir le caractère engageant de l’engagement social à travers deux conditions situationnelles déclinées en facteurs essentiels. Selon Joule et Beauvois (2010), pour que l’action soit plus engageante, elle doit :
- être réalisée de façon libre et donc volontaire;
- être visible, c’est-à-dire avoir un caractère public, un caractère explicite;
- avoir un caractère irrévocable et être répétitive;
- être motivée par une raison d’ordre interne;
- reposer sur des conséquences positives pour les bénéficiaires et pour les autres, et son coût doit être mesurable de manière objective, se situant près du plafond de ce que la personne est en mesure de payer, et non du plancher.
Comme précisé, ces caractéristiques d’une action engageante permettent d’évaluer le degré d’un engagement social. Elles ne doivent cependant pas être considérées comme des critères servant à déterminer si une action relève ou non de l’engagement social. Toutefois, il est intéressant d’observer que plusieurs liens peuvent être établis entre ces caractéristiques et celles d’un geste volontaire et concret. L’aspect volontaire rappelle le caractère volontaire du geste tel qu’abordé dans la première section de ce chapitre. Les raisons d’ordre internes font un lien avec la sous-section sur l’ego et l’essence, qui aborde la punition et la récompense ainsi que les normes sociales. Les aspects visibles et explicites, pour leur part, font un lien avec le caractère observable et manifeste d’un geste concret. La question des conséquences positives peut être liée avec le verbe « contribuer », présent dans la définition, qui évoque un geste visant à contribuer au mieux-être des proches, d’une communauté, de l’humanité ou plus largement de la vie sur Terre.
La parole et l’engagement social
Est-ce qu’une prise de parole en faveur d’une cause sociale correspond à un engagement social? Il est intéressant de faire intervenir ici le premier sens d’engagement, soit l’« action de se lier par une promesse ou une convention », comme dans l’expression « respecter ses engagements » (Le Robert, s.d.-c.). En contexte d’engagement social, une prise de parole sera effectivement très pertinente, mais elle sera également engageante, car elle devra être suivie de gestes qui lui correspondent. On ne pourra effectivement pas qualifier d’engagement social le cas d’une personne s’exprimant constamment sur l’importance de l’action climatique, mais qui ne soutient pas ses paroles par des gestes concrets en appui à cette même cause. Le caractère engageant de la parole fait un lien intéressant avec le fait qu’une action engageante doit être visible, c’est-à-dire avoir un caractère public, un caractère explicite.
5.3 Les cas limites
Établir des critères qui distinguent un engagement social véritable d’une action qui n’en est pas une est un exercice complexe et bien délicat. Cela étant dit, la définition de l’engagement social de la Chaire de leadership en enseignement sur l’engagement social permet de guider la réflexion et d’établir si une action correspond aux critères énoncés dans cette définition ou si elle s’en écarte. Il est donc possible de voir le tout comme un spectre et c’est pourquoi il est intéressant d’étudier quelques cas limites.
5.3.1 Exemple 1 : Les publications sur les réseaux sociaux
Prenons comme exemple une vedette qui partage une publication d’un organisme œuvrant dans la lutte aux changements climatiques. Tout d’abord, puisque cette publication porte sur la lutte aux changements climatiques, il est possible d’avancer qu’elle vise à appuyer une cause qui correspond aux valeurs et aspirations de la personne ainsi qu’à contribuer au mieux-être de ses proches, d’une communauté, de l’humanité ou plus largement de la vie sur Terre. Toutefois, est-ce qu’elle contribue de façon claire à ce mieux-être en question? C’est sujet à discussions.
Est-ce que cette personne consacre une partie de son temps, de son expertise, de son argent, de ses biens ou de sa notoriété? Le fait de republier un message ne requiert ni temps, ni expertise, ni argent. Toutefois, comme il s’agit d’une vedette, on peut supposer qu’elle utilise sa notoriété pour soutenir l’organisme en question. Il faut toutefois noter qu’il existe des manières plus significatives de consacrer sa notoriété à une cause, ce qui rend cette contribution plutôt superficielle.
Est-ce que le geste de la vedette en question est volontaire et concret? Si l’on admet qu’elle a volontairement publié ce contenu, on peut affirmer que son geste est volontaire. Est-ce qu’il s’agit d’un geste concret? Il s’agit ici d’un cas limite. Plusieurs perspectives sont possibles sur cette question. Le geste est réel et observable, mais il serait toutefois possible d’avancer qu’il est peu tangible et que cette personne s’engage très peu dans l’action. Est-ce que cela en fait une action engageante, selon Joule et Beauvois (2010)? Même si l’action est volontaire, visible et peut être motivée par une raison d’ordre interne, les conséquences positives et le coût sont possiblement faibles et l’action n’est pas répétitive.v
5.3.2 Exemple 2 : La fiscalité d’une entreprise
Prenons un deuxième exemple : une entreprise qui mentionne dans son rapport sur la responsabilité sociale les montants payés en impôts et en taxes. Est-ce qu’il est question d’engagement social dans un tel cas?
Les impôts sont utilisés pour financer diverses causes qui favorisent le mieux-être des communautés, de l’humanité ou plus largement de la vie sur Terre. Des sommes considérables y sont consacrées. Le paiement des impôts est concret. Toutefois, comme il ne s’agit pas d’un geste volontaire, peu de personnes considèrent cette situation comme de l’engagement social, même à titre de cas limite.
Conclusion
Le terme « social » fait référence à la deuxième partie de la définition, où il est effectivement question de causes, de valeurs, d’aspirations et du mieux-être de proches, d’une communauté, de l’humanité ou plus largement de la vie sur Terre. Quant aux racines étymologiques des mots « engagement » et « engager », elles renvoient plutôt à la première partie. Ces termes sous-entendent des choix et sont liés à l’idée d’engager une action, de s’engager dans quelque chose (comme un véhicule qui s’engage dans une voie). Le lien avec le caractère volontaire et concret est évident. Cependant, il est également important de souligner le lien avec le fait de consacrer quelque chose (comme une partie de son temps, de son expertise, de son argent, de ses biens ou de sa notoriété). En effet, lorsqu’une personne s’engage dans quelque chose, elle fait un choix et elle le concrétise, le rendant manifeste.
Questions de réflexion
- En quoi mon engagement social répond-il aux critères des gestes volontaires, tel que présenté dans ce chapitre? (Intentionnel, conscient et sans contrainte)
- En adoptant la perspective des stades postconventionnels, à quel point ces gestes sont-ils volontaires?
- En quoi mon engagement social se manifeste-t-il par des gestes concrets?
- Si ces gestes sont engageants, en quoi le sont-ils?
Bibliographie
Agence du revenu du Canada (2018). Don. Dans Lexique des organismes de bienfaisance et dons. https://www.canada.ca/fr/agence-revenu/services/organismes-bienfaisance-dons/organismes-bienfaisance/lexique-organismes-bienfaisance-dons.html#d
Ajzen, I. (1985). From intentions to actions: A theory of planned behavior. Dans J. Kuhl et J. Beckmann (dir.), Action Control: From cognition to behavior (p. 11-39). Springer.
Ajzen, I. (1991). The theory of planned behavior. Organizational Behavior and Human Decision Processes, 50(2), 179-211. https://doi.org/10.1016/0749-5978(91)90020-T
Ajzen, I. (2012). The theory of planned behavior. Dans P. A. M. Van Lange, A. W. Kruglanski, et E. T. Higgins (dir.), Handbook of theories of social psychology (vol. 1, p. 438–459). Sage Publications Ltd. https://doi.org/10.4135/9781446249215.n22
Ajzen, I. et Fishbein, M. (1980) Understanding attitudes and predicting social behavior. Prentice-Hall.
Aristote. (s.d). Volontaire et involontaire. Récupéré le 07 avril 2025, de https://ifac.univ-nantes.fr/IMG/pdf/Aristote_volontaire_involontaire.pdf
Bandura, A. (1977). Self-efficacy: Toward a unifying theory of behavioral change. Psychological Review, 84(2), 191-215. https://doi.org/10.1037/0033-295X.84.2.191
Durkheim, E. (2002). Cours de philosophie fait au Lycée de Sens en 1883-1884 notes prises entre 1883-84 par le philosophie français André Lalande. J.-M. Tremblay. http://dx.doi.org/doi:10.1522/cla.due.cou1
Fenouillet, F. (2023). Les théories de la motivation (2e éd., p. 65-290). Dunod.
Joule, R. et Beauvois, J. (2010). Chapitre 3. La psychologie de l’engagement. Dans R. Joule et J. Beauvois (dir), La soumission librement consentie : Comment amener les gens à faire librement ce qu’ils doivent faire? (p. 52-94). Presses Universitaires de France.
Larousse (s. d.). Volontaire. Dans Larousse en ligne. Récupéré le 07 avril 2025, de https://www.larousse.fr/dictionnaires/francais/volontaire/82470
Le Robert. (s. d.-a). Geste. Dans Le Robert dico en ligne. Récupéré le 07 avril 2025, de https://dictionnaire.lerobert.com/definition/geste
Le Robert. (s. d.-b). Abstrait. Dans Le Robert dico en ligne. Récupéré le 07 avril 2025, de https://dictionnaire.lerobert.com/definition/abstrait
Le Robert. (s. d.-c). Tangible. Dans Le Robert dico en ligne. Récupéré le 07 avril 2025, de https://dictionnaire.lerobert.com/definition/abstrait
Le Robert. (s. d.-d). Engagement. Dans Le Robert dico en ligne. Récupéré le 07 avril 2025, de https://dictionnaire.lerobert.com/definition/engagement
Le Robert. (s. d.-e). Engager. Dans Le Robert dico en ligne. Récupéré le 07 avril 2025, de https://dictionnaire.lerobert.com/definition/engager
LIPOVETSKY, G. (2000). Le crépuscule du devoir, Gallimard.
Neuberg, M. (1990). Expliquer et comprendre. La théorie de l’action de G. H. von Wright. Revue Philosophique de Louvain, 88(77), 48-78.
Parsons, T. et Shils, E. A. (1951). Toward a general theory of action. Harvard University Press.
Proust, J. (1998). Action. Dans O. Houdé, D. Kayser, O. Koening, J. Proust. et F. Rastier. (dir.), Vocabulaire de sciences cognitives (p. 36-37). PUF.
Robitaille, C. (2021 ). Une sociologie de l’action : évolution d’un concept et présentation d’un paradigme. [Thèse de doctorat, Université d’Ottawa]. https://ruor.uottawa.ca/bitstream/10393/42624/1/Robitaille_Christian_2021_these.pdf
Rocher, G. (1972). Talcott Parsons et la sociologie américaine. Presses universitaires de France.
von Wright, G. H. (1979). The determinants of action. Dans R. Klibansky et H. Kohlenberger (dir.), Reason, Action and Experience: Essays in honor of Raymond Klibansky (p. 107-119). Meiner.
von Wright, G. H. (1981a). Explanation and understanding of action. Revue Internationale de Philosophie, 35(135), 127-142. http://www.jstor.org/stable/23945379
von Wright, G. H. (1981b). On the logic of norms and actions. Dans R. Hilpinen (dir.), New Studies in Deontic Logic (p. 3-35). Dordrecht. https://doi.org/10.1007/978-94-009-8484-4_1
Weber, M. (1971) Économie et société (traduit par E. de Dampierre, J. Freund, P. Kamnitzer et P. Bertrand). Librairie Plon. (Ouvrage original publié en 1921)