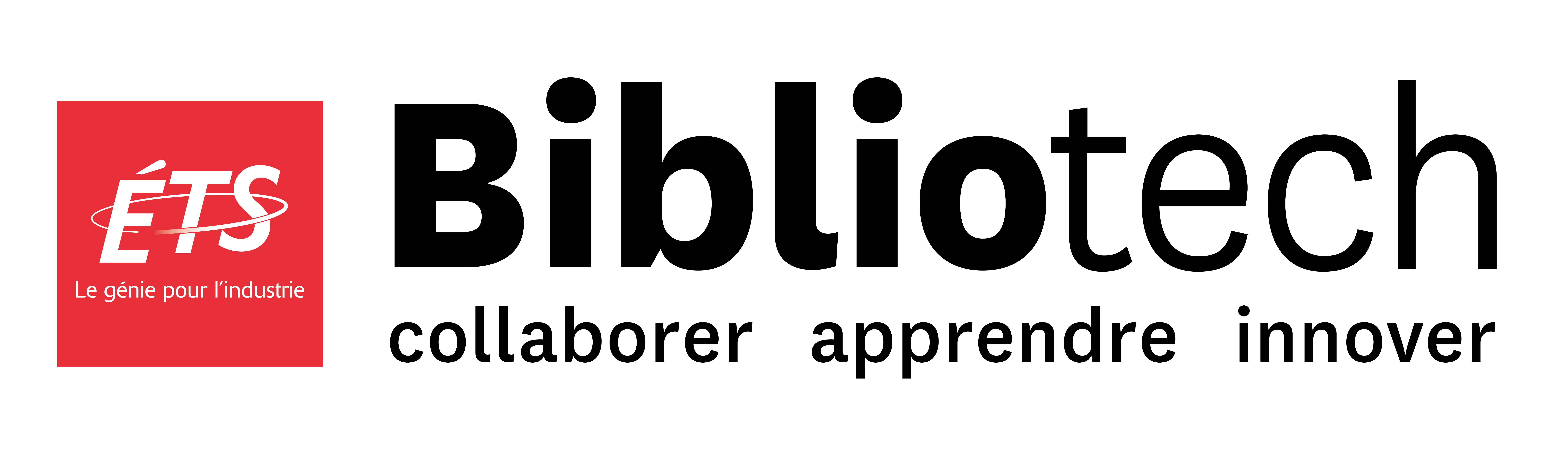Chapitre 4: QUI
Luc K. Audebrand; Patrice C. Ahehehinnou; Gabriel Huot; et Sarah Goussard
Introduction
Comme nous l’avions exposé dans le chapitre précédent, il existe plusieurs façons de s’engager dans une cause. L’engagement peut être individuel, mais également collectif, émanant de diverses motivations, et visant l’amélioration du bien-être de nos proches, de la communauté, de l’humanité ou de la vie sur Terre. L’engagement est dit individuel lorsqu’une personne soutient une cause de façon volontaire. L’engagement peut aussi être le fruit d’un groupe de personnes ou d’un organisme à travers des actions collectives. Mais que signifie réellement s’engager de façon individuelle ou de façon collective? Quelle est la distinction entre un individu et un groupe, un mouvement social ou une organisation en matière d’engagement social? Ce chapitre vise à éclaircir les concepts d’engagement individuel, groupal et organisationnel, ainsi qu’à mettre en évidence les distinctions entre une personne, un groupe, un mouvement social et une organisation.
4.1 Une personne (un individu)
L’action d’une personne fait partie des expressions que permet de désigner notre définition de l’engagement. À titre d’exemple, il est question de l’action d’une personne lorsqu’un individu décide de faire un don de denrées à une banque alimentaire régionale. Cette section s’attardera sur la signification de l’action d’un individu.
De toute évidence, la vie au sein d’une société découle des actions de chaque individu, car ce sont les individus qui sont en mesure d’agir dans la vie sociale. L’existence d’une société repose sur les liens et les interactions qui se tissent entre les membres qui la composent. Par conséquent, l’individu est considéré comme l’unité de base d’une société. Dumont (1983) perçoit l’individu à la fois comme une entité et une valeur. Il le définit d’un côté comme un « sujet empirique, échantillon indivisible de l’espèce humaine, tel qu’on le rencontre dans toutes les sociétés » (p. 264) et de l’autre, comme un « être moral, indépendant, autonome, et ainsi (essentiellement) non social, tel qu’on le rencontre avant tout dans notre idéologie moderne de l’homme et de la société » (p. 264).
Toujours dans une perspective moderne, Ennuyer (2016) décrit l’individu comme étant « tout être formant une unité distincte dans une classification, corps organisé vivant d’une existence propre et qui ne saurait être divisé sans être détruit, unité élémentaire dont se composent les sociétés. » (p. 577). Peu importe la façon dont il est défini, l’individu présente deux caractéristiques essentielles : son unicité et son indivisibilité. Selon l’étymologie, le terme « individu » dérive du latin individuum, dont la racine in Dividere signifie « qui ne peut pas être partagé, qui est indivisible » (Ennuyer, 2016, p. 577). En tenant compte de ces traits distinctifs, comment l’individu, en tant que personne unique et indivisible, vit-il dans une société de plus en plus complexe et remplie d’inégalités sociales? Quel est le lien qui unit l’individu à la société dans laquelle il vit?
4.1.1 L’individu et la société
Le terme « social » désignant la nature de l’engagement plus que son objet. Par conséquent, un engagement ne se limite jamais à un circuit fermé, même lorsqu’il est initié par une seule personne. Pour illustrer ce point, reprenons l’exemple du don de denrées alimentaires, qui nécessite une banque alimentaire, elle-même en relation avec un écosystème. Il est donc intéressant d’aborder les rapports entre l’individu et la société.
Selon Ennuyer (2016), une société est définie comme « un groupe d’êtres humains ou d’animaux ayant établi des relations durables qui vivent sous des lois communes, qui ont une forme de vie commune qui sont soumis à un règlement commun » (p. 577). Ce qui lie un individu à sa société n’est rien d’autre que le lien social, car chaque individu est considéré à la fois comme un acteur et un bénéficiaire de ce jeu social. L’individu est perçu comme un acteur de la vie sociale, car ce sont les actions individuelles qui contribuent au développement de la société dans laquelle il évolue. Un enseignant, par exemple, est un acteur social, car il transmet, par son enseignement et sa formation, les valeurs du système éducatif. Ces valeurs sont établies à partir de celles de la société actuelle ou souhaitée. L’enseignant ne se limite pas à transmettre ces valeurs; il les incarne et contribue à former des individus qui seront en mesure de les perpétuer. En tant que bénéficiaire du jeu social, l’individu reçoit de la société une aide, qu’elle soit individuelle, collective ou institutionnelle, pour qu’il puisse vivre du lien social qui le relie à sa famille, à sa communauté et à la société en général.
Selon Paugam (2022), le lien social renvoie au « rapport entre l’individu et ses groupes d’appartenance, d’un côté, et des conditions du changement social de longue durée, de l’autre » (p. 3). Dans la continuité de cette définition et en s’appuyant sur des notions comme la solidarité, la protection, la reconnaissance et l’intégration sociale, Paugam (2022) considère que l’emploi du concept de lien social désigne aujourd’hui « le désir de vivre ensemble, la volonté de relier les individus dispersés, l’ambition d’une cohésion plus profonde de la société dans son ensemble » (p. 4). Il distingue quatre catégories de liens sociaux : (a) les liens de filiation entre parents et enfants, (b) les liens de participation élective entre conjoints, amis et proches choisis, (c) les liens de participation organique entre acteurs de la vie professionnelle et enfin, (d) le lien de citoyenneté entre les membres d’une même communauté politique.
C’est donc souvent à travers ce lien social qu’un individu exerce des actions sur son environnement et qu’il ressent le besoin de s’engager socialement auprès des autres et de la société en général. Comme nous l’avons exposé dans le premier chapitre, les raisons et les motivations de l’engagement social d’un individu sont multiples, mais sont notamment influencés par ses milieux de socialisation, comme sa famille, sa communauté, son lieu de travail, ses lieux d’implication sociale, etc. Selon Adiceom et Scaon (2012), « l’individu de par son évolution, ses acquis est de fait un être social inscrit dans une histoire qui “secrète” sa culture, ses normes, ses repères et ses identifications » (p. 29). Tout individu fait partie d’une communauté ou d’une collectivité et est ainsi au fait des enjeux sociaux présents dans chaque couche de la société. Chaque individu s’engage ou est engagé d’une manière ou d’une autre, directement ou indirectement dans une cause. En réalité, que signifie s’engager de façon individuelle? Qu’implique concrètement cet engagement?
4.1.2 Le modèle d’engagement différencié (Passy, 1998)
Aucun individu ne vit dans un vide social. Chaque individu appartient à un environnement social qui façonne ses comportements. Selon Passy (1998, chapitre III), les structures sociales et les ressources culturelles dont dispose une personne vont déterminer son positionnement social et ses options d’engagement envers une cause précise plutôt qu’une autre. L’auteur utilise la notion de distribution sociale de la connaissance de Schutz (1967) pour mettre en évidence le processus par lequel une personne distribue ses connaissances lorsqu’elle est confrontée à une situation ou à un événement. Le processus de distribution se déroule en trois phases : (a) la perception d’une situation particulière, (b) la détermination des causes de la situation, et (c) la recherche de solutions pour les difficultés que pose la situation (Goffman, 1974, cité dans Passy, 1998, chapitre III). Passy (1998) explique le processus de distribution comme suit :
L’individu enraciné dans un certain contexte structurel définira un événement ou une situation, lui attribuera un certain ensemble de causes et, finalement, cherchera des solutions aux problèmes engendrés par cette situation ou cet événement en fonction de son environnement structurel. Concrètement, à travers ce processus de définition et d’attribution de la réalité, l’individu évaluera la situation comme acceptable ou non, comme juste ou injuste (Fireman et Gamson, 1979; Gamson, 1992), il déterminera si un engagement politique est nécessaire ou non et, finalement, il examinera les moyens d’action pour améliorer la situation présente. (p. 59)
Ce processus de distribution décrit l’engagement d’un individu qui trouve son enracinement dans son contexte socioculturel. Il existe effectivement une relation entre les valeurs d’un individu, son contexte socioculturel et la cause dans laquelle il s’engage ainsi que l’intensité de son engagement (Passy, 1998, chapitre III). Les soulèvements populaires en France après la mort d’un adolescent abattu dans sa voiture par un policier pour un refus d’obtempérer montrent l’impact du contexte socioculturel sur l’engagement social. La majorité des personnes qui manifestaient étaient des adolescents, des adolescentes et des jeunes issus des mêmes milieux socioculturels que la victime. Les manifestations ont été l’occasion pour ces jeunes d’exprimer leur indignation face aux brutalités policières subies par les personnes de leur âge. De nombreux adolescents, adolescentes et jeunes se sont également joints à ce mouvement par solidarité envers la victime qui était considérée comme un des leurs. Il est intéressant de se demander comment ces personnes, qui ne se connaissaient pas nécessairement auparavant, ont pu s’unir rapidement en masse. C’est ce qu’explique Passy (1998, chapitre III) dans sa théorie sur le processus de l’engagement individuel.
La conception de l’engagement individuel de Passy (1998, chapitre III) repose sur trois principaux aspects : le contexte socioculturel, le contexte relationnel et l’intention de l’individu. Selon Passy (1998, chapitre III), le contexte socioculturel d’une personne détermine les possibilités d’action de celle-ci. Ce contexte inclut non seulement sa position sociale, mais aussi ses valeurs. En effet, plus une personne se sent concernée par une cause, plus elle aura tendance à s’y investir. Pour l’auteur, c’est ce contexte socioculturel qui détermine le contexte relationnel d’une personne, lequel est composé d’une part des réseaux formels de type organisationnel et d’autre part, des réseaux informels issus des liens interpersonnels que noue une personne avec ses proches. L’appartenance à des réseaux influence positivement l’engagement d’une personne. Par exemple, un enseignant membre d’une association ou d’un syndicat d’enseignants sera plus enclin à s’engager dans les questions qui touchent sa profession. De même, un jeune appartenant à un réseau d’amis ou de connaissances sera fortement influencé par les opinions de ce groupe sur des enjeux sociaux. Le contexte relationnel joue trois rôles dans le processus d’engagement individuel selon Passy (1998) :
un rôle de socialisation et de définition des identités qui conduit à un rapprochement idéologique entre l’individu et le mouvement, un rôle de recrutement de l’individu vers l’organisation du mouvement, c’est-à-dire vers l’opportunité de mobilisation, et finalement un rôle pivot, qui influence l’intention de l’acteur. (p. 63)
Les contextes socioculturel et relationnel d’une personne la prédisposent donc à s’engager de façon individuelle à travers un processus d’évaluation des paramètres, tels que l’intérêt pour la cause, le sens donné à la suite d’une expérience vécue et les quatre dimensions de la décision (l’efficacité de l’action entreprise, la capacité d’action des autorités politiques pour résoudre, ou du moins améliorer, l’objet de la contestation, les disponibilités individuelles pour entreprendre une telle action et les risques encourus par les futurs militants et militantes en participant à l’action collective) (Passy, 1998, chapitre III). Bien que ces paramètres façonnent l’intention d’une personne de s’engager, celle-ci restera sous la contrainte du contexte dans lequel elle évolue.
L’engagement individuel est variable dans le temps en fonction de l’évolution du contexte socioculturel d’une personne et de ses interactions sociales. Les possibilités d’engagement individuel d’un adolescent, par exemple, évolueront au fur et à mesure qu’il grandira et s’insérera sur le marché du travail, ou encore lorsque son cercle social se transformera. Comme les paramètres à prendre en compte fluctuent, l’évaluation de ceux-ci sera elle aussi constamment ajustée. Le modèle d’engagement différencié de Passy (1998, chapitre III), présenté à la figure 4.1, a pour avantage de préconiser une compréhension contextualisée de l’engagement individuel. Cette approche semble logique, étant donné la différence fréquente entre les contextes socioculturel et relationnel des membres d’une même famille, d’une même communauté, d’un même pays ou d’un même continent. Toutefois, l’engagement d’une personne peut prendre la forme d’une action purement individuelle, comme le don d’argent à un orphelinat. Une personne peut également s’engager individuellement dans une initiative collective, comme c’est le cas lorsqu’une infirmière s’implique dans la lutte contre le cancer du sein à travers une association dans sa communauté ou lorsqu’un ou une jeune s’engage dans un regroupement des jeunes de son quartier pour lutter contre la délinquance juvénile.
Figure 4.1 Le modèle d’engagement différencié de Passy (1998, chapitre III)
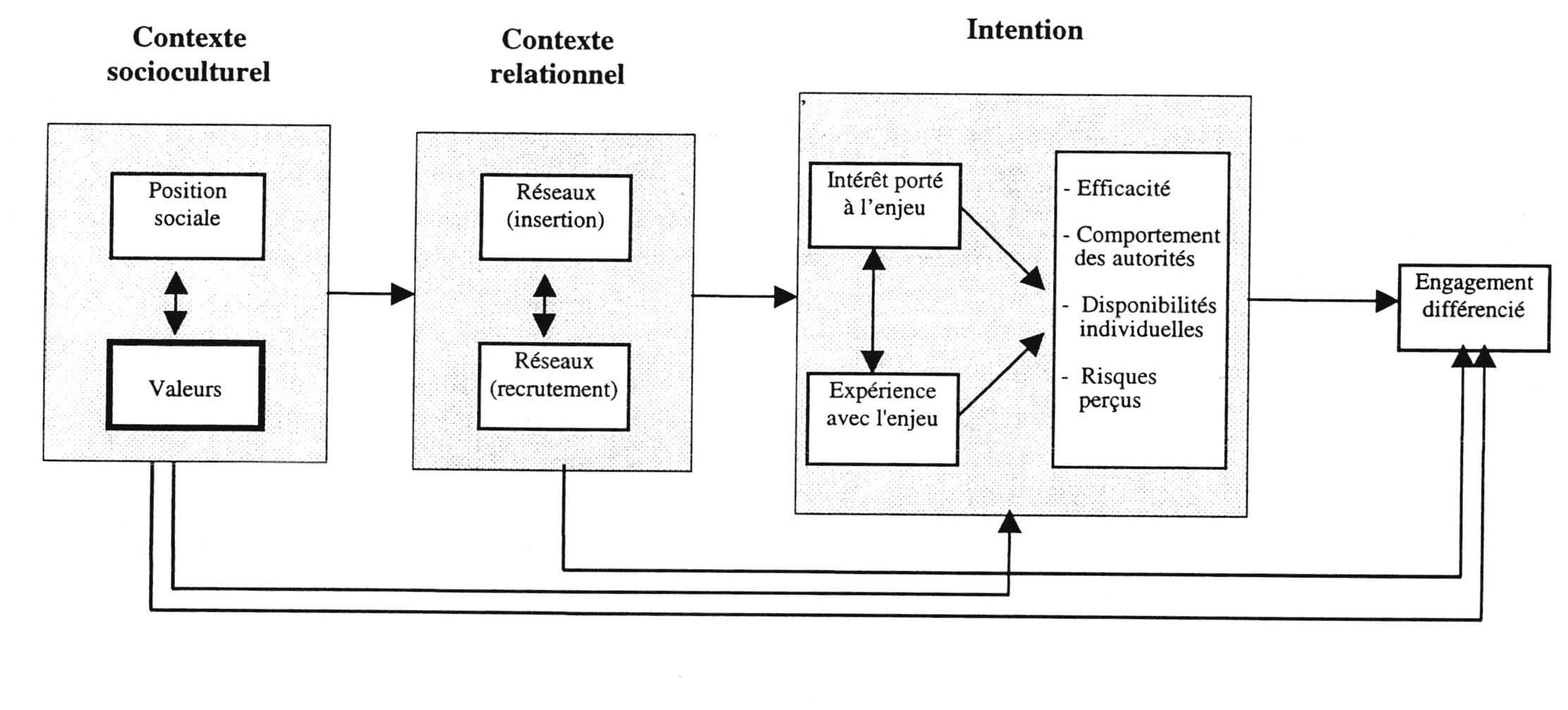
4.2 Le groupe ou le collectif
L’engagement social sous-entend nécessairement une collaboration avec les autres. Cela permet de réaliser que peu importe les qualités individuelles, la détermination à agir ou à faire une différence, c’est dans l’action collective que l’on peut avoir l’impact le plus durable et le plus profond sur la société.
Nolywé Delannon, professeure agrégée, Faculté des sciences de l’administration, 2022
4.2.1 Les actions collectives
Pour lutter contre une injustice ou s’engager dans une cause sociale, notamment à l’échelle local, plusieurs individus partageant les mêmes motivations vont se regrouper et poser des actions collectives. Une action collective est définie comme « une action commune et concertée par les membres du groupe afin d’atteindre des objectifs communs dans un environnement donné » (Paul, 2020, p. 227). Les actions collectives sont très diverses et peuvent concerner toutes les sphères sociales. Elles sont présentes dans toutes les communautés et voient le jour dans le but d’unir les forces de plusieurs individus, le plus souvent indépendants entre eux, pour exprimer leur indignation à travers des manifestations ou poser des actions plus concrètes, comme empêcher la fermeture d’une école ou d’un hôpital grâce à un financement collectif. Cette action concertée résulte de l’union des personnes qui y participent. Lorsque ces personnes décident de pérenniser leurs actions, on parlera davantage d’un groupe organisé. Il est toutefois important de distinguer les groupes organisés des organisations; ces dernières seront abordées dans la section suivante.
Les actions collectives d’un ensemble de personnes peuvent se transformer en un groupe organisé si, par exemple, celles-ci décident de mettre en place une association pour structurer leurs actions. Prenons le cas de dix jeunes d’un même quartier qui décident de réunir une somme de 1000 $ pour venir en aide à des familles démunies. Cette action collective permet de poser un acte ponctuel en faisant un don d’argent pour soutenir une cause. Si ces jeunes, en s’associant à d’autres jeunes, décident de s’engager à long terme dans cette cause et de créer un organisme à but non lucratif (OBNL) régi par des règles et des objectifs clairement définis, on parlera alors d’un groupe organisé.
4.2.2 Qu’est-ce qu’un groupe
Un groupe est défini comme :
une entité sociale identifiable et plus ou moins structurée, caractérisée par un nombre restreint de personnes liées entre elles par des activités soit communes, soit interdépendantes et qui développent des interactions déterminées par des normes de conduites et des valeurs communes, dans la poursuite de leurs objectifs. (Fischer, 2020, p. 78)
Il est important de distinguer un groupe social d’une simple assemblée d’individus dépourvus d’objectif commun, de sentiment d’interdépendance ou de liens émotionnels. Ce type de regroupement peut être observé dans divers contextes, tels qu’un groupe de personnes assistant à un spectacle musical, un groupe de jeunes jouant au football ensemble, etc. Il existe, toutefois, plusieurs types de groupes : les groupes primaires et secondaires; les groupes formels et informels; les groupes d’appartenance et de référence (Fischer, 2020, chapitre 3).
4.2.3 Les différents types de groupes
Un groupe primaire est associé à un cercle social immédiat, tel que la famille ou un groupe d’amis et d’amies au sein desquels les personnes entretiennent entre-elles des relations directes, partagent des valeurs communes et ressentent un sentiment d’unité. Les groupes secondaires sont caractérisés, quant à eux, par des relations indirectes et professionnelles entre les membres. Par exemple, le groupe d’infirmières et de médecins d’un hôpital est un groupe secondaire, car ces personnes sont soumises à des protocoles et des relations imposées.
Un groupe formel est un ensemble de personnes qui sont régies par une organisation bien définie, avec une structure hiérarchique claire, où les rôles et les places de chaque personne sont bien établis. Les groupes de travail au sein d’une organisation en constituent un exemple. Des groupes informels peuvent naître soit au sein des groupes formels, soit en dehors. Ils se distinguent des groupes formels par leur structure hétérarchique, ainsi que par la liberté dont bénéficie chaque membre.
Les groupes d’appartenance sont des regroupements de personnes partageant certaines caractéristiques, telles que leur religion ou leurs opinions politiques, qui influencent potentiellement leurs attitudes et convictions. C’est le cas des groupes religieux et des groupes politiques. Une personne de religion catholique devrait théoriquement se conformer aux enseignements de la Bible, tout comme un militant de droite devrait adhérer aux principes de son parti. Toutefois, il n’est pas rare que des membres de ces groupes adoptent des valeurs et des comportements issus d’autres groupes sociaux. Ces groupes représentent des références pour ces personnes. Un groupe de référence est donc un ensemble de gens avec lesquels on n’a aucun lien au départ, mais dont on adopte les valeurs et qui influencent nos comportements.
4.2.4 Le mode de fonctionnement des groupes organisés
Les groupes organisés ont un mode de fonctionnement qui se structure autour de cinq caractéristiques clairement définies : la taille, les statuts et rôles, les normes, la cohésion et les objectifs (Fischer, 2020, chapitre 3). La distinction entre un groupe restreint, une foule et une masse réside dans leur taille respective. L’importance d’une personne au sein d’un groupe dépend de son rang objectif, qui lui est établi selon son statut social. Il renvoie à « la position officielle, institutionnalisée ou socialement reconnue, d’un individu dans un système organisé ou hiérarchisé » (Maisonneuve, 1980). Dans certains groupes, comme la famille, ce statut peut être assimilé au rôle que joue la personne. Par exemple, le président d’une association d’agriculteurs d’une région n’occupera pas le même rôle qu’un simple membre de l’association. Toute position occupée dans un groupe confère à la fois des droits, mais également des obligations. Dans d’autres groupes, le statut d’un individu peut être déterminé par son ancienneté, les responsabilités qu’il assume ou son âge. Le rôle d’une personne au sein du groupe correspond à un modèle de comportement qu’on lui attribue en fonction de son statut.
Chaque groupe organisé doit établir des règles de fonctionnement pour assurer une certaine harmonie : ce sont les normes. Chaque membre doit se plier à ces règles afin de garantir une certaine organisation. Elles délimitent ce qui est faisable ou non pour une personne au sein du groupe et définissent et encadrent ses comportements. La cohésion renvoie à la fois à la force d’attraction du groupe, au moral du groupe, mais également à la coordination des efforts de ses membres (Fischer, 2020, chapitre 3). La cohésion représente aussi l’esprit du groupe et la force des liens qui rassemblent les membres du groupe. La cohésion apparaît souvent lorsqu’une ou un membre, voire l’ensemble du groupe, est confronté à des critiques concernant ses normes et ses buts. Plus la taille du groupe est grande, plus la cohésion en son sein semble difficilement observable.
Enfin, les objectifs d’un groupe sont des orientations à court, à moyen et à long terme définies et validées par l’ensemble des membres et qui sont exécutées par un certain nombre de personnes au sein du groupe. La pérennité d’un groupe dépend en grande partie de l’atteinte des objectifs communs définis en amont. Les conflits naissent au sein des groupes lorsque certains membres, qui ont un statut élevé, cessent de respecter les normes et les objectifs validés préalablement par tous les membres. Dès lors que le système de fonctionnement d’un groupe est manipulé et utilisé à des fins personnelles par la direction, les objectifs perdent leur caractère collectif, rendant ainsi difficile l’idée d’une unité au sein de ce groupe.
4.2.5 La communication, les affinités, l’influence et les rôles
Les interactions au sein d’un groupe offrent aux individus l’opportunité de s’engager dans des transformations au sein de leur communauté ou de la société dans son ensemble. Les actions de chaque personne sont donc guidées par la culture organisationnelle, les normes et les objectifs du groupe. Plusieurs phénomènes apparaissent au fur et à mesure que les personnes interagissent entre elles au sein du groupe. Bodart (2018) en a dénombré quatre : la communication, les affinités, l’influence et les rôles. La communication dans un groupe est essentielle à sa survie. Sans communication réelle et efficace, aucun groupe ne peut fonctionner normalement. Elle peut être verbale ou non verbale. Quand les membres d’un groupe ont une bonne communication entre eux, cela facilite le travail de chacun. Pour Bodart (2018), la communication engendre l’interaction, crée des relations, influence et colore les relations. La possibilité qu’a chaque membre au sein du groupe d’exposer son point de vue ou d’apporter des éléments de critique sur les opinions des autres ouvre la voie à des conversations animées. Ces interactions approfondies permettent aux membres de prendre ensemble des décisions de haute qualité, que tout le monde accepte, y compris ceux et celles qui avaient initialement exprimé leur désaccord. La communication est un facteur clé dans l’établissement de liens. En effet, les membres partageant les mêmes opinions sur un sujet peuvent s’unir pour défendre leur point de vue, tout comme ceux et celles qui ont des opinions divergentes. L’exposition des opinions d’une personne sur un sujet ou une situation peut influencer ses relations dans un groupe.
Les fonctions de la communication peuvent conduire à la création d’affinités au sein d’un groupe, selon les points de vue de chacun et leur sensibilité. Ainsi, bien que le groupe soit caractérisé par la cohésion entre ses membres ou par la poursuite d’un objectif commun, il n’en demeure pas moins vrai que des affinités peuvent se former à l’intérieur du groupe, notamment grâce à la création de sous-groupes ou d’alliances ayant pour but d’accroître leur influence dans le groupe, tout en servant leurs propres intérêts. Ces affinités évoluent en fonction des dynamiques au sein du groupe et parfois même selon le sujet traité. De nombreux facteurs peuvent expliquer l’apparition de ces affinités, tels que la proximité, la similitude, la perception d’une communauté d’intérêts ou de valeurs, etc. (Bodart, 2018).
À travers leurs communications ou leurs affinités, certaines personnes ou certains sous-groupes arrivent à influencer les décisions au sein d’un groupe. Cette influence témoigne du pouvoir qu’une personne peut détenir sur un groupe. Que l’intention d’influencer les décisions soit présente ou non, ces propos ou opinions peuvent faire évoluer la perception initiale qu’un membre avait d’une situation et modifier sa décision en conséquence. L’influence peut découler de la hiérarchie ou du statut d’une personne au sein d’un groupe, mais également des stratégies politiques qu’elle utilise pour occuper une position lui permettant d’exercer un certain pouvoir. Ces jeux politiques d’influence font émerger au sein des groupes trois catégories de membres : les leaders, les partisans et les opposants.
4.2.6 Les mouvements sociaux
Les actions collectives et les groupes organisés émergent souvent en réponse au manque d’engagement ou à l’inaction des autorités publiques décentralisées ou du gouvernement central. Les actions collectives peuvent être menées par des groupes restreints (3 à 12 personnes), mais également par des groupes plus importants, comme des foules ou des masses, notamment lors des mouvements sociaux.
Qu’il soit sous forme d’une grève, d’une manifestation collective, des mouvements de masse ou d’un blocage des routes, nous avons tous participé ou été témoins une fois d’un mouvement social. Un mouvement social est défini comme un « agir-ensemble » volontaire avec une intention réelle des acteurs et actrices de mener une action collective dans le but de revendiquer des intérêts matériels ou de défendre une cause afin d’inciter à un changement social (Neveu, 2019). C’est également « une campagne durable de revendications, qui fait usage de représentations répétées pour se faire connaître du plus large public et qui prend appui sur des organisations, des réseaux, des traditions et des solidarités » (Tilly et Tarrow, 2008, p. 27). Plusieurs mouvements sociaux ont marqué l’histoire, notamment le mouvement des gilets jaunes en France, le printemps arabe au Maghreb, la grève étudiante québécoise de 2012 et, plus récemment, le mouvement #MeToo aux États-Unis.
Tous ces mouvements partagent un dénominateur commun : ils visent soit à promouvoir un changement, soit à y résister. Par exemple, la grève étudiante québécoise de 2012 s’est développée en réaction à l’augmentation des frais de scolarité universitaires sur cinq ans (2012-2017) qui était prévue par le gouvernement libéral dans son budget. Plusieurs associations étudiantes québécoises avaient alors formé un front commun pour protester contre une hausse des frais de scolarité qui aurait entraîné une détérioration de la situation financière et des conditions d’études de nombreux étudiants et étudiantes. Les membres de ces associations avaient alors organisé diverses actions, telles que des piquets de grève autour des universités concernées, des manifestations et des actions concertées entre les mois de février et septembre 2012. L’importance et la pertinence des demandes ont incité de nombreux secteurs de la société québécoise à soutenir ce mouvement social. Les actions collectives menées par les étudiants et étudiantes avaient finalement abouti en septembre 2012 à l’annulation de l’augmentation des frais de scolarité.
Les caractéristiques des mouvements sociaux
Mayer (2023, chapitre 8) a mis en évidence six caractéristiques des mouvements sociaux. Pour l’auteure, les mouvements sociaux sont des actions collectives, revendicatives, directes, autonomes et expressives, contestataires, et, finalement, publiques. On parle d’actions collectives, car les mouvements sociaux regroupent un grand nombre d’individus s’engageant dans une action commune. Les actions menées dans le cadre d’un mouvement social sont revendicatives puisqu’elles visent, avant tout, la défense d’une cause ou des intérêts communs. Les actions sont directes et opposent, sans aucun intermédiaire, les personnes protestataires et le pouvoir public. Les mouvements sociaux sont des actions autonomes et expressives, car elles ne sont soumises à aucune règle juridique ou institutionnelle. La mobilisation des protestataires tend généralement à s’accroître lorsque de plus en plus de personnes réalisent l’importance des revendications. C’est le cas, par exemple, du mouvement des gilets jaunes en France, où le nombre de villes où les manifestations se déroulaient augmentait d’une semaine à l’autre, ce qui entraînait une hausse du nombre de protestataires.
Les types de mouvements sociaux
Il existe plusieurs types de mouvements sociaux selon le degré (le lieu ou la cible du changement recherché) et le niveau de changement revendiqué (l’ampleur du changement recherché). Aberle et al. (1966) ont identifié quatre types de mouvements sociaux : (a) les mouvements sociaux alternatifs, (b) les mouvements sociaux rédempteurs, (c) les mouvements sociaux réformateurs et, enfin, (d) les mouvements sociaux révolutionnaires. Les mouvements sociaux alternatifs sont ceux qui visent un changement partiel des individus, comme les groupes d’entraide pour les personnes qui souffrent d’obésité ou d’alcoolisme. C’est le cas également des mouvements qui ont pour but le développement personnel et le renforcement de l’estime de soi (Fillieule, 2009). Les mouvements sociaux rédempteurs, à la différence des mouvements sociaux alternatifs, se distinguent par leur volonté de transformation profonde de la société. Il s’agit, par exemple, des mouvements religieux, qui sont orientés vers le niveau de changement recherché, notamment celui de l’individu. Les mouvements réformateurs et révolutionnaires sont orientés vers l’ampleur du changement souhaité. Les mouvements sociaux réformateurs prônent un changement partiel de la structure sociale ainsi que la modification de certaines normes, valeurs ou lois. On peut citer les mouvements de recherche de meilleures conditions de travail pour le personnel, les mouvements de réforme du droit du mariage, etc. Enfin, les mouvements sociaux révolutionnaires visent un changement total de la structure sociale et des systèmes de valeurs de façon fondamentale. C’est le cas des mouvements politiques radicaux, comme le mouvement américain des droits civiques.
Le cycle de vie des mouvements sociaux
Comme toute action collective, les mouvements sociaux suivent un cycle de vie en plusieurs étapes. Ils émergent, se développent, ont des résultats positifs ou négatifs et enfin disparaissent. Blumer (1969) et Tilly (1978) ont identifié quatre étapes par lesquelles passent les mouvements sociaux. La première étape, l’étape préliminaire, est celle de l’émergence des mouvements sociaux où il y a une prise de conscience par les citoyens et citoyennes de l’existence d’un problème. À ce stade, les réseaux sociaux peuvent servir de catalyseurs pour sensibiliser les gens à un problème grâce à un simple partage. De cette prise de conscience collective naîtront des leaders pour mener le mouvement. La deuxième étape est celle de la fusion et de la coalition où les citoyens et citoyennes vont se réunir pour attirer l’attention sur le problème et pour structurer leur groupe en une entité relativement bien organisée. À l’étape de l’institutionnalisation ou de la bureaucratisation, les collectifs des mouvements sociaux définissent les règles et les procédures qui les régissent. Les mouvements sociaux prennent alors la forme d’une organisation formelle sans pour autant rejeter toute initiative individuelle, comme les mots-clics (hashtags). Les personnes peuvent s’engager de plusieurs manières dans un mouvement social. Elles peuvent faire partie de sa structure formelle, partager les mots-clics à chaque publication sur les réseaux sociaux ou encore avoir un sentiment d’appartenance. Les réseaux sociaux jouent également un rôle primordial à cette étape en servant de moyen de communication et en définissant la réussite ou l’échec d’un mouvement. Enfin, les mouvements sociaux connaissent un déclin après leur réussite ou leur échec. Ce déclin ne signifie pas nécessairement l’abandon de la cause défendue, puisqu’il existe encore des mouvements sociaux actifs au sein de certaines sociétés malgré le fait qu’ils puissent être mis en veilleuse.
4.3 Les organisations
Dans les sections précédentes, nous avons abordé l’engagement social sous l’angle des individus et des groupes organisés. Cette section sera consacrée à l’engagement social des organismes dont la mission première consiste à offrir des services sociaux, tels que des OBNL, ainsi qu’à ceux dont l’engagement sociétal est une mission secondaire, comme des entreprises ou des universités.
4.3.1 L’engagement social comme mission première
Plusieurs organismes à l’échelle locale, nationale, régionale ou mondiale ont pour but de répondre aux besoins sociétaux dans leur domaine d’activité. Les organismes qui ont comme mission première l’offre des services sociaux sont pour la plupart des organismes qui n’aspirent pas à faire des bénéfices ou qui ne visent pas la création de richesse pour des actionnaires, d’où l’appellation organismes à but non lucratif (OBNL). Ce sont des organismes présents dans divers domaines économiques et communautaires et qui travaillent pour le mieux-être de leur communauté ou de leur collectivité. Pour leur gouvernance et l’exécution de leurs activités, les OBNL peuvent compter sur plusieurs parties prenantes, notamment les partenaires financiers privés et publics, dont les gouvernements, mais aussi les bénévoles. Le gouvernement du Québec définit les OBNL de la façon suivante :
Une personne morale sans but lucratif, aussi appelée « organisme sans but lucratif (OSBL) » ou « organisme à but non lucratif (OBNL) » est un groupement de personnes physiques qui poursuivent un but à caractère moral ou altruiste et qui n’ont pas l’intention de faire des gains pécuniaires à partager entre les membres. Une telle personne morale est une entité juridique distincte. À ce titre, elle détient des droits et des obligations qui lui sont propres. Une personne morale sans but lucratif exerce des activités sans but lucratif dans les domaines culturel, social, philanthropique, national, patriotique, religieux, charitable, scientifique, artistique, professionnel, athlétique, sportif, éducatif ou autres.
Une personne morale sans but lucratif;
-
- a une existence distincte de celle de ses membres;
- possède des biens en son nom propre;
- a des droits et assume des obligations ainsi que des responsabilités;
- signe des contrats par l’entremise de ses administrateurs;
- peut intenter des poursuites ou être poursuivie au même titre qu’une personne physique. (Gouvernement du Québec, 2024, paragr. 1-3)
La plupart de ces organismes dépendent fortement de l’engagement actif de leurs parties prenantes, qu’il s’agisse des subventions obtenues auprès de sources privées et publiques, ou du temps accordé par les bénévoles. Il existe différents types d’OBNL : les organismes communautaires, les fondations, les organismes culturels, les organismes de protection de l’environnement, les associations, les syndicats, les fédérations, les chambres de commerce, les ordres professionnels, etc. Ces OBNL sont dirigés par un conseil d’administration exclusivement composé de bénévoles. Une caractéristique distinctive des OBNL est la manière dont ils gèrent leurs excédents budgétaires. Ces derniers doivent être réinvestis directement dans les opérations internes, évitant ainsi toute utilisation personnelle par les dirigeants, les dirigeantes ou les membres.
Un OBNL peut obtenir le statut d’organisme de bienfaisance enregistré pour émettre des reçus fiscaux officiels pour les dons. Selon le gouvernement du Canada (2016) :
Un organisme de bienfaisance enregistré est une œuvre de bienfaisance, une fondation publique ou une fondation privée qui est créée et qui réside au Canada. L’organisme doit consacrer ses ressources à des activités de bienfaisance et avoir des fins de bienfaisance qui visent l’une ou plusieurs des catégories suivantes : le soulagement de la pauvreté, l’avancement de l’éducation, l’avancement de la religion ou d’autres fins profitant à la collectivité. (2e paragr.)
Les OBNL ont démontré leur importance dans la vie sociale et économique des différents échelons de la société. Pour Cloutier (2011), ces organismes jouent :
un rôle primordial dans la qualité de vie des populations en offrant une panoplie de services dans divers secteurs (tels que ceux de la santé, des sports et loisirs, de l’éducation ou de la culture); en proposant de nouvelles façons de faire souvent en amont de programmes gouvernementaux; en veillant à la protection et au respect des droits humains; ou encore, en sonnant l’alarme au sujet de pratiques (organisationnelles, gouvernementales ou autres) pouvant nuire au bien-être de la société. (p. 86)
Les organismes jouent un rôle prépondérant dans la prestation de services sociaux aux communautés, tout en favorisant leur développement social et économique. Grâce à leurs bénévoles, ces organismes entrent directement en contact avec les bénéficiaires de leurs services pour favoriser leur mieux-être. En raison de leur mission, ces organismes contribuent au changement des conditions de vie de nombreuses personnes. Cette implication directe des organismes dans les changements sociaux en fait des acteurs essentiels dans le développement individuel et collectif non seulement des bénéficiaires, mais également des bénévoles qu’ils emploient.
Les OBNL sont pour les bénévoles des espaces d’expression de leur engagement social et de leur participation citoyenne. Que ce soit par un don d’argent, d’expertise, de temps, de notoriété ou encore de biens, les bénévoles jouent un rôle crucial dans le filet social. En outre, les OBNL sont des lieux d’apprentissage de l’engagement et de la solidarité sociale, ainsi que de la participation citoyenne. Pour les donateurs, ils ont la certitude que leurs dons seront directement versés aux bénéficiaires. Les répercussions des OBNL sur la société restent donc indéniables, notamment dans les milieux défavorisés.
L’engagement social des organisations qui ont pour mission première l’offre des services sociaux dans un but non lucratif favorise l’engagement individuel et collectif des bénévoles, des donateurs, mais aussi des bénéficiaires. Les activités des OBNL dans les communautés facilitent l’implication de la population, qui peut ainsi s’organiser collectivement et apporter elle-même des solutions aux problèmes qui lui sont propres. Les communautés deviennent alors des parties prenantes de leur propre développement social et même économique. Les OBNL contribuent donc à l’autonomie des communautés en leur apportant les outils nécessaires pour résoudre les problèmes auxquels ils sont confrontés. Ces organismes poursuivent leur mission sociale en favorisant la transformation des communautés et de leurs membres.
L’une des particularités du modèle québécois est la promotion des actions communautaires autonomes. Ces dernières se distinguent des autres OBNL sur plusieurs points, dont le fait que leur création soit le fruit de « l’initiative des citoyens et citoyennes ou des communautés dans une perspective de prise en charge individuelle et collective visant la transformation des conditions de vie et le respect des droits » (Réseau québécois de l’action communautaire autonome, 2024). La notion d’autonomie trouve tout son sens, car ce sont des organismes qui bénéficient d’une pleine liberté dans la définition de leur mission, de leurs orientations, de leurs approches d’intervention, de leurs pratiques et de leurs modes de gestion. L’une des forces des organismes communautaires autonomes est l’implication des personnes touchées par un enjeu social dans la recherche de solutions en leur offrant un soutien à travers une multitude d’activités. Cela contribue au développement de leur potentiel et leur donne une voie dans la prise de décisions. Son ancrage et son enracinement dans la communauté font de l’action communautaire autonome un mouvement social efficient dans l’amélioration du tissu social et du mieux-être des personnes.
Les OBNL se retrouvent à la fois à l’échelle locale, nationale et internationale. Des organismes internationaux comme l’UNICEF (Fonds des Nations unies pour l’enfance), l’UNESCO (Organisation des Nations unies pour l’éducation, la science et la culture), le PNUD (Programme des Nations unies pour le développement), le HCR (Haut-Commissariat des Nations unies pour les réfugiés) ou encore le HCDH (Haut-Commissariat des Nations unies aux droits de l’homme) s’efforcent d’améliorer les conditions de vie des communautés à travers le monde. Parmi les donateurs et donatrices des organismes communautaires, nationaux ou internationaux, on compte de plus en plus d’entreprises privées qui prennent davantage à cœur leur responsabilité sociale dans les collectivités.
4.3.2 L’engagement social comme mission secondaire
Bien que leur mission première soit de générer des dividendes au bénéfice de leurs actionnaires, les entreprises prisées (ou celles qui sont gérées de la même manière, comme les universités ou les établissements scolaires) s’engagent dans des causes sociales ou des projets de changement social au bénéfice des communautés. À l’intersection du monde économique et de la société, on retrouve plusieurs problèmes et enjeux auxquels sont confrontées les communautés : le chômage, la détérioration des conditions de vie, la hausse du coût des produits de première nécessité, les changements climatiques, diverses formes de discrimination sur le marché du travail, etc. Autant de problèmes sociaux dont la responsabilité incombe directement ou indirectement aux entreprises. Face à la mauvaise image que les entreprises ont auprès du public concernant leur engagement dans les questions sociales, il semble y avoir un éveil de la prise de conscience quant à leur responsabilité sociale. La responsabilité sociale des entreprises (RSE) est une approche managériale permettant aux entreprises d’intégrer les enjeux sociaux et environnementaux auxquels sont confrontées toutes les parties prenantes, qu’elles soient directes ou indirectes, dans leur stratégie de développement. Pour l’ISO 26000:2010, la RSE se définit comme suit :
Responsabilité d’une organisation vis-à-vis des impacts de ses décisions et de ses activités sur la société et sur l’environnement, se traduisant par un comportement éthique et transparent qui : contribue au développement durable, y compris à la santé et au bien-être de la société; prend en compte les attentes des parties prenantes; respecte les lois en vigueur tout en étant en cohérence avec les normes internationales de comportement; est intégré dans l’ensemble de l’organisation et mis en œuvre dans ses relations. (Organisation internationale de normalisation, 2021, article 2.18)
En l’absence d’une définition exhaustive et unanimement acceptée de la RSE, Cherkaoui et Bennisbennani (2015) ont mis en évidence neuf aspects clés pour la définir :
- la RSE est une démarche volontaire qui va au-delà des obligations légales vers des normes de comportement;
- la RSE est une affaire de tous les partenaires de l’entreprise dans une perspective participative et inclusive de l’ensemble de ses parties prenantes;
- la RSE est un facteur clé de la performance en ce sens qu’elle intègre et implique l’ensemble des groupes qui se trouvent en relation directe ou indirecte avec son activité;
- la RSE est une démarche à vocation éthique dans la mesure où elle n’apparaît qu’à travers un véritable questionnement éthique des répercussions des activités de l’entreprise sur son environnement;
- la RSE repose sur la transparence et la bonne gouvernance partenariale;
- la RSE ne se confond pas aux obligations légales puisqu’elle ne se résume pas en une simple conformité sociale;
- la RSE est un processus d’engagement, c’est-à-dire tout un ensemble d’actions qui s’intègrent dans la stratégie globale de l’entreprise. Il s’agit aussi d’une démarche évolutive;
- la RSE ne doit pas se présenter comme une simple intention de prévention et/ou de réparation dans la mesure où l’entreprise est interpellée à adopter un véritable management stratégique proactif de la RSE;
- la RSE est une démarche transversale qui s’intègre dans le fonctionnement régulier de l’entreprise. (p.7)
La RSE est un processus d’engagement social qui incite les entreprises à assumer une responsabilité envers la société en général et envers le milieu où elles sont implantées. Cet engagement ne se limite pas uniquement à la philanthropie encore moins au mécénat, mais va au-delà du don d’argent. L’engagement sociétal de l’entreprise peut prendre plusieurs formes allant d’un simple soutien financier et d’expertise des OBNL du territoire à l’ajout des intérêts du territoire dans les plans d’action. Certaines entreprises vont même jusqu’à mettre sur pied un département dédié exclusivement au travail social, chargé d’aborder les questions liées à leur responsabilité sociale. Ce dernier se charge notamment d’aller à la rencontre de la population locale pour connaître ses problématiques sociales. Dans ce sens, les entreprises nouent des partenariats avec les organismes communautaires afin de mieux comprendre les besoins des populations de leurs communautés locales et les mesures qu’elles peuvent prendre pour contribuer à leur mieux-être. La recherche conjointe de solutions entre l’entreprise et les populations concernées demeure une des meilleures stratégies d’engagement social des entreprises. Dans certaines régions, les entreprises font partie intégrante des organismes ou des creusets regroupant toutes les parties prenantes de l’engagement social. Bien que la responsabilité sociale soit propre à chaque entreprise, travailler en partenariat avec d’autres entreprises, des OBNL, des collectivités locales, des organismes publics, etc., permet d’apporter aux communautés des solutions plus efficaces et plus durables pour répondre à leurs besoins.
Les entreprises adoptent une autre forme d’action concrète dans le cadre de leur engagement social en encourageant l’engagement de leur personnel et parfois même de leurs clients. Plusieurs entreprises mettent en place des stratégies pour faciliter le bénévolat de leurs employés et employées au sein d’organismes communautaires ou lorsque ceux-ci sont porteurs d’initiatives sociales au sein ou en dehors de l’entreprise. Comme stratégies, on peut par exemple penser au paiement du temps qu’un salarié consacre à une cause sociale, à la possibilité pour ce dernier d’utiliser différentes ressources de l’entreprise dans son implication dans cette cause, ou encore à l’incitation à faire des dons (d’argent, d’expertise, de biens, de notoriété, etc.) à des organismes communautaires. Le bénévolat appuyé par l’employeur peut s’avérer bénéfique à la fois pour l’entreprise et pour le personnel, en plus d’avoir des effets positifs sur toutes les autres parties impliquées, y compris les bénéficiaires. Selon Bénévoles Canada (2020), lorsqu’une entreprise s’engage à appuyer les efforts bénévoles de ses employés, elle fait un investissement important sur le plan du moral de ses employés, du recrutement de personnes talentueuses et de son résultat net. En outre, il y a moins de rotation du personnel. Les recherches démontrent que plus de 80 % des bénévoles appuyés par leur employeur croient qu’une expérience de bénévolat collective peut améliorer leurs relations avec leurs collègues. Aussi, le bénévolat les aide à acquérir de nouvelles compétences. (2e paragr.)
Pour répondre aux enjeux environnementaux et aux besoins de la population de leur région, les entreprises adaptent leurs produits ou leur communication. Par exemple, la réduction de leurs émissions de gaz à effet de serre contribue à lutter contre le réchauffement climatique, mais également à diminuer les maladies possiblement créées par un environnement toxique. La création de produits plus écologiques et l’abandon de l’utilisation des sacs plastiques constituent d’autres exemples d’actions sociales des entreprises. Cependant, certaines entreprises utilisent ces pratiques pour se donner une image plus verte, ce qu’on appelle l’écoblanchiment. Cette pratique, aussi appelée greenwashing est un ensemble de pratiques de communications ou de marketing trompeuses utilisées par une entreprise ou une organisation qui cherche à montrer une image positive de responsabilité sociale et écologique (Cordelier, 2020). Cette pratique peut se manifester sous différentes formes, notamment au moyen de publicités mensongères visant à inciter les consommateurs à acheter un produit.
L’engagement social des entreprises consiste à intégrer dans les pratiques d’affaires et les relations de travail avec leur personnel et leur clientèle les principes des droits de la personne, de l’équité et de la justice sociale ainsi qu’à offrir des conditions de travail optimales. De plus en plus d’entreprises, dans leurs offres d’emploi, sollicitent les candidatures des membres issus de minorités visibles et ethniques, de personnes en situation de handicap, de femmes ou encore de personnes autochtones. Cette pratique vise à favoriser l’équité, la diversité et l’inclusion, tout en veillant à ce que tous les employés et employées puissent évoluer dans un milieu de travail inclusif. D’autres mesures de discrimination positive sont mises en place pour favoriser l’égalité dans l’accès aux emplois et l’équité salariale au sein des entreprises. En outre, toutes ces causes sociales dans lesquelles s’engagent les entreprises en leur sein et dans leur communauté à travers des pratiques d’actions directes rendent plus efficace leur engagement social.
La philanthropie d’entreprise est un aspect clé de la stratégie RSE. Elle est définie comme un transfert volontaire, stratégique ou non, des ressources de l’entreprise (par exemple, liquidités, actifs, bénévolat, etc.) au profit de la société (Sharma, 2021). Faisant partie intégrante de la démarche RSE, la philanthropie d’entreprise vise à améliorer le mieux-être des communautés locales, tout en renforçant la position stratégique de l’entreprise et ses bénéfices. On parle dans ce cas d’une philanthropie stratégique et intéressée, car le but de l’entreprise est de faire des gains pour elle-même. Au-delà de l’engagement envers le mieux-être des collectivités, la philanthropie sert également de levier marketing pour attirer davantage de clients, par conséquent, ses résultats (Gautier et Pache, 2015). Pour optimiser la gestion de leurs contributions, certaines sociétés ont même mis sur pied des fondations. Les fondations d’entreprise sont des OBNL dont le but est la réalisation d’une œuvre d’intérêt général, notamment en ce qui concerne la responsabilité sociétale des entreprises.
Peu importe sa forme, l’engagement social d’une entreprise peut influencer toutes les parties prenantes. D’abord, les actions sociales menées par les entreprises ont des répercussions positives sur le mieux-être de la communauté. Grâce à son implication sociale, l’entreprise cherche à s’attaquer aux enjeux sociaux auxquels sont confrontées les populations locales vivant dans le territoire où elle est établie. De plus, les actions entreprises dans le cadre de la responsabilité sociale d’une entreprise peuvent contribuer à son succès économique et profiter aux actionnaires. Les attitudes de la réelle clientèle de l’entreprise peuvent se transformer positivement lorsqu’elle constate les initiatives sociales mises en place par celle-ci et les bénéfices qu’elle en tire également. Cela peut aussi influencer les choix des potentiels consommateurs et consommatrices et leur perception de l’entreprise. Finalement, l’engagement social de l’entreprise peut aussi influencer les membres du personnel, notamment en ce qui a trait à leur mieux-être au travail et à leur participation aux processus décisionnels en tant que partie prenante principale de la RSE. Le fait que les employés et employées soient conscients que leur employeur s’engage dans des causes sociales, qu’il prône la justice sociale et qu’il défende d’autres valeurs humaines peut créer chez eux un sentiment d’appartenance. La RSE peut même devenir un critère de sélection pour une personne à la recherche d’un nouvel emploi.
4.4 L’écosystème de l’engagement social
L’engagement des personnes, des groupes et des organisations ne s’accomplit pas en circuit fermé. Il est intéressant de considérer ces entités comme des acteurs interagissant au sein d’un même écosystème de l’engagement social. Ce faisant, rappelons que le terme « social » dans le concept d’engagement social réfère à la nature de l’engagement social. Un tel écosystème de l’engagement social peut être défini de la façon suivante : un ensemble de personnes, de groupes, d’organisations et d’institutions publiques qui entretiennent des relations complexes autour de centres d’intérêt ou de lieux communs.
4.4.1 La construction d’un écosystème de l’engagement social
Comment l’espace public s’approprie-t-il les enjeux sociétaux? Selon la théorie de l’interdépendance entre l’État et les organisations à but non lucratif (Nyssens, 2008), cela se produit en réponse à une demande sociale ou à un problème social qui n’est pas résolu par les institutions. Mais qu’est-ce qu’un problème social? Selon l’éclairage apporté par Mayer et Laforest (1990), on peut définir un problème social comme suit : « il y a problème lorsqu’un grand nombre de personnes sont affectées par une situation donnée, que cette situation est jugée intolérable, et que les gens sont conscients de la nécessité d’une action collective » (p.16).
En d’autres termes, l’écosystème de l’engagement social évolue et se façonne en fonction des enjeux sociaux, des problématiques sociales qui sont perçues comme importantes par une partie de la population, d’une société ou d’un territoire donné. Cet écosystème se nourrit, s’articule et se transforme en fonction des mouvements sociaux, de la prise de conscience de besoins sociaux et de la nécessité d’y répondre collectivement. Comme l’exprime Bernoux (2008), « C’est la conscience de l’intérêt commun qui est le déclencheur de l’action collective » (p. 57).
À partir de la théorie des champs de Pierre Bourdieu (Fringant, 2023), nous pouvons comprendre la structure de l’écosystème de l’engagement social. Il définit le concept de champ comme « un espace social relativement autonome à l’égard du macrocosme global dans lequel il s’inscrit, et structuré par la distribution des différentes espèces de capitaux (économique, culturel, social) entre les agents qui l’occupent et luttent pour le conserver ou le transformer. » (p. 267). Chaque champ possède un enjeu qui lui est propre et dans le cas de l’engagement social, l’enjeu est de répondre à un problème social.
4.4.2 Les principales composantes de l’écosystème
Les catégories mentionnées précédemment dans ce chapitre interagissent entre elles au sein de l’écosystème comme le présente la figure 4.2 : les composantes de l’écosystème, 1) les personnes et les groupes 2) les organisations dont l’engagement social est la mission première et leurs bénéficiaires ainsi que 3) les organisations dont l’engagement social est une mission secondaire. À ces acteurs de l’engagement social s’ajoutent 4) les institutions publiques qui interagissent elles aussi avec les autres composantes de l’écosystème de l’engagement social.
Figure 4.2 Les composantes de l’écosystème

Les institutions publiques
Bien qu’elles ne soient pas nécessairement la source du qui de l’engagement social selon sa définition, les institutions publiques jouent néanmoins un rôle important dans l’écosystème de celui-ci. Elles interagissent avec chacune de ses parties prenantes, notamment en offrant un cadre juridique, réglementaire et fiscal à l’écosystème. Les institutions publiques interviennent également dans l’écosystème par leur capacité de dépenser, notamment en subventionnant des organisations dont la mission première est l’engagement social.
L’écosystème de l’engagement social offre aux institutions publiques la possibilité de déléguer une partie de leurs responsabilités aux organisations. Cependant, en s’associant étroitement avec le secteur public, ces derniers peuvent se retrouver confrontés à un ensemble de tensions et de contradictions (Hamidi, 2017). En effet, les objectifs et les moyens privilégiés par les gouvernements ne correspondent pas nécessairement aux valeurs et aux approches défendues par les organisations. De plus, ce partage des responsabilités peut parfois correspondre à une déresponsabilisation des institutions publiques.
En retour, les parties prenantes peuvent elles aussi influencer les institutions publiques.
Lorsque les personnes engagées agissent pour changer les choses, puisque leurs manières de penser et leurs valeurs sont généralement avant-gardistes (sans être trop éloignées) sur la vision des institutions publiques, leurs idées sont souvent récupérées afin d’améliorer le cadre institutionnel.
Dominique Morin, professeur titulaire, Faculté des sciences sociales, Université Laval, 2022
L’écosystème de l’engagement social possède une capacité de transformation, qui se manifeste par un processus complexe de réorganisation et de modernisation des institutions et des politiques publiques. Il contribue ainsi à l’émergence de nouveaux paradigmes. La tension qui traverse les organisations, les groupes et les personnes entre autonomie, contre-pouvoir et institutionnalisation est à la fois structurelle et dynamique. Elle permet de revisiter les méthodes d’engagement et d’intervention de la société civile et de servir de fondement à leur rajeunissement (Bacqué, 2005).
Les interactions entre les parties prenantes de l’écosystème
Les interactions entre les parties prenantes de l’écosystème sont nombreuses. À titre d’exemple, les organisations dont l’engagement social est la mission première dépendent de l’engagement social des personnes et des groupes, des organisations et des bénévoles qui composent le conseil d’administration, ainsi que des contributions financières d’autres organisations.
L’écosystème immédiat de Centraide est d’abord composé des personnes donatrices et des entreprises qui organisent des campagnes de financement en milieu de travail. Les fonds sont ensuite redistribués à des organismes communautaires, sur recommandation de comités de bénévoles qui effectuent une analyse approfondie des besoins de chaque communauté et de chaque organisme pour investir les sommes là où le besoin est le plus grand. Pour nous, cet écosystème est extrêmement précieux, riche et vibrant.
Nancy Charland, vice-présidente au développement social, Centraide Québec et Chaudière-Appalaches, 2022
La matrice du tableau 4.1 présente quelques exemples des interactions possibles entre les composantes de l’écosystème.
Tableau 4.1 Exemples d’interactions entre les composantes de l’écosystème
| Composantes | Vers les : | |||
| Des : | Organisations dont l’engagement social est la mission première et leurs bénéficiaires | Personnes et groupes | Organisations où l’engagement social est une mission secondaire | Institutions publiques |
| Organisations dont l’engagement social est la mission première et leurs bénéficiaires | Collaborent autour de causes communes. | Leur offrent un moyen d’engagement | Leur offrent un moyen d’engagement | Appuient les responsabilités des institutions à l’égard de causes précises |
| Personnes et groupes | Consacrent temps, expertise, argent, biens et notoriété | S’engagent ensemble | Contribuent à la responsabilité sociale de leur employeur | Contribuent à leur financement par la fiscalité |
| Organisations dont l’engagement social est une mission secondaire | Consacrent temps, expertise, argent, biens et notoriété | Appuient l’engagement de leur personnel | S’engagent ensemble | Contribuent à leur financement par la fiscalité |
| Institutions publiques | Contribuent à leur financement par des subventions | Soutiennent leur engagement par le régime fiscal | Soutiennent leur engagement par le régime fiscal | Se coordonnent par un partage de compétences et des revenus fiscaux |
Il est important de noter que les relations entre les différentes parties prenantes ne sont pas toujours axées sur la collaboration. En effet, le milieu de l’engagement social est également un terrain propice aux conflits de valeurs, de pouvoirs et d’intérêts. Ces luttes peuvent aussi être d’ordre politique et économique. Comme le précise Laville (2001), « sous la perspective d’un secteur de réciprocité, pointe une mythification des associations[1] comme lieux de la réalisation de soi ou de l’entraide mutuelle qui élude la réflexion sur les phénomènes de pouvoir et les relations d’intérêt. L’absence de course au profit n’exclut pas la course au pouvoir, les stratégies personnelles, les comportements bureaucratiques ou autoritaires. » (p. 72) De plus, il est possible que le point de vue d’une personne engagée soit trop avant-gardiste, comparativement à celui des autres personnes ou à celui porté par les organisations et les institutions publiques, et ce, parfois même au sein de l’écosystème de l’engagement social.
Parfois, les pratiques adoptées afin de créer le changement peuvent heurter les convictions des personnes. Ainsi, certaines personnes engagées peuvent se retrouver en marge de la société, à contre-courant. Le défi de l’engagement social réside justement dans cette pratique : jusqu’où un individu est-il prêt à s’engager pour toucher un large public, tout en restant fidèle à ses principes et en maintenant un niveau élevé d’engagement? Les relations sociales peuvent souvent donner lieu à des conflits, car elles ne sont pas toujours consensuelles. Cela peut amener une personne à remettre en question son engagement, ses limites et les décisions à prendre pour mener à bien une cause.
Dominique Morin, professeur titulaire, Faculté des sciences sociales, Université Laval, 2022
Nous vivons dans une société où dominent les ambitions personnelles, les injonctions de performance et l’individualisme. S’engager implique donc d’aller à contre-courant. Un risque sous-jacent à l’engagement dans un tel monde est de vouloir compenser l’inaction d’autrui. Mon conseil consiste plutôt à créer des îlots sains autour de soi, à aider les personnes mûres à cheminer et à poser des actions qui ont du sens pour soi.
Charles Baron, professeur titulaire, Faculté des sciences de l’administration, 2022
Conclusion
En conclusion, ce chapitre a exploré les multiples facettes de l’engagement social à travers trois entités fondamentales : les personnes, les groupes et les organisations. Nous avons vu que l’engagement peut prendre des formes variées, allant de l’action individuelle à l’action collective au sein de groupes organisés, en passant par la mobilisation de mouvements sociaux ainsi que par l’action structurée d’organisations dont la mission première ou secondaire est l’engagement social. Il est essentiel de retenir que ces différentes formes d’engagement ne sont pas isolées, mais interagissent au sein d’un écosystème complexe. L’action d’une personne peut initier ou rejoindre un groupe, un groupe peut se formaliser en organisation, et les organisations dépendent de l’engagement des personnes.
Questions de réflexion
- En m’appuyant sur des exemples tirés de mon expérience, mon engagement dans ma communauté se fait-il de façon individuelle, dans un groupe ou dans une organisation ? Pour quelles raisons est-ce que je préfère cette forme d’engagement ?
- Ma façon de m’engager socialement est-elle influencée par l’appartenance à un groupe social engagé ou la participation à un mouvement social ? De quelle façon?
- De quelle façon mon engagement social s’inscrit-il dans une interaction entre les composantes de l’écosystème (voir figure 4.2)?
Bibliographie
Aberle, D. F., Moore, H. C. et Johnson, D. F. (1966). The Peyote Religion Among the Navaho. Aldine Pub. Co.
Adiceom, F. et Scaon, S. (2012). Tension entre individu et collectif : quel équilibre? Revue internationale de soins palliatifs, 27(1), 27-31. https://doi.org/10.3917/inka.121.0027
Bacqué, M-H. (2005). Action collective, institutionnalisation et contre-pouvoir : action associative et communautaire à Paris et à Montréal. Espaces et sociétés, 123(4), 69-84. https://doi.org/10.3917/esp.123.0069
Bénévoles Canada. (2020). Mobilisation des bénévoles – Bénévole appuyé par l’employeur. https://members.volunteer.ca/index.php?MenuItemID=345&lang=fr
Bernoux, P. (2008). De la sociologie des organisations à la sociologie des associations. Dans C. Hoarau et J. Laville (dirs.), La gouvernance des associations : Économie, sociologie, gestion (p.53-72). Érès. https://doi.org/10.3917/eres.lavil.2008.01.0053
Blumer, H. (1969). Symbolic Interactionism : Perspective and Method. Prentice-Hall.
Bodart, Y. (2018). Les phénomènes de groupe. Les Cahiers Internationaux de Psychologie Sociale, 117-118(1), 119-146. https://doi.org/10.3917/cips.117.0119
Cherkaoui, A. et Bennisbennani, Y. (2015). La responsabilité sociétale des entreprises : un concept controversé. Revue Économie, Gestion et Société, (3). https://doi.org/10.48382/IMIST.PRSM/regs-v0i3.4172
Cloutier, C. (2011). Les organismes à but non lucratif : comment mieux gérer les relations avec les donateurs? Gestion, 36(4), 85-94. https://doi.org/10.3917/riges.364.0085
Cordelier, B. (2020). Greenwashing ou écoblanchiment : Cadrer la communication environnementale. Sens-Dessous, 26(2), 21-32. https://doi.org/10.3917/sdes.026.0021
Dumont, L. (1983). Essais sur l’individualisme. Une perspective anthropologique sur l’individualisme moderne. Éditions du Seuil.
Ennuyer, B. (2016). Individu et société : le lien social en question? Ethics, Medicine and Public Health, 2(4), 574-583. https://dx.doi.org/10.1016/j.jemep.2016.10.003
Fillieule, O. (2009). De l’objet de la définition à la définition de l’objet. De quoi traite finalement la sociologie des mouvements sociaux? Politique et Sociétés, 28(1), 15-36. https://doi.org/10.7202/001723ar
Fischer, G. (2020). Les concepts fondamentaux de la psychologie sociale (6e éd.). Dunod. https://doi.org/10.3917/dunod.fisch.2020.01
Fringant, M. (2023). Pierre BOURDIEU, Microcosmes. Théorie des champs. Revue européenne des sciences sociales, 61(1), 266-270. https://doi.org/10.4000/ress.8849
Gautier, A. et Pache, A-C. (2015). Research on corporate philanthropy: A review and assessment. Journal of Business Ethics, 126, 343-369. https://doi.org/10.1007/s10551-013-1969-7
Gouvernement du Canada. (2016). Quelle est la différence entre un organisme de bienfaisance enregistré et un organisme sans but lucratif? https://www.canada.ca/fr/agence-revenu/services/organismes-bienfaisance-dons/a-propos-organismes-bienfaisance-enregistres/quelle-est-difference-entre-organisme-bienfaisance-enregistre-organisme-sans-lucratif.html
Gouvernement du Québec. (2024). Constituer une personne morale sans but lucratif. https://www.quebec.ca/entreprises-et-travailleurs-autonomes/demarrer-entreprise/immatriculer-constituer-entreprise/immatriculer-constituer-entreprise-formes-juridiques/personne-morale-sans-but-lucratif
Hamidi, C. (2017). Chapitre 13 – Associations, politisation et action publique : Un monde en tensions. Dans O. Fillieule, F. Haegel, C. Hamidi et V. Tiberj (dirs.), Sociologie plurielle des comportements politiques : Je vote, tu contestes, elle cherche… (p. 347-370). Presses de Sciences Po. https://doi.org/10.3917/scpo.filli.2017.01.0347
Laville, J-L. (2001). 3. Les raisons d’être des associations. Dans : J-L. Laville, A. Caillé et P. Chanial (dirs.), Association, démocratie et société civile (p. 61-140). La Découverte. Maisonneuve, J. (1980). La dynamique des groupes – Que sais-je?. Presses Universitaires de France.
Mayer, N. (2023). Sociologie des comportements politiques. Armand Colin.
Mayer, R. et Laforest, M. (1990). Problème social : le concept et les principales écoles théoriques. Service social, 39(2), 13-43. https://doi.org/10.7202/706475ar
Neveu, E. (2019). Sociologie des mouvements sociaux (7e éd.). La découverte.
Nyssens, M. (2008). Les analyses économiques des associations. Dans C. Hoarau (dir.), La gouvernance des associations : Économie, sociologie, gestion (p. 27-51). Érès.
Organisation internationale de normalisation (ISO). (2021). ISO 2600:2010 – Lignes directrices relatives à la responsabilité sociétale (2010, révisée en 2021). https://www.iso.org/obp/ui/fr/#iso:std:iso:26000:ed-1:v1:fr
Passy, F. (1998). L’action altruiste. Librairie Droz. https://shs.cairn.info/l-action-altruiste–9782600003032-page-57?lang=fr
Paugam, S. (2022). Introduction. Le lien social, Presses universitaires de France.
Paul, M. (2020). La démarche d’accompagnement : Repères méthodologiques et ressources théoriques (2e éd.). De Boeck Supérieur.
Sharma, P. Y. P. (2021). Corporate philanthropy: A systematic review. Paper 188. https://scholar.uwindsor.ca/major-papers/188
Réseau québécois de l’action communautaire autonome. (2024, 15 juillet). Qu’est-ce que l’ACA? https://rq-aca.org/aca/#:~:text=L’action%20communautaire%20autonome%20est%20un%20mouvement%20issu%20de%20la,et%20le%20respect%20des%20droits
Schütz, A. (1967). La phénoménologie du monde social. Nortwestern University Press.
Tilly, C. (1978). From Mobilization to Revolution. Addison-Wesley.
Tilly, C. et Tarrow, S. (2008). Politique(s) du conflit : De la grève à la révolution. Presses de Sciences Po.
[1] Terme désignant les organismes à but non lucratif en France