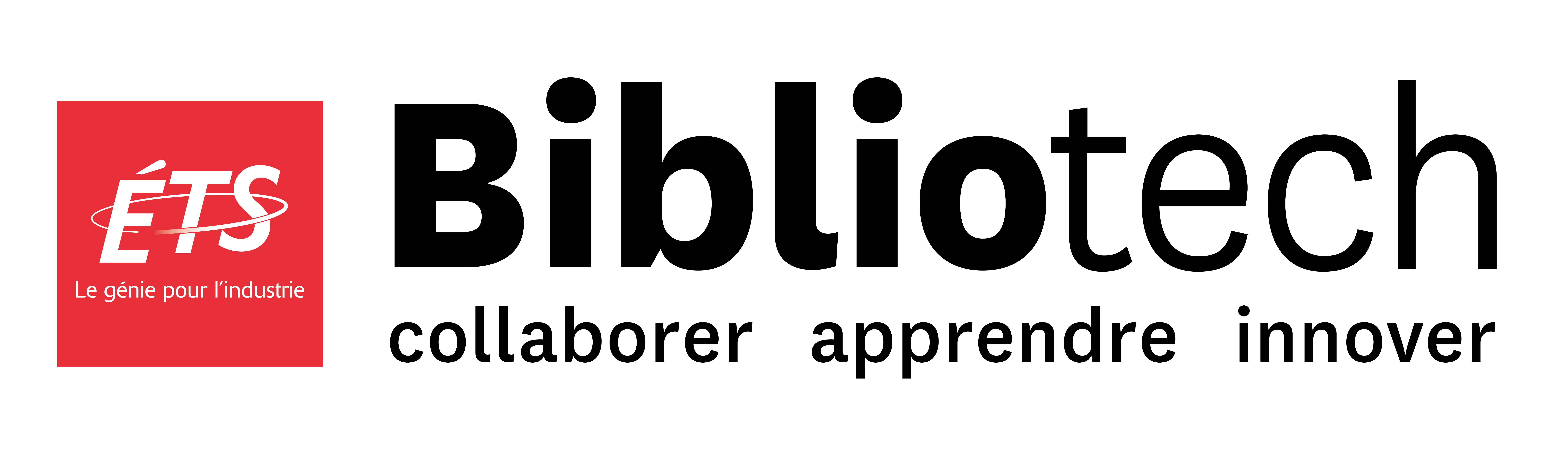Chapitre 3: COMMENT
Luc K. Audebrand; Patrice C. Ahehehinnou; et Gabriel Huot
Introduction
S’engager, c’est avant tout consacrer une partie de soi ou de ce que l’on possède au service d’une cause à laquelle on adhère. C’est, notamment, consacrer un peu de son temps, de son expertise, de son argent, de ses biens et de sa notoriété afin de contribuer au mieux-être de nos proches, de la communauté, de l’humanité ou de la vie sur Terre. Après avoir exposé, dans le chapitre 1, les raisons et les motivations (le « pourquoi ») de l’engagement social, ainsi que, dans le chapitre 2, les objectifs visés (le « pour quoi » ou « pour qui ») et pour qui les gens s’engagent, nous aborderons, dans ce chapitre, les diverses manières de s’engager (le « comment »).
3.1 La notion de « don »
Il est important de souligner que l’engagement social n’est pas nécessairement un don au sens strict du terme. Cela étant dit, cette notion demeure incontournable lorsqu’il est question d’engagement social et ce chapitre en aborde plusieurs déclinaisons.
Pour bien comprendre ce qui caractérise le don, Mahieu (2020) en évoque la nature pure et parfaite. La pureté du don, selon cet auteur, réside dans le fait qu’il est un geste gratuit et sans retour, définitif, mais également parce qu’il est libre en ce qui concerne son objet et son destinataire. Mahieu (2020) indique que le don pur est un acte autonome dont les seules motivations se trouvent dans la réalisation de l’acte lui-même. En d’autres termes, la seule raison qui pousse une personne à donner réside dans la satisfaction qu’elle tire juste du fait d’avoir donné. Un don est pur également lorsque la personne qui donne est autonome et agit sans aucune pression externe. Ainsi, le don pur est volontaire.
Un don est parfait, selon Mahieu (2020), lorsqu’il n’est pas empoisonné, c’est-à-dire qu’il n’est pas personnalisé par le donneur afin de dévaloriser le receveur ou d’avoir du pouvoir sur lui. Un don qui n’incarne pas une attitude malveillante est parfait. Mahieu (2020) présente deux caractéristiques du don parfait, soit « équiprobabilité », qui signifie que toute personne peut en être bénéficiaire, et « librement accepté et optimal », qui veut dire que « le don n’est pas imposé ni l’expression d’une ingérence. Ce don ne brave pas une interdiction de donner et n’implique pas une obligation de recevoir » (Mahieu, 2020, p. 70). Les caractéristiques du don pur sont liées au donateur et celles du don parfait au receveur.
Prenons l’exemple d’une entreprise manufacturière qui fait un don à un organisme de lutte contre le cancer. Cette entreprise fait un don sans restriction (voir section 3.4) et ne demande pas en contrepartie une visibilité qui transformerait ce don en une commandite. Certains dons visent à appuyer les stratégies d’affaires d’une organisation (p. ex. une entreprise finançant la recherche dans un domaine directement lié à son secteur d’affaires), mais, dans cet exemple, tout porte à croire qu’il n’y a pas de lien entre la cause et l’entreprise en question. Ce don pourrait donc être considéré comme parfait puisque son seul objectif réside dans l’accomplissement de l’acte en lui-même (il vise à faire un don et non à appuyer une stratégie d’entreprise). Ce don pourrait également être considéré comme pur, puisqu’il est sans restriction, il ne vise pas, à titre d’exemple, à créer un projet sur mesure dont l’évolution est dictée par l’entreprise.
Il est intéressant de mettre en relation la conceptualisation du don proposée par Mahieu (2020) avec d’autres perspectives présentées dans ce livre. Tout d’abord, la pureté du don, telle que définie par l’auteur, s’aligne sur le caractère volontaire de l’engagement social. Il y a toutefois lieu de souligner que les points de vue adoptés dans ce livre offrent une possibilité de retour pour la personne engagée, en particulier en ce qui a trait à la santé et à l’apprentissage ; le mieux-être de la personne engagée et le mieux-être collectif pouvant être interdépendants. Toutefois, notre définition de l’engagement exclut une relation purement transactionnelle dans laquelle la personne reçoit une contrepartie pleinement équivalente à ce qu’elle a consacré. En ciblant le mieux-être d’une communauté, de l’humanité ou de la vie sur Terre, l’engagement social rejoint le caractère parfait du don tel que défini par Mahieu (2020). Le fait que le don ne soit pas lié à une relation de pouvoir entre le donateur et le bénéficiaire évoque également les approches d’égal à égal, basées sur des connexions volontaires, abordées dans le chapitre 2.
Les conseils d’administration des OSBL sont formés de bénévoles, c’est une des raisons pour lesquelles l’engagement social des personnes est fondamental (…) Les bénévoles contribuent aux services auprès des personnes aînées, aux banques alimentaires, à l’aide aux devoirs, à plusieurs autres activités qui demandent de l’accompagnement et aux services que les organismes ne peuvent couvrir avec l’aide seule de leur personnel.
Catherine Montour, directrice générale, Centre d’action bénévole de Québec, 2022
3.2 Consacrer du temps
Le fait de consacrer du temps pour contribuer au mieux-être de nos proches ou d’autrui est considéré comme un baromètre important du lien social et de la société civile, puisqu’il permet de saisir les échanges interindividuels en dehors des sphères marchandes, étatiques et domestiques (Gaudet et Reed, 2004).
La forme la plus courante de cet engagement est le bénévolat, que McAllum (2017) définit comme étant un processus par lequel les individus s’associent et s’engagent avec d’autres personnes, groupes ou organisations afin de répondre aux besoins spécifiques d’une communauté sur une base non rémunérée.
3.2.1 La définition du bénévolat selon Cnann, Handy et Wadsworth
La définition de la notion de bénévolat a évolué dans le temps en même temps que le travail bénévole. Il existe une multitude de définitions du bénévolat, mais toutes ne prennent pas nécessairement en compte toutes les caractéristiques qu’englobe le concept. Cnann et al. (1996) ont établi, dans un premier temps, quatre critères essentiels pour caractériser le bénévolat. Pour ces auteurs, une action peut être qualifiée de bénévole si elle est librement choisie, non rémunérée, faite à travers une organisation à but non lucratif et profitant à la communauté dans son ensemble. Cette caractérisation du bénévolat, bien que simple et englobante, fait fi des différentes nuances qui peuvent exister dans les pratiques du bénévolat (Duguid et al., 2013). Dans un second temps et après une prise en compte des définitions existantes dans la littérature, dans les rapports des organisations et des gouvernements, Cnann et al. (1996) ont revu leur conceptualisation du bénévolat en maintenant les quatre dimensions de base, mais en ajoutant douze (12) catégories qui prennent en compte les différents degrés de volonté, de rémunération, de structure et de bénéficiaires potentiels. Les dimensions et les catégories sont présentées dans le tableau 3.1.
Tableau 3.1 Dimensions et catégories du travail bénévole
| Dimensions | Catégories |
| Volonté | Libre choix
Relativement sans contrainte Obligation de faire du bénévolat |
| Rémunération | Aucune
Frais remboursés Allocation/Faible salaire |
| Structure | Formelle
Informelle |
| Bénéficiaires visés | Les autres/les étrangers
Les amis et les proches Nous-mêmes |
Source : Traduction libre de Cnann et al., 1996, p. 371
Au regard de ses douze catégories, les débats sur la nécessité d’une définition commune du bénévolat existeront toujours étant donné les différentes possibilités de perceptions du travail bénévole qu’offre le tableau 3.1. Dans la première dimension qui fait référence à la volonté, on observe, par exemple, que l’action bénévole peut être librement choisie, mais en même temps être contrainte. C’est le cas des personnes qui font du service communautaire obligatoire. Le libre choix peut être subjectif et relatif, car il est difficile d’évaluer la part de volonté d’une personne lorsque celle-ci pose une action attendue. Le continuum des catégories de la deuxième dimension portant sur la rémunération met en exergue la possibilité que des personnes bénévoles dans certaines organisations à but non lucratif reçoivent des allocations ou qu’une partie de leurs frais leur soient remboursés.
La définition initiale de Cnann et al. (1996) faisait allusion au travail bénévole se déroulant dans des organisations à but non lucratif formelles, comme les organismes communautaires, excluant ainsi une grande partie du bénévolat informel qui sera défini dans la section 3.2.2. Aider des familiers ou des amis en leur apportant un soutien financier est une action qui ne nécessite pas forcément de passer par un organisme intermédiaire. Enfin, les bénéficiaires d’une action bénévole peuvent aller au-delà des autres ou de la société. Une personne peut bénéficier de sa propre action bénévole. De plus, il existe souvent une part de profit ou de satisfaction personnelle que l’on tire du bénévolat.
Malgré les nuances qu’apportent ces catégories à la conceptualisation du bénévolat, nous nous limiterons à certaines catégories afin de circonscrire notre définition du bénévolat. Celle-ci prend en compte toute action faite de façon volontaire (elle exclura donc le service communautaire), non rémunérée, par l’intermédiaire d’une organisation ou non et bénéficiant à nos proches (familiers ou amis), aux autres (communauté ou étrangers) ou à nous-mêmes. L’action peut être faite de façon ponctuelle ou continue sur une courte ou une longue période. Elle peut être soit individuelle, collective ou par le biais d’une organisation.
3.2.2 Le bénévolat informel et le bénévolat formel
L’Institut de la statistique du Québec (2022a) identifie deux types de bénévolat et propose les définitions suivantes :
Le bénévolat informel fait référence à l’aide non rémunérée apportée directement à des particuliers (par exemple des amis, des voisins, des connaissances ou des collègues) […] y compris l’aide accordée aux membres de la famille vivant à l’extérieur du ménage du répondant, ainsi que le travail non rémunéré visant l’amélioration directe des communautés, sans que ce soit pour le compte d’un groupe ou d’un organisme. Est exclue l’aide fournie aux personnes habitant dans le même ménage que le répondant […]. (5e paragr.)
Le bénévolat encadré fait référence au travail non rémunéré effectué pour le compte d’un groupe ou d’un organisme […]. Il comprend le travail obligatoire non rémunéré et le bénévolat effectué avec l’appui de l’employeur […]. (4e paragr.)
Gaudet et Reed (2004) associent deux modalités de responsabilité au don de temps à travers le bénévolat encadré. La personne qui donne du temps pour le mieux-être des autres répond de lui (de son éthos, de son identité) et répond également devant l’autrui généralisé, voire l’institution. Pour ces auteurs, « le don de temps au sein des institutions bénévoles représente une image forte de responsabilité sociale, puisqu’il ne circule pas en fonction du lien de proximité, mais en fonction du lien social avec l’étranger » (Gaudet et Reed, 2004, p. 61). Plusieurs facteurs, comme l’âge, le sexe, la situation matrimoniale, le type d’emploi, etc., peuvent influencer le nombre d’heures qu’une personne peut consacrer à une activité bénévole. Par exemple, en 2018, les Québécoises ont accordé près du double du nombre d’heures au bénévolat informel que les Québécois. Il s’agit de 184,2 heures en moyenne par Québécoise contre 109,8 heures en moyenne par Québécois (Institut de la statistique du Québec, 2022b).
Par ailleurs, le temps consacré, notamment en ce qui concerne le bénévolat encadré, est d’autant plus important, car la survie de la majorité des groupes et des organismes en dépend. Plusieurs sont les organismes communautaires qui se voient être obligés de suspendre leurs activités par manque de bénévoles.
Pour Centraide, les formes d’engagement sont multiples. D’abord, il y a des milliers de bénévoles qui travaillent au sein des organismes et projets qui sont reconnus et soutenus par Centraide annuellement. Les bénévoles assurent l’accueil, la réception, le transport, l’accompagnement, l’aide alimentaire et l’écoute. Ces personnes occupent également le rôle de membres de conseils d’administration ou de comités, élaborent des collectes de fonds et plus encore. Leur engagement peut donc prendre différentes formes. Sans leur contribution, les organismes communautaires ne pourraient pas fonctionner. Puisque les organismes sont fondés par et pour les personnes, l’appui des bénévoles et la participation citoyenne sont centraux pour la gouvernance, la vie associative, mais surtout pour la réalisation de leur mission. Au cœur de Centraide, c’est la même chose. Les bénévoles vont faire l’analyse et la recommandation des soutiens financiers, ces personnes vont aussi siéger à des comités de réflexion sur le développement social ou sur les inégalités sociales, travailler sur des comités de collecte de fonds pour développer de nouvelles campagnes ou consolider les campagnes existantes. Ces personnes vont aussi administrer Centraide par et pour leur communauté. Toutes ces formes d’engagement sont interdépendantes et connectées. Sans les bénévoles qui font de la collecte de fonds, il est impossible de réaliser des investissements et sans les investissements, il est impossible d’avoir des répercussions dans la communauté. Pour nous, l’engagement social est interrelié et interdépendant.
Nancy Charland, vice-présidente au développement social, Centraide Québec et Chaudière-Appalaches, 2022
Lorsqu’un médecin ou un avocat donne du temps pour l’organisation d’une activité dans la garderie de son enfant, ce n’est pas son expertise qui est mise à contribution en disposant, par exemple, des chaises ou en gonflant des ballons. Il en est de même lorsqu’un expert-comptable donne du temps pour aider à l’organisation d’un marathon en attribuant des dossards numérotés aux participants et participantes. S’impliquer dans des activités qui ne nécessitent pas une expertise particulière (ce type d’engagement sera abordé dans la section suivante), comme le don de temps, signifie parfois d’accomplir des tâches pour lesquelles la personne est surqualifiée en raison de son expertise. Cela demande de faire preuve de beaucoup d’humilité, mais n’enlève rien à la valeur d’un engagement. Il s’agit d’une posture où les bénévoles, unis par une intention de contribuer au mieux-être collectif, œuvrent toutes et tous sur un même pied d’égalité.
3.2.3 La proche aidance
Il existe bien sûr d’autres formes d’engagement social par lesquelles il est possible de consacrer du temps. La proche aidance en est une. Une personne proche aidante peut jouer un rôle important dans les tâches quotidiennes de la personne concernant, entre autres, les travaux domestiques, les soins personnels, l’entretien de la maison, le transport et les opérations bancaires. Les travaux domestiques englobent la préparation des repas, la vaisselle, le ménage, la lessive et la couture. Les soins personnels comprennent des activités comme prendre un bain, s’habiller, aller à la toilette et l’entretien des cheveux ou des ongles. L’entretien de la maison couvre les tâches intérieures et extérieures, tandis que le transport concerne les déplacements pour les courses ou les rendez-vous. Les opérations bancaires impliquent la gestion des finances et le paiement des factures (Lecours, 2016).
Une personne proche aidante peut également venir en soutien aux soins de santé. Cette contribution s’observe notamment à travers les traitements médicaux, tels que le changement des pansements, la prise de médicaments et tout autre soin médical, mais aussi lors de l’organisation des soins comme la prise de rendez-vous, l’embauche d’aide professionnelle, etc. (Lecours, 2016). À ceci s’ajoute également le soutien moral et relationnel, qui « se traduit par des visites plus ou moins régulières, pour prendre de leurs nouvelles et passer du temps en leur compagnie (prendre un café, lire le journal, jouer au scrabble, etc.), mais également par le soin qu’ils accordent à ne pas laisser leurs parents se replier sur eux (accompagnement chez tel membre de la famille, repas chez leurs petits-enfants, transport pour aller au cinéma, vacances, etc.) » (Campéon et al., 2012, p. 116). La proche aidance peut aussi participer à l’amélioration des performances physiques des personnes en perte d’autonomie en offrant un soutien lors des activités physiques (Blain et al., 2015).
Force est de constater que tous ces rôles de la proche aidance sollicitent le temps de la personne engagée. Il y a toutefois lieu de souligner que les personnes proches aidantes peuvent également consacrer autre chose que leur temps. Certaines personnes consacrent leur expertise par un appui aux tâches administratives (telles que les opérations bancaires), alors que d’autres consacrent des ressources financières et matérielles (en accueillant le proche sous leur toit, par exemple). Le rôle d’une personne proche aidante peut même aller jusqu’à un don de sang ou même d’un organe (p. ex. le don d’un rein).
3.2.4 Les défis associés à l’engagement bénévole
Bien que ce manuel mette en évidence les multiples avantages et l’image très positive de l’engagement social, il est important de ne pas sous-estimer les différents défis et obstacles auxquels sont confrontés les personnes engagées et les organismes à but non lucratif (OBNL). Le premier obstacle est l’érosion du capital social et de l’élan naturel des personnes engagées au fil des générations. En 2002, Lamoureux affirmait déjà ce qui suit :
La qualité de notre capital social s’érode sous l’effet des changements sociaux et structurels de notre société. Elle s’érode aussi sous la pression d’une éthique de la consommation qui oblige l’individu à plus de productivité, à plus de temps travaillé, à l’élaboration d’une identité personnelle fondée sur l’avoir plutôt que sur l’être. (p. 84)
Cette nécessité d’accroître sa propre productivité conduit les personnes à avoir moins de temps pour les autres et, par conséquent, pour le bénévolat. Le deuxième obstacle est le recrutement et le maintien de l’engagement des personnes, notamment au sein des organismes communautaires. La pénurie de main-d’œuvre a eu pour conséquence de créer une pénurie au sein des OBNL, principalement au niveau des bénévoles. Le temps donné par les bénévoles devient partiel ou inexistant.
En ce qui concerne la gestion des bénévoles et du bénévolat, Thibault et Fortier (2003) ont identifié trois défis liés au domaine du loisir au Québec. Le premier défi porte sur le statut des bénévoles au sein des OBNL. Les bénévoles voudraient jouer un rôle de partenaires au lieu d’être perçus comme des auxiliaires qui viennent exécuter des tâches qui découlent des décisions prises par autrui. Cela implique que les OBNL devraient adopter une gestion participative prenant en compte les points de vue de toutes les parties prenantes dans les prises de décisions, notamment des personnes bénévoles. Certaines frustrations et démotivations peuvent naître du fait que des bénévoles se sentent exclus du processus décisionnel au sein des OBNL. Le deuxième défi identifié par Thibault et Fortier (2003) concerne l’adaptation des OBNL aux nouveaux aménagements de temps, aux nouvelles attentes des bénévoles et à la nouvelle génération en revoyant l’organisation du bénévolat. Par exemple, certains gestionnaires d’OBNL se sentent obligés de supprimer des services ou d’en offrir moins faute de bénévoles disponibles. Enfin, le troisième défi, qui est lié au premier, relève du souhait des personnes bénévoles d’avoir une meilleure reconnaissance dans des OBNL qui sont de plus en plus gérés comme des entreprises ou de grandes corporations. Pour Lamoureux (2002), « les notions de productivité, d’efficience et d’efficacité prennent parfois le pas sur des valeurs comme le respect des personnes, le fonctionnement démocratique, la solidarité » (p. 84).
En actualisant les travaux de Thibault et Fortier (2003) après une décennie, Fortier et al., (2015) ont conclu que les trois défis cités précédemment sont demeurés intacts dans le temps, mais aussi que de nouveaux défis ont été créés. Ces derniers défis nés d’une volonté d’aider les personnes bénévoles dans leur implication, de maintenir leur engagement et de favoriser la promotion du développement du bénévolat sont liés à la mobilisation de tous les services au sein des OBNL. L’autre défi auquel font face les gestionnaires des OBNL est l’adaptation quotidienne nécessaire en raison de la baisse des disponibilités des bénévoles et de la quantité de services désormais offerts. Même si ces études ont été menées dans le secteur des loisirs, les défis évoqués sont similaires dans d’autres OBNL, notamment en santé et en éducation. Face à ces défis, les gestionnaires doivent absolument s’adapter et innover.
3.3 Consacrer son expertise
Au lieu de donner un peu de son temps, une personne peut s’engager dans une cause sociale en offrant son expertise à des organismes ou à des groupes de façon bénévole. C’est le cas, par exemple, des membres des conseils d’administration qui mettent bénévolement leur expertise au profit des organisations communautaires pour contribuer à leur développement. Deux approches de la notion d’expertise seront abordées, soit une approche psychologique et une approche plus sociale, proposée par Mieg (2006). Avant d’en arriver à la distinction de ces deux approches, il convient de définir ce qu’est une personne experte.
3.3.1 Les perspectives de Gastaldi et Gilbert
Gastaldi et Gilbert (2008) ont énuméré deux acceptions de la notion d’expert ou d’experte. La première définit l’expert comme une personne possédant un haut niveau de maîtrise dans un domaine spécialisé, exerçant un rôle spécifique dans une activité scientifique et technique. Dans la deuxième, la personne experte est perçue comme étant une personne professionnelle d’une activité dénommée expertise.
Pour illustrer cette acception, Dietrich et al. (2010) indiquent que l’entreprise qui emploie ce type d’expert ou d’experte :
[…] a plusieurs missions et pour cela mène, d’une part, des activités de recherche (production de connaissances validées) et de développement (conception de nouveaux produits) et, d’autre part, des activités d’expertise (avis sur des projets, appuis techniques ponctuels, diagnostic de panne, participations à des groupes de travail ou instances diverses, au niveau national et international, etc.). (p. 187)
Ces auteurs font la distinction entre ces deux types d’activités (la recherche d’un côté et l’expertise de l’autre) du fait que celles-ci sont exercées par des individus différents.
Les définitions de Gastaldi et Gilbert (2008) se rapprochent davantage de l’approche psychologique de la notion d’expert ou d’experte proposée par Chi (2006), qui définit une personne experte comme quelqu’un ayant un niveau de connaissance supérieur dans un domaine donné. Différents critères peuvent être utilisés pour évaluer ce niveau de connaissance. Il s’agit, entre autres, du niveau de qualification (diplôme), de l’ancienneté ou du niveau d’expérience dans un domaine, d’un consensus entre les pairs, d’une évaluation à travers des tests, etc. Toutefois, cette perception psychologique de la notion d’expert ne tient pas compte de l’interaction qui peut exister entre une personne experte et son environnement, c’est-à-dire les personnes non expertes ou celles qui cherchent une expertise.
3.3.2 Les perspectives de Mieg
Dans son approche alliant les visions psychologique et sociologique, Mieg (2006) part du principe que le degré de connaissances, de compétences et d’expériences des experts et expertes ne peut être étudié indépendamment de leur contexte social. En s’appropriant la notion de relativité de l’expertise, Mieg (2006) détaille l’importance de définir la personne experte en fonction des personnes non expertes ou de celles qui cherchent une expertise. L’auteur illustre l’interaction entre une personne experte et son contexte à travers trois caractéristiques qu’il présente comme suit :
- on s’adresse à une personne en tant qu’expert devant un public — un client, un profane, un jury, un téléspectateur, etc. ;
- on s’adresse à cette personne parce qu’elle peut avoir des connaissances pertinentes pour une certaine fonction, par exemple la résolution d’un certain problème ;
- la fonction varie légèrement en fonction du contexte : Le patient consulte le médecin pour soulager ses douleurs cervicales ; un jury est informé de manière exhaustive par un expert sur les risques pour la santé causés par l’amiante dans une installation industrielle particulière ; ou l’étranger souhaite simplement connaître la direction de la gare.
Cette vision sociale de la notion d’expert permet de faire la distinction entre deux catégories d’experts : les experts absolus et les experts relatifs. Les experts absolus sont ceux ayant des connaissances et des capacités exceptionnelles dans leur domaine et qui sont développées dans la perspective psychologique. Quant aux experts relatifs, Mieg (2006) considère que dans certains contextes, toute personne peut devenir ou agir en tant qu’expert. Il justifie cela par le fait que le niveau de connaissances et de compétences varie dans notre société et que le niveau nécessaire diffère également selon la fonction à assumer dans un contexte précis.
Mieg (2006) donne l’exemple d’un étudiant en psychologie qui, ayant des problèmes avec son propriétaire, a recours à son ami, étudiant en droit, pour des conseils. En lui apportant son soutien et en le conseillant, l’ami agit en tant qu’expert ; un statut qu’il n’a pas dans la réalité et qu’il n’aurait jamais eu au sein de sa communauté professionnelle à ce stade de sa formation. Mais dans le contexte du conflit entre l’étudiant en psychologie et son propriétaire, il a agi en tant qu’expert, car il possède des connaissances et des compétences supérieures dans le domaine du droit que son ami.
3.3.3 Le bénévolat de compétences
Consacrer son expertise à une cause peut prendre la forme du soutien d’un ou d’une spécialiste qui offre bénévolement ses connaissances et compétences dans un domaine précis à un organisme communautaire ou à un groupe afin de contribuer à une cause. Les bénévoles ayant une expertise particulière s’engagent directement auprès des OBNL ou peuvent recevoir un mandat de la part d’autres organismes spécialisés dans leur recrutement, comme Bénévoles d’Expertise (Bénévoles d’Expertise, 2024a). Cet organisme définit d’ailleurs le bénévolat de compétences de la manière suivante :
Le bénévolat de compétences consiste, de manière générale, à offrir les compétences professionnelles des bénévoles aux gestionnaires et aux équipes des organismes. Ce type d’engagement vise à transférer des connaissances (savoir) et à partager des habiletés (savoir-faire) avec les gestionnaires d’organismes dans une approche d’enrichissement mutuel. En fait, la personne bénévole experte soutient, le temps d’un mandat, les membres du Conseil [sic] d’administration ou les directions générales dans leurs responsabilités respectives en matière de gestion et de gouvernance. (Bénévoles d’Expertise, 2024b, p. 4)
Dans un contexte de bénévolat de compétence, le partage des connaissances entre le bénévole et l’organisme peut prendre plusieurs formes. Bénévoles d’Expertise (2024) en inventorie trois :
- L’approche linéaire: d’une personne à l’autre, entre deux personnes.
- L’approche de résolution de problèmes: toutes les parties prenantes sont impliquées et ont une participation active dans le processus de transfert de connaissances. Analyse de la situation : qu’est-ce qui dérange ? Dans quel contexte le problème apparaît-il ? Qu’est-ce qui est le plus important pour l’organisme et les gens qui le composent (membres, personnel, bénévoles, conseil d’administration) ?
- L’approche interactive: il s’agit d’une approche novatrice et dynamique qui permet aux parties prenantes de révéler leurs capacités, leurs savoirs, leurs questionnements et leurs réflexions, en encourageant au maximum les interactions entre les membres du comité afin de favoriser la diffusion, l’adoption et l’appropriation de nouvelles connaissances. (p. 5)
3.3.4 La participation à la gouvernance d’organismes
L’engagement à titre de membre d’un conseil d’administration permet souvent de consacrer une expertise à une cause. Grâce à ces rôles, une personne peut partager ses connaissances dans divers domaines, tels que le droit, la gestion, les communications ou encore la gouvernance. Le don d’expertise peut également prendre la forme d’une aide ponctuelle dans des circonstances particulières. Dans ce cas, l’expert fournit ses services pour aider à régler un problème dans une organisation ou un groupe.
3.3.5 Le partage bidirectionnel
Toutefois, il est important de considérer le bénévolat d’expertise comme un partage bidirectionnel des savoirs plutôt que comme un simple transfert unidirectionnel par la personne engagée vers l’organisme bénéficiaire.
L’écueil principal auquel peut être confrontée une personne qui s’inscrit dans une démarche d’engagement social est celui du préjugé d’expertise, soit l’idée de posséder un savoir qui doit être transmis à des personnes qui ne le maîtrisent pas. Il est plutôt essentiel de faire preuve d’humilité et d’adopter une posture d’accueil à la diversité des savoirs qui peuvent émaner aussi de nos partenaires et ainsi y découvrir une grande richesse.
Thierry Belleguic, professeur titulaire, Faculté des lettres et des sciences humaines, 2022
C’est important de s’améliorer en tant qu’individu et personne professionnelle. En faisant du bénévolat de compétences, je deviens une employée plus complète parce que je vais chercher de l’expérience ailleurs. À chaque mandat, j’apprends sur moi. D’être bénévole experte m’a aidé à m’adapter aux gens autour de moi, dans mon écoute, ma patience. D’aller voir d’autres valeurs a permis d’enrichir les miennes.
Léa Gariépy, bénévole experte en gestion des ressources humaines, Bénévoles d’Expertise, 2021
3.4 Consacrer de l’argent
L’engagement social se manifeste également à travers le fait de consacrer des ressources monétaires à une cause. Le don d’argent fait partie de cette forme d’engagement. Cette pratique n’est pas nouvelle, il suffit de penser à la tradition de la quête dominicale dans les églises du Québec. Aujourd’hui, le don d’argent se fait sous diverses formes : par Internet, lors d’événements de collecte de fonds, en hommage à une personne décédée (don in memoriam), dans le cadre d’une campagne en milieu de travail, en réponse à un publipostage, à une sollicitation téléphonique ou à un porte-à-porte, etc. (Institut de la statistique du Québec, 2023)
Certains dons sont planifiés, c’est-à-dire qu’ils demandent une profonde réflexion qui inclut habituellement une planification financière, fiscale ou successorale. On considère souvent que les dons planifiés correspondent à des dons différés, puisqu’ils seront remis à un organisme par la suite. Ce n’est toutefois pas toujours le cas (Osili et al., 2016). Un legs (un don testamentaire) correspond à un don planifié différé, tandis qu’un don de titres (tels que des actions ou des obligations) est considéré comme un don planifié, mais pas nécessairement différé.
Un don planifié correspond à toute contribution importante effectuée après une réflexion approfondie concernant ses avantages pour l’organisation caritative ainsi que ses implications financières pour le donateur et sa famille. Bien qu’un don planifié soit généralement compris comme un « don différé » (c’est-à-dire un don déterminé maintenant, mais qui ne sera disponible pour l’organisation caritative qu’à une date future), il peut également s’agir d’un don actuel conçu pour maximiser les avantages fiscaux et qui est souvent réalisé avec des actifs complexes. Les dons planifiés différés incluent les legs caritatifs, les rentes de bienfaisance, les fiducies de bienfaisance résiduelles, les fiducies de bienfaisance à revenu réversible, la désignation de l’organisation caritative comme bénéficiaire d’une assurance-vie et de fonds de retraite, ainsi que certains autres plans.
Certains dons seront capitalisés. Ces sommes seront généralement investies dans un véhicule de placement. Les dons capitalisés sont souvent investis dans des fonds de dotations. Le capital demeurera intact et une part des revenus de l’investissement pourra être utilisée par l’organisme (Council for advancement and support of education, 2024). Bon nombre d’universités bénéficient des revenus tirés de tels types de dons. L’Université Harvard, par exemple, tire environ le tiers de ses revenus de ses fonds de dotations (Harvard University, 2024).
Certains dons sans restriction (aussi appelés dons à la mission dans le vocabulaire philanthropique ou financement sans restriction) et d’autres sont considérés comme des dons dirigés. Imagine Canada (2022) définit un don sans restriction comme « un financement fourni aux organismes de bienfaisance sans condition, signifiant que les organismes peuvent utiliser l’argent du financement pour mener à bien leur mission » (p. 3). Les dons dirigés sont, pour leur part, destinés à des activités spécifiques d’un organisme. Tel que précisé dans le chapitre 2, ce type de don pose de multiples problèmes puisqu’il s’inscrit dans une approche directive (voir la section 2.1 pour plus d’information sur cette question).
3.5 Consacrer des biens
Selon l’Institut national de la statistique et des études économiques (2021), « les biens sont des objets physiques produits pour lesquels il existe une demande, sur lesquels des droits de propriété peuvent être établis et dont la propriété peut être transférée d’une unité institutionnelle à une autre par le biais d’une opération sur le marché » (1er paragr.). Cette définition va au-delà des biens concrets, qu’ils soient mobiles ou immobiles, et inclut des biens comme le don de sang. Ce don consiste en un geste gratuit et volontaire qui a le pouvoir de sauver des vies de manière instantanée et de renforcer les liens sociaux entre le donneur et le receveur.
Certaines personnes, parce qu’elles manquent de temps, d’expertise ou d’argent, s’engagent autrement dans la société, envers leurs proches ou envers les autres. C’est le cas lorsqu’une personne offre gratuitement des vêtements ou des objets usagés à des organismes qui les redistribuent ensuite à ceux qui en ont besoin. Le don de biens et de matériels mobiles ou immobiles permet de venir en aide à des personnes qui, sinon, ne seraient pas en mesure de se procurer ces articles. Certains organismes récupèrent ces biens et matériels pour ensuite les vendre à très bas prix. En revanche, d’autres les offrent gratuitement.
Il existe plusieurs catégories de biens et matériels qui sont distribués soit directement à des proches, à des groupes, à des organismes communautaires ou internationaux, voire aux autorités gouvernementales. Voici une liste non exhaustive des biens et matériels offerts : (i) Denrées alimentaires, (ii) livres et fournitures scolaires, (iii) vêtements et autres textiles (literie, serviettes), (iv) sang, organes et autres produits biologiques (plasma, cellules souches, lait maternel), (v) meubles et électroménagers (divans, réfrigérateur), (vi) équipements électroniques (ordinateurs, cellulaires, clavier), (vii) équipements sportifs et jouets, etc. Le don de biens peut également inclure des propriétés de toute sorte (des parcelles à titre d’exemple ou d’autres biens tangibles comme des œuvres d’art).
En ce qui concerne plus spécifiquement les denrées alimentaires, plusieurs milliers de familles ont recours régulièrement à des banques alimentaires afin d’assurer un besoin fondamental de l’être humain : se nourrir. Ces organismes reçoivent chaque année des dons en nature ou en argent évalués à plusieurs millions de dollars et sont distribués gratuitement à travers toute la province de Québec. Les bénévoles jouent un rôle crucial dans ces organismes, car leur temps et leur expertise permettent une distribution judicieuse des denrées alimentaires. Les principaux bénéficiaires des banques alimentaires sont les enfants, les personnes vivant seules, les personnes âgées, les étudiants universitaires et divers autres groupes de la société.
3.6 Consacrer sa notoriété
La notoriété d’une personne est sa capacité à être reconnue favorablement. La notoriété a un effet bénéfique sur la réputation ou la visibilité d’une personne, d’un organisme ou d’un bien. Lorsqu’une personne jouit d’une certaine notoriété, ses gestes peuvent influencer ceux des autres. Effectivement, des artistes de divers domaines (musiciens ou musiciennes, comédiens ou comédiennes, plasticiens ou plasticiennes, écrivains ou écrivaines, etc.), des athlètes de haut niveau reconnus, des personnalités politiques et des activistes sont des figures marquantes de la vie sociopolitique, culturelle et artistique qui s’engagent pour des causes sociales par le biais d’initiatives individuelles ou collectives. D’autres sont des personnalités du monde des affaires, comme l’ex-PDG d’iA Groupe financier, qui met délibérément à contribution la notoriété acquise tout au long de sa carrière pour s’engager. Ce dernier s’est d’ailleurs doté d’une mission communautaire pour lui-même, qu’il définit ainsi :
Utiliser ma position pour soutenir des causes, populaires ou pas, qui m’apparaissent importantes et inciter le maximum de dirigeantes et dirigeants d’entreprises à s’engager en philanthropie par des dons personnels et d’entreprise.
Yvon Charest, ex-président-directeur général d’iA Groupe financier, 2024
La notoriété peut également être consacrée à plus petite échelle. Une personne peut notamment inciter son réseau immédiat à contribuer à une campagne de financement ; un objectif pourra même être associé à cette personne. Il est intéressant de noter que cet exemple fait également intervenir le don d’argent et le don de temps (le temps consacré à la collecte de fonds), illustrant que plusieurs formes d’engagement peuvent prendre place au sein d’une même action.
3.6.1 L’engagement d’Émile Zola
Un des cas qui a marqué l’historique du don de notoriété à travers le temps est l’engagement de l’écrivain émérite Émile Zola en 1898 dans la défense de l’officier français d’état-major Alfred Dreyfus, injustement accusé de trahison pour avoir livré des documents confidentiels à l’ennemi allemand. Bien que le véritable coupable, le commandant Walsin Esterhazy, ait été identifié, ce dernier fut acquitté à l’unanimité par le conseil de guerre dans un souci délibéré de nuire à l’officier Dreyfus, dont la condamnation initialement erronée n’a pas été annulée. C’est pour ces raisons que Zola s’est engagé, motivé par l’iniquité de la situation et l’absence de preuves justifiant l’acquittement d’Esterhazy.
L’écrivain n’a pas seulement condamné ces faits à travers de simples déclarations, mais il a aussi posé un geste fort en écrivant une lettre ouverte en 1898 dans le journal L’Aurore intitulée J’accuse, lettre adressée directement au président de la République française de l’époque, Félix Faure. Cette lettre, qui se distingue par son style et son contenu, restera comme l’un des articles de journaux les plus revendicateurs de l’histoire de la France. Zola décrit avec précision les événements qui, selon lui, constituent une erreur judiciaire orchestrée dont a été victime l’officier Dreyfus. Les révélations de Zola, tirées de ses propres investigations, dans sa lettre, décrivent avec précision l’injustice commise envers un innocent et l’acquittement d’un coupable par les autorités. En s’attaquant directement aux institutions publiques, notamment à leurs systèmes judiciaire et militaire, puis en nommant ouvertement les responsables, J’accuse a suscité des débats dans l’opinion publique, mais surtout dans la sphère politique de l’époque.
Les dénonciations de Zola ont eu comme conséquence premièrement de relancer l’affaire Dreyfus, l’officier sera, d’ailleurs, innocenté et réhabilité définitivement en 1906, par un arrêt de la Cour de cassation. Zola, à travers J’accuse, a également créé une scission droite-gauche dans la classe politique et la population française, qui étaient convaincues de la culpabilité de Dreyfus. La gauche, d’un côté, regroupant la partie de la population qui a finalement cru dans les dénonciations de Zola et s’est battue pour la défense de Dreyfus et d’un autre côté, la droite, qualifiée d’anti-Dreyfusard.
Un autre effet majeur est l’engagement de nombreux intellectuels dans le combat de Zola pour cette cause sociale. J’accuse a ainsi ouvert la voie à un engagement social et politique de la part de personnalités publiques et d’intellectuels. De plus, cela a contribué à établir la presse comme une force de contre-pouvoir. Cependant, Zola lui-même a dû faire face aux conséquences de son assaut audacieux contre le pouvoir en place. J’accuse a valu à Zola une peine de treize mois d’emprisonnement, une amende de 4 000 francs français et de 30 000 francs de dommages et intérêts. Il a dû s’exiler en Angleterre pour éviter la prison. Lors de sa fuite, tous ses biens ont été vendus, ce qui l’a plongé dans des difficultés financières importantes. Les actes de Zola ont entraîné également des conséquences sur sa notoriété. Bien que le don de notoriété ne soit habituellement pas associé à un tel sacrifice, l’exemple de Zola met en évidence cette forme d’engagement social et politique consistant à s’exposer en utilisant sa notoriété pour dénoncer ou combattre une injustice sociale, en considérant les éventuelles répercussions.
3.6.2 Les motivations
Les motivations des personnalités publiques qui s’associent à des causes ou qui prêtent leur nom à des organismes sont multiples. Par exemple, lorsqu’une vedette de soccer ou de basketball de haut niveau célèbre un but marqué en arborant un message sur son dossard pour protester contre une injustice sociale, elle peut le faire pour améliorer son image publique et gagner en popularité. Mais ce don de notoriété peut également être animé par le désir de changements sociaux et politiques de la part des autorités. Il existe plusieurs formes de don de notoriété : l’engagement dans des associations humanitaires, devenir ambassadeur ou ambassadrice pour un organisme international comme l’UNICEF, l’UNESCO ou le PNUD[1], publier un message de soutien ou de sensibilisation sur les réseaux sociaux, participer à des manifestations, etc.
3.6.3 Les attentes
Thomas et Fowler (2023) ont démontré dans leurs travaux que l’engagement des influenceurs et influenceuses crée des attentes chez leur public. Plus un influenceur, une influenceuse ou une célébrité s’engage dans une cause, plus son public s’attend à ce que l’engagement soit à long terme. L’engagement temporaire des influenceurs et influenceuses peut engendrer des perceptions négatives du public sur l’authenticité. Par exemple, lorsqu’une célébrité publie un message sur les réseaux sociaux pour dénoncer une injustice, les personnes qui la suivent ou qui sont abonnées à son compte s’attendent à ce que son engagement aille au-delà d’une simple publication. Elles souhaitent qu’elle s’engage de façon concrète et durable. Thomas et Fowler (2023) ont également démontré que les influenceurs et influenceuses qui utilisent leur notoriété pour s’engager dans une cause sociale de façon continue et offrent un soutien direct (don de temps, don d’expertise, don de biens, don d’argent, etc.) renforcent les perceptions positives d’authenticité et les attentes à leur égard. C’est exactement le cas d’Émile Zola avec J’accuse. Il n’a pas uniquement engagé sa notoriété dans la défense de Dreyfus et la recherche de la vérité, il a également mis en jeu sa carrière, son temps, son expertise, son argent et surtout sa vie. Il a défendu cette cause de façon continue jusqu’à sa mort. Plus que les autres types de dons, le don de notoriété peut entraîner des répercussions directes ou indirectes sur la personne qui donne, en particulier en cas de problèmes liés à la cause. Par exemple, un ou une artiste qui s’engage auprès d’une organisation qui fait face à un scandale financier pourrait voir sa notoriété affectée négativement.
Les trois formes du militantisme
Martinot-Lagarde (2008) identifie trois modèles d’engagement : le militant professionnel, le militant libéral et le militant pragmatique. Ces modèles permettent d’enrichir les perspectives sur les formes possibles de l’engagement social.
Dans le modèle du militant professionnel, l’engagement se déroule dans une structure hiérarchique existante, où les décisions sont prises par des cadres, notamment en ce qui concerne les orientations. C’est le cas dans les syndicats, par exemple, où une personne s’engage après avoir été invitée par le syndicat à une manifestation ou à une mobilisation en réponse à un conflit avec l’employeur. Le militant ou la militante trouve alors un sens à son engagement dans cette lutte sans en jouer le rôle principal. Sa motivation est alimentée par l’aspiration à une carrière.
Dans le modèle du militant libéral, c’est l’individu et ses propres choix qui sont au cœur de son engagement. Par exemple, certains jeunes peuvent décider de s’impliquer dans un groupe ou une association de leur communauté ou de leur université, puis, progressivement, décider de s’impliquer dans son comité d’administration. Pour Martinot-Lagarde (2008), « la satisfaction du militant et sa fidélisation ne se traduisent pas par l’entrée dans une carrière, mais par la conjonction d’un double mouvement : celui qui vise à la satisfaction personnelle, celle d’un besoin comme celle d’une plus grande authenticité ; et en même temps, la visée d’une démocratie associative » (p. 51). Contrairement au premier modèle, dans le modèle du militant libéral, les décisions sont prises dans le cadre multiple de délibérations horizontales. Enfin, dans le modèle du militant pragmatique, l’engagement est défini par l’action du militant dont le point de départ est toujours une expérience affective personnelle. Cette expérience vécue par le militant l’amènera à passer à l’action en s’impliquant personnellement. C’est le cas, par exemple, d’un médecin qui constate que certaines infirmières de son équipe sont victimes d’homophobie et décide de passer à l’action et de s’impliquer personnellement pour combattre cette discrimination au sein de son équipe et de l’hôpital.
La militance pragmatique est caractérisée par un « engagement plus circonstancié, thématique et pratique, où l’on se mobilise parce qu’un phénomène interpelle et qu’on peut individuellement « faire quelque chose », et non plus pour un projet de société » (Fley, 2019, 2e paragr.).
3.7 Les nouveaux « véhicules » de l’engagement social : l’engagement social numérique
Au-delà des formes d’engagement traditionnelles abordées dans les sections précédentes, de nouvelles formes émergent, en particulier grâce aux réseaux sociaux. Le concept d’engagement a considérablement évolué depuis l’avènement du numérique, et plus spécifiquement des médias sociaux.
Les plateformes numériques et les réseaux sociaux sont devenus de nouveaux véhicules de l’engagement social, offrant des possibilités de dons à l’aide de ces nouveaux moyens de communication. Le don en argent peut être favorisé par l’intermédiaire des plateformes de don en ligne, tandis que d’autres plateformes favorisent le don de biens. Les réseaux sociaux permettent à des groupes de se coordonner pour consacrer du temps et de l’expertise à une organisation, ou encore à des personnalités de consacrer leur notoriété à une cause.
L’émergence et le développement fulgurant de nouveaux outils numériques, en plus de leur facilité d’accès, donnent la possibilité, notamment aux jeunes, de s’engager dans une cause en faisant des gestes simples comme « aimer » ou « commenter » une publication, « publier » ou « partager » une information, une photo ou une vidéo, etc. De plus en plus de jeunes témoins d’une injustice s’engagent à présent à la filmer et à la publier sur les réseaux sociaux pour la dénoncer et éveiller les consciences. Ces vidéos sont souvent accompagnées de messages de lutte contre cette injustice qui incitent d’autres jeunes à s’y engager. L’engagement social peut être temporaire pour des jeunes qui ne font qu’en relayer l’information en y ajoutant une action plus limitée, comme un changement de photo de profil pour montrer leur sympathie envers les victimes ou leur indignation face aux actes posés.
D’autres s’investiront davantage avec des actions plus concrètes et plus avancées comme mobiliser différentes ressources pour venir en aide aux victimes de l’injustice ou organiser des manifestations afin que les responsables répondent de leurs actes. Dans l’engagement numérique, il est donc important de distinguer les personnes qui s’investissent réellement pour une cause et celles qui sont engagées sans nécessairement s’impliquer à long terme. Cette distinction se trouve au niveau de l’ampleur de l’acte posé (Amato et al., 2021) (le degré d’engagement) qui est caractérisée par la visibilité et l’importance de l’acte. La visibilité de l’acte comprend sa publicisation, son caractère explicite, son irrévocabilité et sa répétition. L’importance de l’acte, quant à elle, comprend ses conséquences et son coût. Ainsi, l’engagement numérique peut inciter certaines personnes à faire des dons de temps, d’argent, d’expertise ou de notoriété pour manifester leur soutien.
Les plateformes numériques et réseaux sociaux constituent aujourd’hui un moyen puissant et peu coûteux de rassembler des foules. On y trouve désormais plus souvent des publications pour dénoncer des injustices, sensibiliser à une cause ou inviter des abonnés à une manifestation. Ces réseaux sociaux comptent aussi des groupes dédiés à des causes spécifiques comme le féminisme, l’homophobie, le racisme, l’injustice climatique, les droits LGBTQ, etc. Un autre avantage des réseaux sociaux est leur rapidité dans la diffusion de l’information et le fait que cette dernière soit instantanée. Cela facilite les soulèvements, qui ne nécessitent qu’une simple dénonciation individuelle. De plus, les réseaux sociaux permettent de rassembler des personnes engagées provenant de milieux divers par le biais d’une seule publication.
Au-delà du caractère individuel de ces formes d’engagement numérique, les réseaux sociaux permettent à toute personne de se créer une communauté en ligne et de maintenir un contact constant avec celle-ci, favorisant ainsi une libre circulation de l’information. Par ailleurs, plusieurs organisations communautaires, OBNL ou organismes internationaux utilisent les réseaux sociaux pour encourager l’engagement de leur communauté en ligne.
Conclusion
Il est intéressant de noter que la définition de l’engagement social utilise les termes « consacre, entre autres choses », laissant effectivement la porte ouverte à d’autres formes d’engagement social. Bien que le fait de consacrer son temps, son expertise, son argent, ses biens ou sa notoriété constitue des formes d’engagement comme illustré dans ce chapitre, d’autres choses peuvent être consacrées au bénéfice d’une cause. Il importe également de rappeler que plusieurs formes d’engagement peuvent coexister entre elles, c’est notamment le cas lors du développement d’un projet engagé, où une personne peut à la fois consacrer du temps, de l’expertise, de l’argent, des biens et de la notoriété. Ces projets engagés peuvent se concrétiser aussi bien sous forme de projets d’entrepreneuriat social (au sein de la société) que d’intrapreneuriat social (au sein d’une organisation). La Matrice des projets engagés, présentée en annexe de ce manuel, aborde d’ailleurs ce type d’initiative.
Questions de réflexion
- En m’appuyant sur des exemples tirés de mon expérience, par quels moyens se manifeste mon engagement dans une cause sociale (temps, argent, expertise, notoriété, biens, autre) ?
- Comment les moyens choisis s’alignent-ils avec mes motivations (causes, valeurs, aspirations ? Pourquoi est-ce important pour moi ?
- Quels sont les obstacles rencontrés dans ces manières de m’engager ?
Bibliographie
Amato, S., Bernard, F. et Boutin, É. (2021). Les réseaux sociaux numériques redéfinissent-ils l’engagement?. Communication & Organisation, 59(1), 231-244. https://doi.org/10.4000/communicationorganisation.10230
Audebrand, L., Pepin, M. et Tremblay, M. (2022). La matrice des projets engagés. Chaire de leadership en enseignement sur le développement de l’esprit d’entreprendre et de l’entrepreneuriat de l’Université Laval. https://sites.fsa.ulaval.ca/www4/document/recherche/cle-esprit-entreprendre-entrepreneuriat/Matrice-projets-engages-questions.pdf
Bénévoles d’Expertise. (2024a). Avantages de s’engager par le bénévolat de compétences. https://benevoles-expertise.com/caracteristiques-dun-be/
Bénévoles d’Expertise. (2024b). Cadre de référence. https://benevoles-expertise.com/wp-content/uploads/2024/06/1.Cadre-reference-final_FINAL.pdf
Blain, H., Bloch, F., Borel, L., Dargent-Molina, P., Gauvain, J. B., Hewson, D., Orève, M.-J., Kemoun, G., Mourey, F., Puisieux, F., Rolland, Y. et Stephan, Y. (2015). Activité physique et prévention des chutes chez les personnes âgées. [Rapport de recherche] Institut national de la santé et de la recherche médicale (INSERM).
Campéon, A., Le Bihan-Youinou, B. et Martin, C. (2012). La prise en charge des personnes âgées dépendantes en Europe : Le vécu des aidants familiaux. Vie sociale, 4(4), 111-127. https://doi.org/10.3917/vsoc.124.0111
Chi, M. T. H. (2006). Two approaches to the study of experts’ characteristics. Dans K. A. Ericsson, R. R. Hoffman, A. Kozbelt et A. M. Williams (dirs.), The Cambridge handbook of expertise and expert performance (p. 21-30). Cambridge University Press.
Cnaan, R. A., Handy, F. et Wadsworth, M. (1996). Defining who is a volunteer: Conceptual and empirical considerations. Nonprofit and Voluntary Sector Quarterly, 25(3), 364-383. https://doi.org/10.1177/0899764096253006
Council for advancement and support of education. (2024). CASE global reporting standards (2e éd.).
Dietrich, A., Gilbert, P., Pigeyre, F. et Aubret, J. (2010). Management des compétences : Enjeux, modèles et perspectives (3e édition). Dunod.
Duguid, F., Mündel, K., Schugurensky, D. (dirs.). (2013). Volunteer Work, Informal Learning and Social Action. Brill. https://doi.org/10.1007/978-94-6209-233-4_2
Fley, A. (2019). Nouvelles formes d’engagement, nouveaux outils militants? Cause commune, 13. https://www.causecommune-larevue.fr/nouvelles_formes_d_engagement_nouveaux_outils_militants#:~:text=La%20typologie%20pr%C3%A9sent%C3%A9e%20par%20Pierre,lib%C3%A9rale%20et%20la%20militance%20pragmatique
Fortier, J., Thibault, A. et Leclerc, D. (2015). L’évolution du bénévolat en loisir au Québec 2001-2012. Loisir et Société / Society and Leisure, 38(2), 212-225. https://doi.org/10.1080/07053436.2015.1040631
Gastaldi, L. et Gilbert, P. (2008). Des experts à gérer. Un même objectif, des pratiques différenciées. Entreprise et Personnel, 276(1), 42.
Gaudet, S. et Reed, P. (2004). Responsabilité, don et bénévolat au cours de la vie. Lien social et Politiques, 51(1), 59-67. https://doi.org/10.7202/008870ar
Harvard University. (2024, 12 avril). Harvard’s Endowment. Financial Administration. https://finance.harvard.edu/endowment
Imagine Canada. (2022). Lien de confiance et impact : perspectives des bailleurs de fonds sur le financement sans restriction. https://imaginecanada.ca/sites/default/files/2022-05/Lien-de-confiance-et-impact-Perspectives-des-bailleurs-de-fonds-sur-le-financement-sans-restriction.pdf
Institut national de la statistique et des études économiques. (2021). Biens. Définitions, méthodes et qualité. https://www.insee.fr/fr/metadonnees/definition/c1359#:~:text=Les%20biens%20sont%20des%20objets,une%20op%C3%A9ration%20sur%20le%20march%C3%A9
Institut de la statistique du Québec. (2022a). Bénévolat — Définitions et classification des organismes. Tiré de l’Enquête sociale générale — Dons, bénévolat et participation de Santé Canada. https://statistique.quebec.ca/fr/document/la-pratique-du-benevolat-par-la-population-quebecoise/publication/benevolat-definitions-classification-organismes
Institut de la statistique du Québec. (2022b). La pratique du bénévolat au Québec en 2018. Tiré de l’Enquête sociale générale — Dons, bénévolat et participation de Santé Canada. https://statistique.quebec.ca/fr/document/pratique-benevolat-quebec/publication/pratique-benevolat-quebec-2018
Institut de la statistique du Québec (2023). Les dons de bienfaisance effectués par la population québécoise. Tiré de l’Enquête sociale générale — Don, bénévolat et participation de Santé Canada. https://statistique.quebec.ca/fr/document/les-dons-effectues-par-la-population-quebecoise
Lamoureux, H. (2002). Le danger d’un détournement de sens : portée et limites du bénévolat. Nouvelles pratiques sociales 15(2), 77-86. https://doi.org/10.7202/008916ar
Lecours, C. (2016). Portrait des proches aidants et les conséquences de leurs responsabilités d’aidant. Institut de la statistique du Québec. https://statistique.quebec.ca/fr/fichier/portrait-des-proches-aidants-et-les-consequences-de-leurs-responsabilites-daidant.pdf
Mahieu, F. R. (2020). Le don pur et parfait. Éthique, économie et biens communs. 17(1), 2-9. https://umontreal.scholaris.ca/server/api/core/bitstreams/a01023b7-2dfe-4d42-bd2e-d2b6319337b6/content
Martinot-Lagarde, P. (2008). De nouvelles formes d’engagement. Revue Projet, 305(4), 48-54. https://doi.org/10.3917/pro.305.0048
McAllum, K. (2017). Volunteer/volunteering. Dans C. Scott et L. K. Lewis (dirs.), The International Encyclopedia of Organizational Communication (p. 2-14). John Wiley & Sons. https://doi.org/10.1002/9781118955567.wbieoc217
Mieg, H. A. (2006). Social and sociological factors in the development of expertise. Dans K. A. Ericsson, N. Charness, P. J. Feltovich et R. R. Hoffman (dir.), The Cambridge Handbook of Expertise and Expert Performance (p. 743-760). Cambridge University Press. https://doi.org/10.1017/CBO9780511816796.041
Osili, U., Kou, X., Bergdoll, J., St Claire, M., Yang, L., Tang, S., Li, Y., Davis Kalugyer, A., Newman, J. H., Donikian, C. A., Moraldo, N., Weaver, D., Wishik, A. et Baugh, K. (2016). The 2016 planned giving study – Building lasting legacies: New Insights from data on planned gifts. Pentera and Lilly FamilySchool of Philanthropy. https://scholarworks.indianapolis.iu.edu/server/api/core/bitstreams/bfcdc7d5-2b04-4fa8-afb2-583fedb37764/content
Pepin, M., Tremblay, M. et Audebrand, L. (2023). La Matrice du modèle d’affaires responsable : un outil pour la transformation socioécologique. Entreprendre et innover, 54(1), 27-41. https://doi.org/10.3917/entin.054.0027
Thibault, A. et Fortier, J. (2003). Comprendre et développer le bénévolat en loisir dans un univers technique et « clientéliste ». Loisir et Société / Society and Leisure, 26(2), 315-344. https://doi.org/10.1080/07053436.2003.10707625
Thomas, V. L. et Fowler, K. (2023). Examining the outcomes of influencer activism. Journal of Business Research, 154, Article 113336. https://doi.org/10.1016/j.jbusres.2022.113336
[1] UNICEF (United Nations International Children’s Emergency Fund), UNESCO (United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization) et PNUD (Programme de développement des Nations Unies).