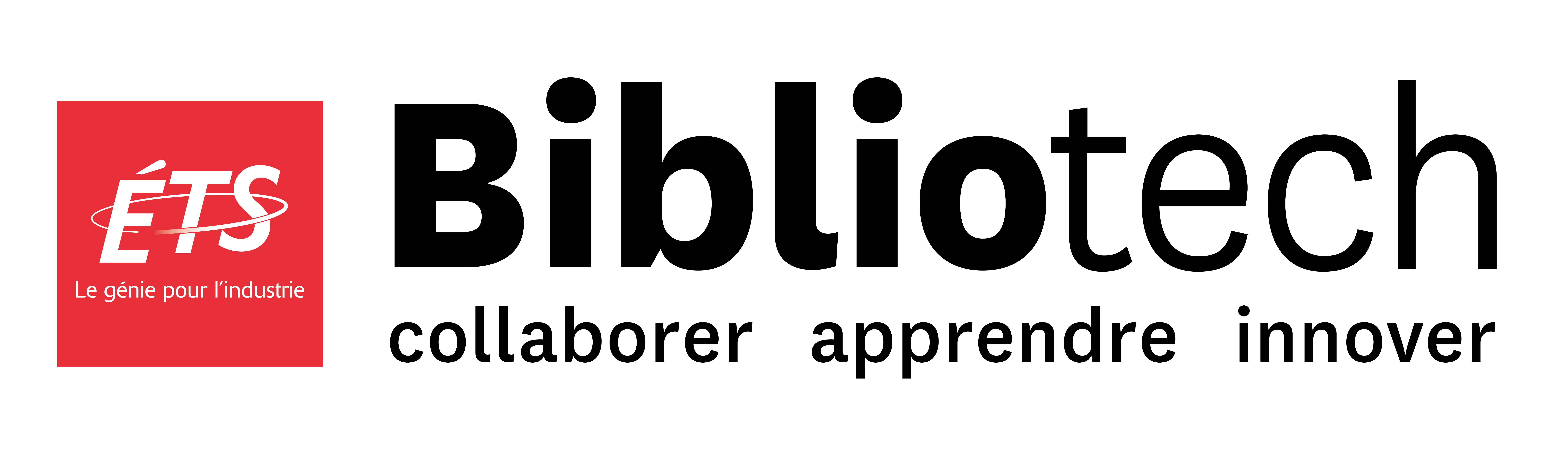Chapitre 2: POUR QUOI ET POUR QUI
Luc K. Audebrand; Patrice C. Ahehehinnou; et Gabriel Huot
Introduction
Ce chapitre portera sur l’explication du pour qui ou pour quoi qui représente une partie de l’engagement social selon la définition de la Chaire de leadership en enseignement sur l’engagement social. Cette partie met en lumière envers qui ou quoi s’engagent une personne, un groupe et une organisation, soit afin de contribuer au mieux-être de leurs proches, d’une communauté, de l’humanité ou plus largement de la vie sur Terre. Le chapitre abordera dans un premier temps la notion de mieux-être incluant le mieux-être collectif, le mieux-être de la personne engagée et les interactions entre le mieux-être collectif et le mieux-être individuel. Une fois ces nuances établies, il abordera, dans un deuxième temps, plus directement le pour qui ou pour quoi de l’engagement social, soit les proches, les communautés, l’humanité et la vie sur Terre.
2.1 Le mieux-être
La définition retenue de l’engagement mobilise le terme mieux-être plutôt que celui de bien-être. Le concept de mieux-être est cohérent avec une vision dynamique des choses (où l’on cherche par exemple à améliorer les choses de jour en jour) alors que celui de bien-être évoque davantage une certaine fixité (où un état donné est recherché). Comme précisé dans l’introduction, dans certains cas le mieux-être implique une guérison ou une cicatrisation et dans d’autres cas, un progrès ou une transformation.
L’indice canadien du mieux-être définit le mieux-être comme étant « la présence de la plus haute qualité de vie possible dans toute son ampleur d’expression centrée, mais pas nécessairement exclusivement, sur : de bons niveaux de vie, une santé solide, un environnement durable, des communautés dynamiques, une population scolarisée, un emploi du temps équilibré, de hauts niveaux de participation démocratique, ainsi que l’accès et la participation aux loisirs et à la culture » (Indice canadien du mieux-être, 2016, p. 11). Le mieux-être est donc l’état de santé et de bien-être le plus favorable d’un individu ou d’une communauté. Que ce soit sur le plan individuel, familial ou communautaire, le mieux-être correspond à l’équilibre entre les dimensions physique, mentale, émotionnelle et spirituelle. Par exemple, selon le cadre du mieux-être autochtone, le mieux-être mental passe par :
un renforcement de cet équilibre et de cette interconnexion chez les individus qui ont un but dans leur vie quotidienne, que ce but passe par l’éducation, l’emploi, la prestation de soins ou une façon d’être et de faire ancrée dans la culture; qui entretiennent à l’égard de leur avenir et de celui de leur famille un espoir qui repose sur un sentiment d’identité, des valeurs autochtones uniques et une croyance en l’esprit; qui éprouvent un sentiment d’appartenance et d’attachement relativement à leur famille, à leur communauté et à leur culture; et qui ont le sentiment que la vie a un sens et qui comprennent de quelle façon leur vie et celles des membres de leur famille et de leur communauté s’inscrivent dans la création et dans une histoire riche (Santé Canada, 2015, p. 4).
De ce même cadre, les aspects qui favorisent chacune des quatre dimensions du mieux-être ont été mis en évidence, partant de la croyance commune que le mieux-être s’intéresse à la personne dans son ensemble :
- Le mieux-être spirituel est favorisé par le lien avec les croyances, les valeurs et l’identité;
- Le mieux-être émotionnel est favorisé par les relations, une attitude marquée par la volonté de vivre pleinement sa vie et le maintien de liens avec sa famille et sa communauté;
- Le mieux-être mental est favorisé par la prise en compte des pensées intuitives autant que des pensées rationnelles, et par la compréhension issue de leur équilibre;
- Le mieux-être physique s’exprime par une façon d’être et de faire autochtone unique, et suppose que l’on prenne soin de son corps comme de la « demeure de son esprit ».
- La recherche du mieux-être des autres et la façon d’y contribuer, à travers la satisfaction de besoins personnels, organisationnels et collectifs, sont les principales sources de motivation des personnes engagées. Le mieux-être collectif est le mieux-être d’un plus grand nombre d’individus ou d’une communauté déterminée.
2.1.1 Le mieux-être collectif
Il n’existe pas d’engagement social sans motivation. Les individus s’impliquent dans une cause parce qu’ils ont une raison de le faire. Les motivations sont les raisons qui poussent les individus à s’engager dans une cause sociale, à un moment donné, de façon individuelle ou collective. Dans son approche économique des motivations des bénévoles, Prouteau (2002) identifie trois modèles : le modèle de biens collectifs, le modèle de consommation de biens privatifs et le modèle d’investissement. Le premier est lié au mieux-être collectif et les deux autres au mieux-être de la personne engagée (abordé plus loin). Dans le modèle de biens collectifs, l’individu s’engage dans le but de contribuer à la réalisation des services associatifs destinés à autrui. La motivation de l’individu, dans ce modèle, est d’être un facteur de production de biens collectifs. Dans la notion de collectif, Prouteau (2002) inclut la famille et les proches de l’individu qui peuvent eux aussi bénéficier des actions issues de son engagement. C’est le cas, par exemple, d’une personne qui crée une association à but non lucratif ou une fondation afin de collecter des fonds qui seront destinés à trouver un remède contre une maladie rare dont souffre également son enfant. Bien que son engagement bénéficie aux autres, son enfant en bénéficiera également. Ce modèle de biens collectifs renvoie aux motivations orientées vers les autres selon Konrath et al. (2012), impliquant un désir ardant d’aider les autres ou de contribuer à leur mieux-être tout en considérant leur désir dans la volonté de s’engager socialement. Cette conception conduit « à rechercher l’intérêt général, un partage de la richesse, des savoirs, des beautés de la nature, une reconnaissance de notre interdépendance et, donc, de notre besoin de solidarité » (David, 2004, p. 1).
Un concept apparenté aux thématiques de cette section est celui de comportement prosocial qu’Eisenberg et al. (2016) définissent comme un comportement volontaire destiné à bénéficier à autrui comme aider, donner, partager et réconforter. Le mieux-être d’autrui et le désir de venir en aide sont souvent à la base de l’engagement social d’une personne. À titre d’exemple, on peut citer le don de sang. Cette action peut être motivée dans le but d’aider les autres et de se sentir utile pour autrui.
Approches bidirectionnelles
Comme précisé dans l’introduction de ce manuel, l’adjectif « social » du concept d’engagement social renvoie en fait à la nature de l’engagement plutôt qu’à son objet. Le mot « social » se rapporte aux liens que des individus établissent et entretiennent entre eux. L’engagement se fait donc à travers des relations et des interactions. Agir pour le mieux-être des collectivités ne sous-entend pas un mode unidirectionnel. La vision que nous proposons repose en fait sur une approche bidirectionnelle, à l’écoute des besoins et des savoirs de la société civile.
Le secteur québécois de la philanthropie, plus particulièrement celui des fondations privées, a d’ailleurs été critiqué pour avoir longtemps adopté une attitude directive envers leurs bénéficiaires où « un rapport d’imposition d’expertise et de manières de faire s’installe entre les bailleurs de fonds et les intervenants des milieux communautaires » (Ducharme, 2012). Comparativement aux donateurs et donatrices, les organismes soutenus disposent dans la plupart des cas d’une expertise supérieure en lien avec leur champ d’action et d’une compréhension fine des besoins locaux, et ils sont à même d’identifier les solutions les mieux adaptées. Le don sans restriction (aussi appelé don à la mission) se distingue de l’approche directive. Ce type de don est fourni aux organismes de bienfaisance sans condition; les organismes peuvent ainsi utiliser l’argent de ce financement pour mener à bien leur mission. Ce type de don se distingue des dons dirigés qui seront orientés vers des activités spécifiques d’un organisme ou même vers un projet sur mesure (Imagine Canada, 2022).
« Si vous êtes la personne qui détient l’argent, le pouvoir est déséquilibré. Personne n’aime en parler. L’obstacle le plus important à la mise en œuvre des financements sans restriction est l’abandon du contrôle. C’est le vrai problème. Cela n’a rien à voir avec l’impact ou le résultat. Tout se résume à la dynamique du pouvoir. »
Laura Manning, directrice générale, Fondation Lyle S. Hallman (citée dans Imagine Canada, 2022, p. 22)
L’approche de Centraide Québec et Chaudière-Appalaches quant au financement des organismes qu’elle soutient est un bon exemple. En effet, le Fonds des organismes associés (son principal levier d’investissement) permet de « défrayer [sic] les coûts liés au fonctionnement général : activités régulières, ressources humaines, locaux et espaces de travail, vie associative, action locale, et autre, il permet donc de soutenir la mission globale, au-delà des projets ponctuels ou temporaires » (Centraide Québec et Chaudière-Appalaches, 2022, p. 2).
Le respect de l’expertise de l’autre est également important pour les autres formes d’engagement social. Cette attitude est notamment pertinente pour une personne membre du conseil d’administration d’un organisme puisqu’elle ne possède généralement pas autant d’expertise quant au champ d’action de l’organisme, comparativement au personnel de ce dernier. Il est important que les processus de prise de décision d’un conseil d’administration valorisent les savoirs (savoirs locaux, savoir-faire, etc.) du personnel. Il est donc essentiel de travailler non seulement pour le mieux-être des collectivités, mais également avec celles-ci, en considérant leurs besoins et leurs savoirs. En fait, porter attention aux besoins des collectivités permet de réellement contribuer à leur mieux-être. Il importe également d’être attentif aux savoirs de celles-ci, afin d’éviter le préjugé d’expertise.
La Déclaration d’engagement social de l’Université Laval (2024), rédigée de manière participative par les membres de sa communauté universitaire, adopte d’ailleurs une telle approche bidirectionnelle dans l’un de ses articles : « nous déclarons notre volonté à nous engager socialement […] par notre dialogue avec la société civile, en considérant ses besoins et savoirs, autant dans la définition que dans la réalisation de nos activités d’enseignement, de recherche et de service à la collectivité, permettant ainsi d’accroître les retombées sociales de celles-ci » (6e puce).
Un parallèle peut être fait avec le concept de rhizome, tel que présenté par Deleuze et Guattari (2013), s’inspirant de la botanique où certaines plantes n’ont pas de racines, mais un réseau de rhizomes les connectant. Appliquer le concept de rhizome à l’engagement social nous incite à voir celui-ci comme étant fondé sur des relations bidirectionnelles et d’égal à égal, où les interactions sont flexibles et volontaires (non-directives).
2.1.2 Le mieux-être de la personne engagée
Les motivations associées au mieux-être de la personne engagée visent principalement cinq buts non forcément distincts : (a) la compréhension du monde, (b) l’amélioration de l’estime de soi, (c) le développement des savoirs, (d) l’évolution professionnelle et (e) l’agrandissement des relations sociales. Certaines personnes visent simultanément plusieurs de ces buts. Pour Konrath et al. (2012), le but envisagé explicitement est une récompense personnelle comme améliorer son humeur ou son estime de soi, échapper à ses problèmes ou apprendre une nouvelle compétence.
Les motivations animées par l’amélioration de l’estime de soi peuvent notamment être liées au sentiment d’utilité sur le plan social par la contribution au mieux-être d’autrui. L’engagement social, par des initiatives personnelles ou communautaires, peut constituer une occasion d’acquérir de nouveaux savoirs ou d’approfondir son savoir-faire, son savoir-être, son savoir-apprendre ou savoir-agir. (voir chapitre 6). L’ensemble de ces savoirs acquis après une réflexion sur son engagement social peut permettre de nourrir le curriculum vitae et d’améliorer l’employabilité de la personne engagée. La progression dans une carrière peut faire partie des motivations de l’engagement social d’une personne. L’engagement permet aussi à une personne de construire ou d’agrandir son réseau social au contact d’autres personnes également impliquées socialement. Clary et al. (1988), de leur côté, ont développé un modèle à six dimensions sur les récompenses ou les satisfactions que peuvent tirer certains individus de leur engagement social, notamment en tant que bénévoles. Les six dimensions ou récompenses se présentent comme suit : (a) l’expression des valeurs, (b) la compréhension, (c) les relations sociales, (d) la gestion de la carrière, (e) la protection et enfin, (f) le développement personnel.
L’expression des valeurs réside dans la satisfaction que ressent une personne en exprimant son intérêt pour le mieux-être des autres. De son côté, la compréhension est liée à la récompense que reçoit une personne engagée dans l’acquisition de nouvelles expériences d’apprentissage, mais également dans l’exercice des connaissances, des compétences et des aptitudes qui n’est possible qu’à travers son engagement. Les relations sociales, quant à elles, sont la possibilité qu’offre l’engagement social de renforcer ses liens sociaux avec ses amis et ses proches, mais également d’exercer une action qui est bien perçue par son entourage. La quatrième dimension, la gestion de la carrière, est liée à l’acquisition de différentes expériences et aux avantages que cela procure sur la carrière d’une personne. La protection, quant à elle, permet à la personne engagée de réduire le sentiment de culpabilité en lien avec le fait d’être plus privilégié que les autres et de résoudre ses difficultés individuelles. Enfin, le développement personnel est la satisfaction liée au renforcement de l’estime de soi, à l’épanouissement personnel puis à des sentiments positifs.
Allant dans le même sens, le modèle de consommation de biens privatifs et le modèle d’investissement de Prouteau (2002), comme mentionné un peu plus haut, sont liés au mieux-être personnel. Dans le modèle de consommation de biens privatifs, l’engagement social d’une personne est motivé par les différentes satisfactions qu’elle en tire comme la satisfaction psychologique que lui procure son implication. Dans le modèle d’investissement, la motivation de la personne engagée provient de « l’anticipation de « retours » futurs qui prennent essentiellement la forme d’opportunités [sic] nouvelles » (paragr. 10).
L’engagement social a un vaste éventail de retombées sur la santé des personnes engagées. Les motivations orientées vers les autres contribuent notamment à « de meilleures conditions de santé pour les personnes qui s’y engagent en ce sens qu’elles peuvent aider à promouvoir un sentiment de bien-être profond et durable provenant du service à quelque chose de plus grand que soi, mais également protéger les bénévoles contre les facteurs de stress potentiels qui se produisent dans la vie quotidienne, ou même qui peuvent résulter de l’expérience de bénévolat elle-même » (Lesemann, 2002, p. x). Les retombées positives peuvent toucher autant la santé physique, mentale que sociale, jusqu’à faire de l’engagement social une saine habitude de vie à part entière (voir chapitre 7).
Les interactions entre le mieux-être collectif et le mieux-être individuel
La reconnaissance de la dignité des personnes est une valeur centrale à l’engagement social […]. Celle-ci apparaît particulièrement importante afin de démarquer les pratiques contemporaines de l’engagement social des pratiques du passé, plus ancrées dans un esprit d’obligation où la personne devait se dévouer sans souci d’elle-même.
Dominique Morin, professeur titulaire, Faculté des sciences sociales, Université Laval, 2022
Il y a lieu de voir le mieux-être collectif et le mieux-être de la personne engagée comme étant complémentaires et pouvant donc cohabiter à travers le geste de l’engagement social. Le mieux-être individuel et le mieux-être collectif peuvent être vus comme étant interreliés dans un contexte d’engagement social. Le bénévolat génère des bienfaits sur la santé de la personne engagée, tout en étant source d’apprentissage pour celle-ci. Le fait de se départir de sommes monétaires ou de biens dans le cadre d’un don peut contribuer positivement au mieux-être de la personne donatrice (voir chapitre 7).
Il y a également une pertinence à laisser une place à la bienveillance à l’égard des personnes engagées, souvent susceptibles de surmenage et d’épuisement professionnel. La notion de sacrifice est d’ailleurs à transcender. Du fait de leur implication totale dans leur engagement, une personne engagée peut atteindre un état de fatigue physique, émotionnelle et mentale qui peut l‘handicaper ou la freiner dans la poursuite de ses actions sociales. L’organisation aidée cessera de bénéficier de cet engagement si le tout mène à l’épuisement Plusieurs causes peuvent conduire à cet épuisement chez une personne engagée dont la surcharge de travail et la pression temporelle, le faible contrôle de son travail, les récompenses insuffisantes, la perte de sentiment d’appartenance et soutien social, le manque d’équité ou encore le conflit de valeurs (Cottin-Marx, 2023).
L’individualisme n’est pas nécessairement source de mieux-être individuel, il peut en fait avoir l’effet inverse comme le souligne ici Yvon Charest dans les deux citations suivantes:
La face sombre de l’individualisme, c’est de nous éloigner du souci des autres et de la communauté. Cette face sombre amène un repli sur soi qui aplatit et rétrécit nos vies pour utiliser les propos de Charles Taylor, philosophe québécois, qui a écrit le livre « Grandeur et misère de la modernité ». […]
Se pourrait-il que l’individualisme contribue assez fortement à se mettre soi-même une belle couche de pression qui mène à l’anxiété, au surmenage, voire à l’envie et à la jalousie? Se pourrait-il que l’individualisme qui pousse à la perfection explique en bonne partie la montée en flèche du nombre de personnes souffrant des problèmes de santé mentale? Et si c’est le cas, est-il possible de renverser la vapeur et de laisser à autrui le soin d’être parfait et merveilleux, de consacrer une partie de notre temps à la communauté, de faire preuve d’entraide que nos gestes soient reconnus ou pas, de penser un peu moins à la réussite individuelle et un peu plus à celle des gens dans le besoin?
Yvon Charest, ex-président et chef de la direction d’iA Groupe financier, 2024
Le « chacun pour soi » a plusieurs adeptes. Selon cette philosophie, les gens sont divisés entre gagnants et perdants. Les gens se comparent tout le temps aux autres pour les dépasser. […] le « chacun pour soi » est associé à des émotions parfois désagréables comme l’envie, la jalousie ou l’inquiétude de ne pas toujours être le meilleur ou la meilleure. […]
Les « tous pour un » sont également très motivés à réussir leur vie, mais leur approche est différente. Ces gens se comparent aux autres pour s’améliorer personnellement, et non pas pour clamer qu’ils sont les meilleurs. […] la philosophie du « tous pour un » est souvent associée à des émotions agréables comme la satisfaction de contribuer à une société vivante et responsable.
À mon avis, l’individualisme dans une société ne fait que des perdants… des perdants parce que les relations humaines s’effritent et des perdants parce que le stress se glisse dans la peau des gens.
Yvon Charest, ex-président et chef de la direction d’iA Groupe financier, 2024
Pendant longtemps, les motivations de l’engagement social chez une personne ont été évaluées à la lumière du spectre de la dualité entre l’altruisme et l’égoïsme. L’altruisme est défini comme une « disposition de caractère qui pousse à s’intéresser aux autres, à se montrer désintéressé » (Larousse en ligne, 2024a) alors que l’égoïsme est pour sa part défini comme un « attachement excessif porté à soi-même et à ses intérêts, au mépris des intérêts des autres » (Larousse en ligne, 2024b). Ainsi, les raisons qui poussent une personne à s’engager dans une cause étaient liées soit à des intérêts personnels, soit à des intérêts tournés vers les autres. Cette dualité est toutefois problématique. Tel qu’illustré dans les paragraphes précédents, l’engagement social d’une personne peut contribuer à son mieux-être, tandis que l’individualisme peut avoir l’effet inverse. De plus, les sacrifices d’une personne engagée peuvent mener à son épuisement et ainsi limiter sa contribution au mieux-être collectif.
Afin de transcender la dualité altruisme-égoïsme, il est intéressant de s’inspirer des perspectives du philosophe du XVIIe siècle, Baruch Spinoza, qui connaît un regain d’intérêt depuis les dernières décennies. Dans la philosophie de Spinoza, la séparation entre une personne et les autres est tenue pour illusoire (Brykman, 1973). Dans cette perspective, un engagement social pourrait donc reposer sur une vision qui dissout cette séparation. Spinoza n’utilise pas le terme « engagement social » bien évidemment, mais Santerre-Crête (2011) mentionne qu’il utilise toutefois celui de générosité, où celle-ci serait basée sur une fusion de l’intérêt pour autrui et de l’intérêt pour soi. Selon Lazerri (cité dans Santerre-Crête, 2011, p. 106), chez Spinoza, l’intérêt personnel devient altruiste, permettant de « dépasser la problématique de l’opposition entre égoïsme et altruisme ».
Une personne qui s’engage au sein d’un organisme œuvrant en faveur de la biodiversité peut baser son engagement sur le fait qu’elle ne conçoit pas de séparation entre son mieux-être et celui du reste de la vie sur Terre. L’organisme Conservation de la nature Canada (2024) fonde d’ailleurs ses actions sur une perspective similaire : « Le lien entre les humains et la nature constitue le fondement de Conservation de la nature Canada; l’idée est que nous ne faisons qu’un avec la nature » (1er paragr.).
Nous pouvons parfois avoir l’impression que nous devons nous sacrifier ou nous dépasser pour une cause qui nous est supérieure. Mais cela nous amène alors dans une logique dualiste, selon laquelle il y aurait une vie à l’extérieur de nous et une vie en nous, où ces deux choses seraient séparées, alors que ce n’est pas le cas. Cette logique dualiste peut pousser la personne à l’épuisement. Il est pourtant essentiel de prendre soin des personnes qui servent la vie et il est donc de notre responsabilité de prendre soin de nous-mêmes à travers notre engagement.
Charles Baron, professeur titulaire, Faculté des sciences de l’administration, 2022
2.2 Le POUR QUI et le POUR QUOI de l’engagement social
Dans cette section, il sera question des personnes identifiées comme bénéficiaires de l’engagement social, celles vers qui sont orientées les actions menées lorsqu’une personne s’implique dans une cause sociale. Les notions de proche, de communauté, d’humanité et de vie sur Terre y seront développées.
2.2.1 L’engagement envers les proches
Comme mentionné dans le premier chapitre, l’engagement social d’une personne prend souvent sa source dans son environnement immédiat, ses premiers lieux de socialisation comme la famille, ses amis et amies ou ses collègues de travail. Lorsque des membres d’un cercle restreint sont touchés par une cause, l’engagement des autres personnes du cercle devient inévitable. Elles s’impliquent, car cette cause les touche personnellement et elles y trouvent une manière d’apporter leur soutien à une personne proche. Selon le Bureau de normalisation du Québec (2010), une famille proche est définie comme « un groupe de personnes liées par la naissance, par alliance ou par d’autres relations, culturellement reconnues comme constituants la famille proche comme les conjoints, les partenaires, les parents, les frères et les sœurs, les enfants, les parents adoptifs et les grands-parents » (p. 5). La notion de proche, ici, est vue de manière un peu plus large que les personnes ayant des liens familiaux. Elle englobe également les autres personnes de l’environnement immédiat comme les amis et amies ainsi que les collègues avec qui des liens sociaux très forts sont partagés.
La proche aidance s’inscrit dans ce type d’engagement visant le mieux-être des proches. Par proche aidance, nous entendons :
une personne qui apporte un soutien à un ou à plusieurs membres de son entourage qui présentent une incapacité temporaire ou permanente de nature physique, psychologique, psychosociale ou autre, peu importe leur âge ou leur milieu de vie, avec qui elle partage un lien affectif, familial ou non. Le soutien apporté est continu ou occasionnel, à court ou à long terme, et est offert à titre non professionnel, de manière libre, éclairée et révocable, dans le but, notamment, de favoriser le rétablissement de la personne aidée et le maintien et l’amélioration de sa qualité de vie à domicile ou dans d’autres milieux de vie. Il peut prendre diverses formes, par exemple le transport, l’aide aux soins personnels et aux travaux domestiques, le soutien émotionnel ou la coordination des soins et des services. Il peut également entraîner des répercussions financières pour la personne proche aidante ou limiter sa capacité à prendre soin de sa propre santé physique et mentale ou à assumer ses autres responsabilités sociales et familiales. (Gouvernement du Québec, 2024, p. 1)
Une étude réalisée en 2018 par Statistiques Canada (Hango, 2020) montre que 25 % de la population canadienne âgée de 15 ans et plus a prodigué des soins ou fourni de l’aide à une personne proche souffrant d’un problème de santé de longue durée, d’une incapacité ou de problèmes liés au vieillissement. Le soutien qu’apporte une personne proche aidante, à travers son engagement social, peut contribuer à diminuer certains effets négatifs sur la santé d’une personne, à favoriser le mieux-être physique et psychologique de la personne qui reçoit les soins, mais également à renforcer les liens sociaux.
2.2.2 L’engagement envers une communauté
Il est fréquent d’entendre des personnes justifier ou motiver leurs actions sociales par « Je le fais pour le bien de ma communauté ». Que représente cette notion de communauté? La communauté peut être associée à un territoire ou à une partie d’un territoire (un quartier ou une région) regroupant des personnes ayant ou pas des affiliations entre elles. Les membres de ce type de communauté s’engagent souvent pour le mieux-être des habitants de leur territoire.
La communauté peut aussi se définir comme « un groupement en constante évolution (dont la taille varie) qui, par les interrelations entre ses membres, produit un sentiment d’appartenance et une identité sociale permettant à ses membres de prendre conscience de leur existence comme groupe et favorisant leur unité et leur potentiel social » (Montero, 2007, p. 207). À partir de cette définition, Garneau et Adjizian (2020) ont développé un modèle intégrateur du concept de communauté qui se présente en deux parties : la première explique les trois composantes du concept de communauté et la deuxième, les trois environnements présents dans chaque type de communauté. Les trois composantes de la communauté, selon ces auteurs, sont : l’identité collective, la solidarité entre ses membres et l’agentivité (figure 2.1, modèle intégrateur du concept de communauté).
Figure 2.1 Modèle intégrateur du concept de communauté
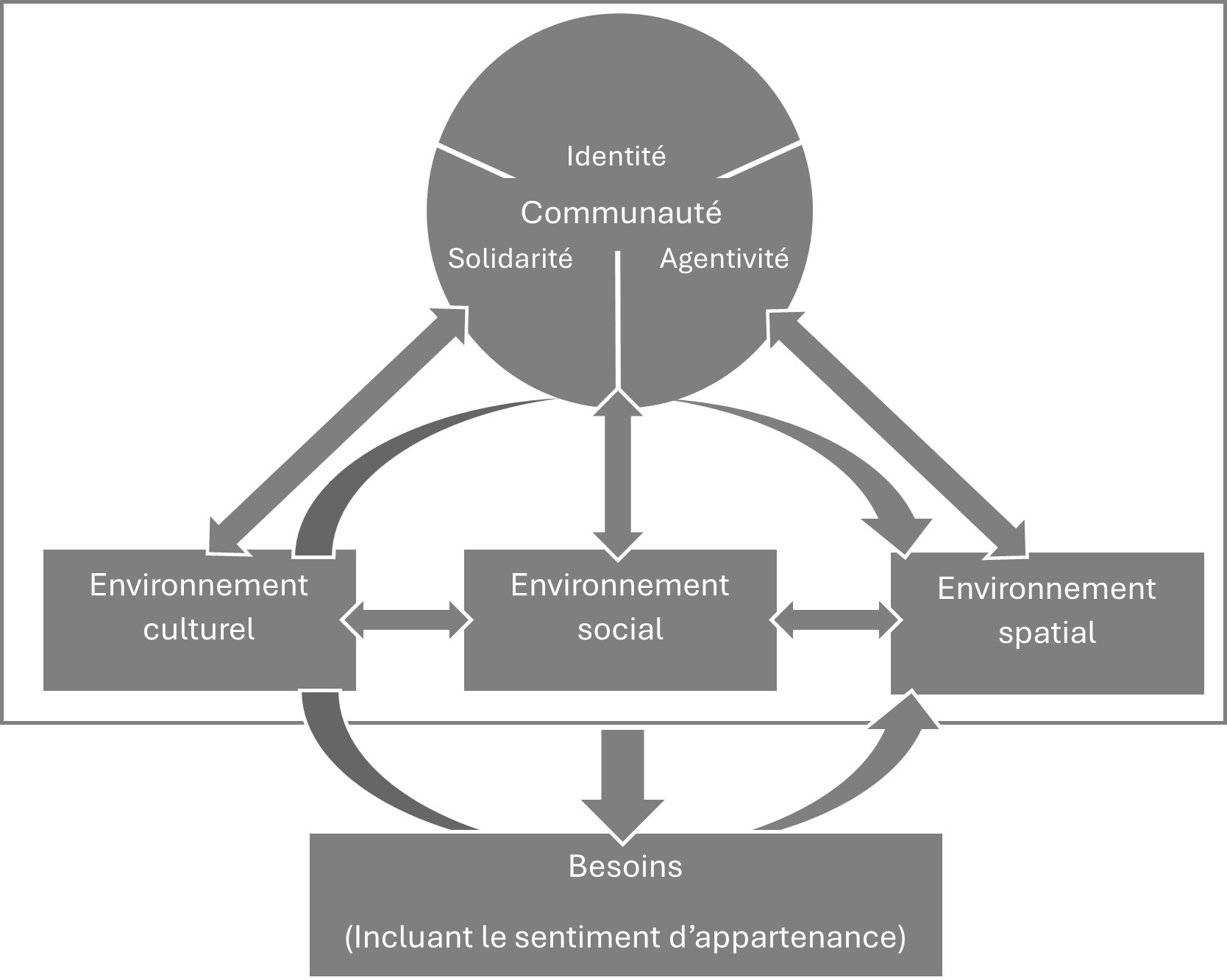
L’identité collective est liée à une culture partagée par les membres d’une communauté et constituée de valeurs et de croyances, d’une histoire collective et de mythes, de symboles, de rituels et de célébrations. L’identité collective d’une communauté, selon Garneau et Adjizian (2020), apparaît notamment lors des événements de sociabilité qui sont faits dans des endroits physiques ou autres. C’est cette identité collective ou culturelle dans laquelle se reconnaissent les membres d’une communauté qui crée chez eux un sentiment d’appartenance à celle-ci. C’est le cas de la communauté afro-américaine, dont l’identité collective est liée à sa culture, notamment sa musique, sa manière de s’habiller et de se comporter différemment des autres. L’identité collective est la composante qui différencie une communauté d’une autre.
La solidarité, la deuxième composante, est caractérisée par l’union entre les membres d’une communauté, mais également par les normes de réciprocité et de confiance qui dirigent les interactions entre eux. Selon les auteurs, c’est le sentiment d’interdépendance entre les membres qui différencie une communauté d’une association de personnes. La solidarité des membres d’une communauté s’exprime souvent lors de la défense des causes ou en réaction à une injustice touchant un ou une membre de cette communauté. C’est souvent le cas lorsque des Afro-Américains sont victimes de racisme. Les membres de cette communauté se mobilisent et s’engagent socialement dans le but de manifester leur indignation en faisant preuve de solidarité.
La dernière composante, l’agentivité, est définie comme la capacité des membres d’une communauté à exercer eux-mêmes un contrôle et une régulation de leurs actions dans le but de développer leur communauté. Garneau et Adjizian (2020) indiquent que l’agentivité provient de trois sources formelles ou informelles : la solidarité du groupe (leur capital social), le mode d’organisation des membres de cette communauté et les expériences positives et éducatives issues d’initiatives communautaires.
Ces trois composantes sont en interrelations avec les trois environnements de la communauté que sont l’environnement culturel, l’environnement social et l’environnement spatial. Cette conceptualisation de la communauté permet d’en distinguer plusieurs types : les communautés culturelles, les communautés linguistiques, les communautés ethniques, etc.
Notons qu’il est toutefois possible pour une personne de s’engager en faveur d’une communauté à laquelle elle n’appartient pas. À titre d’exemple, il est possible pour une personne allochtone de s’engager en faveur des Premiers Peuples.
Les autres types de communautés
Au-delà de cette conceptualisation de la notion de communauté, il existe d’autres types de communautés qui ne répondent pas forcément aux trois composantes décrites par Garneau et Adjizian (2020). Il s’agit des groupements de personnes liées par leur situation, telle qu’une situation de santé et de vulnérabilité comme la communauté des handicapés ou des personnes vivant avec un cancer ou une maladie chronique. Les membres de ces types de communautés ne se reconnaissent pas forcément entre eux comme faisant partie d’un seul grand groupe uni. L’engagement envers ces communautés renforce toutefois le tissu social et démontre une compréhension de leur situation ainsi qu’une solidarité envers eux.
2.2.3 L’engagement envers l’humanité
En dehors de l’engagement social envers des proches ou des communautés spécifiques, certaines personnes s’engagent à un niveau un peu plus large en s’impliquant dans des causes visant l’humanité en général.
Les engagements envers l’humanité visent notamment la défense de grands principes qui se veulent universels tels que les droits de la personne. Il s’agit ici d’exemples des droits contenus dans la Déclaration universelle des droits de l’homme (Organisation des Nations Unies, 2024) qui définit les droits civils, politiques, économiques, sociaux et culturels pouvant être exercés par chaque personne. L’engagement social pour l’humanité peut alors prendre forme dès qu’un de ces droits n’est pas respecté ou est violé sans que justice ne soit rendue. Il s’agit, par exemple, du droit à la non-discrimination, du droit à l’égalité entre les hommes et les femmes, du droit à l’éducation, du droit à la vie, à la liberté et à la sécurité de sa personne, du droit à la liberté d’expression, du droit à l’égalité, etc.
Les défenseurs des droits de la personne se battent pour n’importe quel droit humain en cherchant « à promouvoir et [à] protéger les droits civils et politiques ainsi qu’à promouvoir, [à] protéger et [à] mettre en œuvre les droits économiques, sociaux et culturels » (Organisation des Nations Unies, 2004, p. 2). Les actions des personnes qui s’engagent pour l’humanité peuvent être menées au niveau local, national, régional ou international. Pour le Haut-Commissariat des Nations Unies aux droits de l’homme, un défenseur des droits de l’homme ou des droits de la personne se définit comme toute personne qui agit individuellement ou en groupe pour promouvoir ou protéger les droits de la personne de façon pacifique. Dans le quatrième alinéa du préambule de la Déclaration sur les défenseurs des droits de l’homme, un défenseur des droits de la personne désigne tous les « individus, groupes et associations [qui contribuent à] l’élimination effective de toutes les violations des droits de l’homme et des libertés fondamentales des peuples et des personnes […] ». (Organisation des Nations Unies, 1999, p. 2)
L’engagement envers les personnes victimes de violations des droits de la personne consiste à enquêter sur les situations de violation en mobilisant les autorités publiques et juridiques aux niveaux national et international pour y remédier. D’autres personnes engagées peuvent également offrir aux victimes une assistance pour leurs actions en justice et une assistance pour toute la durée du processus. Dans l’engagement social pour l’humanité, il n’existe pas forcément de groupes précis ciblés, bien que les violations des droits de la personne puissent toucher certaines communautés ou les populations vivant dans des pays en crise ou sous un régime dictatorial.
Au-delà des droits de la personne, l’engagement social envers l’humanité peut également prendre la forme de l’implication dans des conditions communes à l’ensemble de l’humanité telles que le contexte de la crise climatique et environnementale. Par son engagement dans la lutte contre le réchauffement climatique et par ses efforts à conscientiser les gouvernements et les populations à la menace existentielle que constitue cette crise, la militante et écologiste suédoise Greta Thunberg est un exemple de ce type d’engagement qui cible l’humanité. La crise climatique et environnementale n’affecte d’ailleurs pas que l’humanité, mais aussi la vie sur Terre, envers laquelle il est également possible de s’engager.
2.2.4 L’engagement envers la vie sur Terre
Restreindre la définition de l’engagement social aux proches, à une communauté ou à l’humanité aurait comme effet de placer l’être humain au cœur des préoccupations et d’ainsi adopter une posture anthropocentrique. L’anthropocentrisme est « une conception philosophique qui considère l’humain comme l’entité centrale la plus significative de l’Univers et qui appréhende la réalité à travers la seule perspective humaine » (Anthropocentrisme, 2024, 1er paragr.). Intégrer la vie sur terre aux considérations de l’engagement social permet ainsi d’avoir également à cœur le mieux-être des autres êtres vivants.
Une action en faveur du mieux-être de la vie sur Terre peut, entre autres, s’appuyer sur une perspective biocentrique. Contrairement à l’anthropocentrisme, le biocentrisme est une conception qui accorde une dignité morale non seulement aux êtres humains, mais également à tous les autres êtres vivants sur la terre. L’écocentrisme, de son côté, accorde la même dignité morale et la même valeur intrinsèque à la biosphère ainsi qu’à la nature. Ces conceptions éthiques et philosophiques font des autres êtres vivants et de la nature des sujets de droit au même titre que l’être humain et méritent donc qu’on défende leurs intérêts lorsqu’ils sont victimes d’injustices.
Des personnes, des groupes et des organisations s’engagent pour la protection des droits des animaux. C’est le cas de la Société pour la prévention de la cruauté envers les animaux de Montréal, créée depuis 1869, dont la mission consiste « à protéger les animaux contre la négligence, les abus et l’exploitation, à représenter leurs intérêts et [à] assurer leur bien-être, à favoriser la conscientisation du public et [à] contribuer à éveiller la compassion pour tout être sensible » (Société pour la prévention de la cruauté envers les animaux, 2024, Mission et politiques). Ailleurs, on retrouve en France la Société Protectrice des Animaux et au Royaume-Uni, la Royal Society for the Prevention of Cruelty to Animals qui ont la même mission que la Société pour la prévention de la cruauté envers les animaux.
L’engagement social visant le mieux-être de la vie sur Terre pourra également avoir comme objectif la protection d’espèces en péril et la conservation des écosystèmes, comme le fait l’organisme Conservation de la nature Canada, mentionné précédemment, qui agit principalement à travers la conservation des milieux naturels.
Conclusion
Ce chapitre visait à répondre à la question pour quoi ou pour qui une personne s’engage socialement. Il a été démontré dans ce chapitre que l’engagement pour le mieux-être des proches, des communautés, de l’humanité ou de la vie sur Terre peut contribuer au mieux-être de la personne engagée. Au même titre, le mieux-être de la vie sur Terre n’est pas indépendant du mieux-être des proches, d’une communauté et de l’humanité. Cela démontre l’interdépendance entre les objectifs poursuivis à travers l’engagement social d’une personne et ceux pour qui elle s’engage, y compris elle-même.
Questions de réflexion
- En m’appuyant sur des exemples tirés de mon expérience, envers qui ou quoi est-ce que je m’engage, parmi les catégories suivantes : mes proches, une communauté, l’humanité ou la vie sur Terre (un engagement peut être associé à plus d’une catégorie à la fois) ?
- Quelles sont les retombées positives et négatives de mon engagement social sur mon mieux-être ?
- De quelle façon mon engagement s’appuie sur les besoins et les savoirs des collectivités ?
Bibliographie
Anthropocentrisme. (2024, 2 octobre). Dans Wikipédia. https://fr.wikipedia.org/wiki/Anthropocentrisme
Brykman, G. (1973). Spinoza et la séparation entre les hommes. Revue de métaphysique et de morale, 78(2), 174-188.
Bureau de normalisation du Québec. (2010). Normes conciliation travail-famille. https://ftq.qc.ca/wp-content/uploads/sites/8/ftqimport/894.pdf
Centraide Québec et Chaudière-Appalaches. (2022). Cadre de référence – Fonds des organismes associés. https://www.centraide-quebec.com/app/uploads/2022/06/Cadre-de-reference_FOA_juin22.pdf
Centraide Québec, Chaudière-Appalaches et Bas-Saint-Laurent. (2020). Du plomb dans les ailes : Avis sur les inégalités sociales. Septentrion.
Clary, E. G., Snyder, M., Ridge, R. D., Copeland, J., Stukas, A. A., Haugen, J. et Miene, P. (1998). Understanding and assessing the motivations of volunteers: A functional approach. Journal of Personality and Social Psychology, 74(6), 1516-1530.
Conservation de la nature Canada. (2024). Intentions et valeurs. La Société canadienne pour la conservation de la nature. https://www.natureconservancy.ca/fr/nous-connaitre/intention-valeurs/
David, F. (2004). Le bien commun : pour l’égalité et la liberté. Éthique publique – Revue internationale d’éthique sociétale et gouvernementale 6(1). https://doi.org/10.4000/ethiquepublique.2047
Deleuze, G. et Guattari, F. (2013). Mille plateaux. Capitalisme et schizophrénie 2 [1980], Les Éditions de Minuit.
Ducharme, É. (2012). La « nouvelle philanthropie » : Coup d’œil sur les impacts de sa présence en sol québécois. Nouvelles pratiques sociales, (1), 16-29. https://doi.org/10.7202/1008624ar
Eisenberg, N., VanSchyndel S.K. et Spinrad T. L. (2016). Prosocial motivation: Inferences from an opaque body of work. Child Development, 87(6), 1668-1678. https://doi.org/10.1111/cdev.12638
Garneau, J. et Adjizian, J. M. (2020). Loisir et communauté : vers une définition plus universelle du concept de communauté? Loisir et Société / Society and Leisure, 43(2), 217-228. https://doi.org/10.1080/07053436.2020.1788791
Gouvernement du Québec. (2024). Personne proche aidante. https://www.quebec.ca/famille-et-soutien-aux-personnes/personne-proche-aidante
Hango, D. (2020, 8 janvier). Soutien reçu par les aidants au Canada – Regards sur la société canadienne (publication no 75-006-X). Statistique Canada. https://www150.statcan.gc.ca/n1/pub/75-006-x/2020001/article/00001-fra.htm#n6-refa
Imagine Canada. (2022). Lien de confiance et impact : perspectives des bailleurs de fonds sur le financement sans restriction. Lien-de-confiance-et-impact-Perspectives-des-bailleurs-de-fonds-sur-le-financement-sans-restriction.pdf (imaginecanada.ca)
Indice canadien du mieux-être. (2016). Comment les Canadiens se portent-ils véritablement? Le Rapport national de l’ICM 2016. L’Indice canadien du mieux-être et l’Université de Waterloo. https://uwaterloo.ca/indice-canadien-du-mieux-etre/sites/ca.indice-canadien-du-mieux-etre/files/uploads/files/c011676-nationalreport-ciw-french-final_final-s_1.pdf
Konrath, S., Fuhrel-Forbis, A., Lou, A. et Brown, S. (2012). Motives for volunteering are associated with mortality risk in older adults. Health Psychology, 31(1), 87-96.
Larousse (2024a, 20 février). Altruisme. Dans Le dictionnaire Larousse. https://www.larousse.fr/dictionnaires/francais/altruisme/2592
Larousse (2024b, 20 février). Égoïsme. Dans Le dictionnaire Larousse. https://www.larousse.fr/dictionnaires/francais/%C3%A9go%C3%AFsme/28035
Montero, M. (2007). Introduction à la Psicología Comunitaria. [Introduction à la psychologie communautaire]. Éditorial Paidós.
Organisation des Nations Unies. (1999). Déclaration sur le droit et la responsabilité des individus, groupes et organes de la société de promouvoir et protéger les droits de l’homme et les libertés fondamentales universellement reconnus. https://www.ohchr.org/sites/default/files/Documents/Issues/Defenders/Declaration/declaration_fr.pdf
Organisation des Nations Unies. (2004). Les défenseurs des droits de l’homme : protéger le droit de défendre les droits de l’homme. Fiche d’information no 29. https://www.ohchr.org/sites/default/files/Documents/Publications/FactSheet29fr.pdf
Organisation des Nations Unies. (2024). Déclaration universelle des droits de l’homme. https://www.ohchr.org/fr/universal-declaration-of-human-rights
Prouteau, L. (2002). Le bénévolat sous le regard des économistes. Revue française des affaires sociales, 2002(4), 117-134. https://doi.org/10.3917/rfas.024.0117
Santé Canada. (2015). Cadre du continuum du mieux-être mental des Premières nations. https://thunderbirdpf.org/wp-content/uploads/2017/10/24-14-1273-FN-Mental-Wellness-Framework-FR03_low.pdf
Santerre-Crête, R. (2011). Spinoza et le problème de la générosité [mémoire de maîtrise, Université de Sherbrooke]. Québec, Canada. MR88903.pdf (usherbrooke.ca)
Société pour la prévention de la cruauté envers les animaux. (2024). Mission et politiques. https://www.spca.com/mission-et-politiques/
Université Laval. (2024). Déclaration d’engagement social. https://www.ulaval.ca/engagement-social/declaration