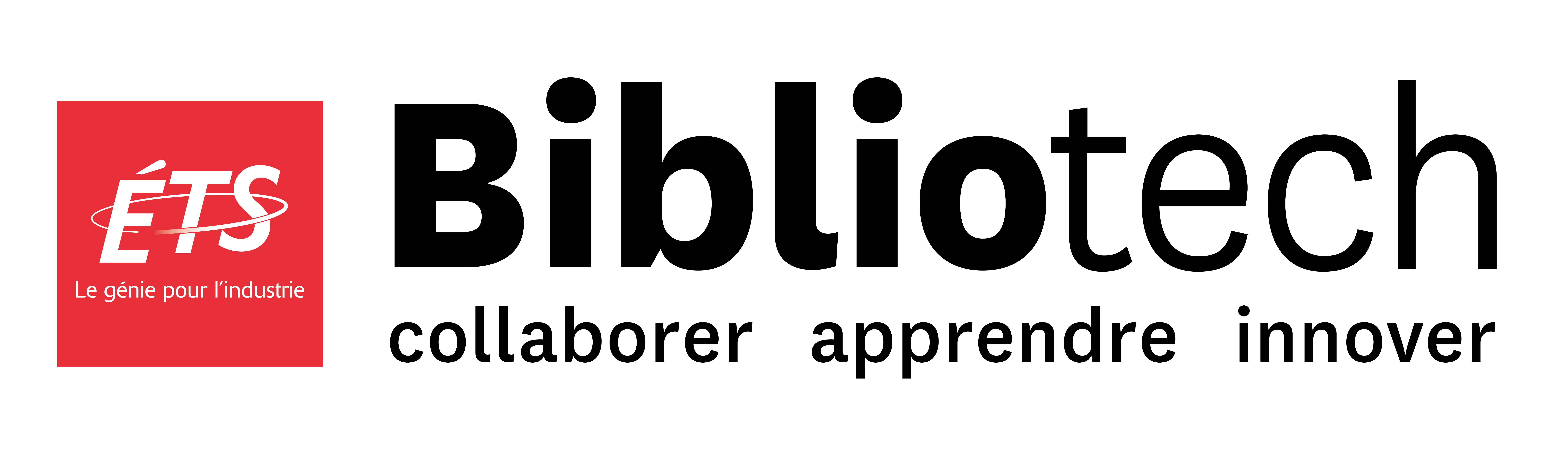Chapitre 1: POURQUOI
Luc K. Audebrand; Patrice C. Ahehehinnou; et Gabriel Huot
Introduction
Comme l’indique Sinek (2015), le pourquoi détermine le rapport qu’une personne entretient avec la cause dans laquelle elle s’engage. C’est sa mission, sa cause, sa croyance, la raison ou ce qui la pousse à faire ce qu’elle fait. Le pourquoi, ici, ne fait pas référence au résultat de ses actions, mais plutôt à ce qui l’inspire, lui donne envie de s’engager. Parler du pourquoi revient à se focaliser sur le lien entre les valeurs, les aspirations ou les expériences de vie de la personne engagée, qui la poussent à agir. Sinek (2015) estime que lorsqu’une personne connaît pourquoi elle s’engage, cela facilite un engagement à long terme. Le pourquoi, c’est aussi avoir une conviction profonde ou croire en un but commun.
Sinek (2015) recommande alors de toujours commencer par déterminer le pourquoi de nos actions et donc de notre engagement avant d’exprimer le comment et le quoi. Nous décidons ainsi de commencer ce livre en nous focalisant sur le pourquoi de l’engagement social d’une personne ou d’un groupe dans une cause. Le pourquoi de notre engagement peut provenir de plusieurs sources dont les plus importantes rapportées dans les écrits scientifiques sont nos valeurs, nos aspirations ou nos expériences de vie. Nous développerons chacun de ces concepts, d’abord en le définissant selon notre conception, puis en montrant le lien avec le sens donné à l’engagement social.
1.1 Causes
Une cause est un ensemble d’intérêts que l’on soutient ou que l’on défend en faveur d’une personne, d’une communauté ou de l’ordre des choses (Larousse, 2025). Une cause est souvent associée à un problème social qui correspond à une difficulté majeure vécue par une partie ou l’ensemble d’une société donnée. Un problème social peut être défini comme suit :
manque, privation, ou besoin non ou mal satisfait par les moyens officiels, vécu dans le présent ou pressenti comme une situation difficile par des acteurs sociaux, jugé problématique et réclamant une solution, c’est-à-dire devant être corrigé ou prévenu grâce à un processus de résolution de problème et la mise en œuvre d’actions. Le problème peut mener à la mise en œuvre d’une lutte collective et/ou d’une innovation sociale. (Bouchard et al., 2016, p. 146)
Un préalable à l’engagement social est d’avoir une conscience du monde et des enjeux sociétaux qui le traversent. Ainsi, il y a une nécessité de prendre conscience de l’état du monde, d’où naîtra une urgence d’agir et, conséquemment, un passage à l’action.
Nolywé Delannon, professeure agrégée, Faculté des sciences de l’administration, 2022
Il existe une multitude de causes. À titre d’exemple, la chaire de leadership en enseignement sur l’engagement social a catégorisé les causes de la façon suivante dans le tableau 1.1 :
Tableau 1.1 Les catégories de causes en engagement social
| Cause | Exemple |
| Arts et culture | Organisation d’un festival, troupe de théâtre amateur); |
| Association au service de ses membres | Association étudiante, professionnelle, syndicale ou d’affaires |
| Loisirs et sport amateur | Coaching d’une équipe sportive |
| Défense de droits et justice sociale | Droits des minorités ethniques ou de genre, droits des personnes vivant avec un handicap, en situation d’itinérance, autochtones |
| Solidarité internationale | Secours d’urgence, projet de solidarité internationale |
| Éducation | Conseil d’établissement des écoles, fondation scolaire, aide aux devoirs, recherche |
| Environnement | Action climatique, protection des animaux, recyclage |
| Politique | Participation bénévole au sein d’un parti politique |
| Religion ou activités spirituelles | Animation de groupes de paroles, catéchèse, préparation de la messe |
| Santé | Bénévolat à l’hôpital, accompagnement des bénéficiaires de soins |
| Services sociaux et conditions de vie | Soutien aux personnes âgées, aux familles, aux jeunes, aux banques alimentaires, au logement |
| Vie de quartier | Jardin collectif, ruelle verte, sécurité et prévention |
Le choix d’une personne de s’engager dans une cause repose souvent sur le sens que cette personne donne à l’action qu’elle entend poser. Qu’est-ce qui construit l’engagement dans une cause sociale chez une personne? Comment s’opère la construction sociale du désir de se dévouer à telle ou telle cause? Plusieurs facteurs favoriseraient la rencontre d’une personne et d’une cause sociale. Pour Becquet et Goyette (2014), « les pratiques sont directement influencées par la possession de dispositions à l’engagement et de propriétés sociales spécifiques, en particulier en termes [sic] d’origine sociale, de niveau d’étude, de genre et de situation sociale » (p. 2). Plus spécifiquement, l’engagement dans une cause sociale peut avoir comme source de motivation une transmission de la fibre d’engagement par les parents aux enfants. Une personne peut aussi s’engager dans une cause, car celle-ci la touche personnellement ou parce qu’elle a été marquée par des expériences de vie liées à cette cause. Certaines personnes avec des profils sociaux liés à leurs trajectoires ou aux différents lieux de socialisation tels que la famille, les réseaux d’amis ou l’environnement professionnel seront plus à même de s’engager dans une ou des causes qui s’y rapportent directement. Partant de ce principe, le choix de s’engager dans une cause sociale pourrait bien trouver son sens dans les dispositions intériorisées par une personne durant ses différentes socialisations (Mathieu, 2010). Ce postulat s’inscrit dans une approche plus structurelle qui part du principe que la compréhension du sens de l’engagement doit être reliée à la position et à la trajectoire sociale des personnes. Cependant, pour qu’il y ait un véritable engagement à long terme, il faut que la cause corresponde à des valeurs et à des aspirations qui animent la personne, le groupe ou l’organisation. Lorsqu’il y a une corrélation entre les valeurs d’une personne et la cause à laquelle elle se dévoue, son engagement a davantage de sens à ces yeux.
1.2 Les valeurs
La théorie des valeurs de Schwartz
En termes simples, une valeur est un principe qui guide l’action. En prenant l’exemple de l’indépendance, Schwartz (2006) affirme que « les personnes pour qui l’indépendance est une valeur importante sont en état d’alerte si leur indépendance est menacée, désespérées quand elles ne parviennent pas à la préserver, et heureuses quand elles peuvent l’exercer » (p. 931). Schwartz (2006), dans sa théorie des valeurs, utilise une conception des valeurs basée sur six caractéristiques majeures : (a) « les valeurs sont des croyances associées de manière indissociable aux affects »; (b) « les valeurs ont trait à des objectifs désirables qui motivent l’action »; (c) « les valeurs transcendent les actions et les situations spécifiques »; (d) « les valeurs servent d’étalon ou de critères »; (e) « les valeurs sont classées par ordre d’importance les unes par rapport aux autres »; et (f) « l’importance relative de multiples valeurs guide l’action » (p. 931).
Dans la première caractéristique, Schwartz lie les valeurs à l’état d’esprit d’une personne. Ainsi, ses émotions et ses sentiments ont une incidence sur ses motivations. Une personne qui a comme valeur l’égalité laissera exprimer ses émotions et ses sentiments dans des contextes ou des situations d’inégalités sociales. L’engagement dans des causes visant à promouvoir une égalité sociale permettra à cette personne de se sentir en accord avec ces valeurs.
Dans la deuxième caractéristique, l’auteur met l’accent sur l’adéquation entre les valeurs et les raisons de l’engagement social d’une personne. Comme nous l’avons mentionné plus haut, c’est bien le lien entre les valeurs d’une personne et les causes dans lesquelles elle s’engage qui motivent son action. Une personne animée d’une justice climatique s’engagera dans le but de combattre toute injustice climatique.
Dans la troisième caractéristique, Schwartz fait la différence entre les valeurs et les normes ou encore les attitudes qui se limitent uniquement à des actions, à des objets ou à des situations spécifiques. Pour lui, les valeurs sont donc d’un ordre supérieur à ces concepts.
En mettant en avant le rôle des valeurs dans le choix des actions et des causes dans lesquelles une personne pourra s’engager, l’auteur révèle, dans la quatrième caractéristique, l’importance des valeurs d’une personne dans l’identification « de ce qui est bon ou mauvais, justifié ou illégitime, de ce qui vaut la peine d’être fait ou de ce qui doit être évité en fonction des conséquences possibles pour les valeurs que l’on affectionne » (Schwartz, 2006, p. 931). Pour une personne qui décide de s’engager dans une cause sociale, ses valeurs serviront donc de boussole pour guider ses actions, mais également de référent pour poser un diagnostic sur les actions à mener ou non pour ne pas être en opposition à ses valeurs.
La cinquième caractéristique fait référence à la hiérarchisation des valeurs d’une personne. Toute personne possède normalement plusieurs valeurs, mais souvent à des degrés d’importance différents. Bien qu’une personne possède des valeurs comme la justice sociale, l’égalité, la solidarité, la réussite ou encore l’équité, ne signifie pas qu’elle accorde la même importance à chacune de ces valeurs. La cause dans laquelle elle est engagée ou elle veut s’engager peut nécessiter l’expression d’une ou de plusieurs valeurs plus que d’autres.
Enfin, la sixième caractéristique renvoie à l’implication de plusieurs valeurs dans les actions d’une personne. L’engagement social dans une cause nécessite que la personne engagée fasse appel à plus d’une valeur pour guider son action. Lorsqu’une personne s’engage, par exemple, pour la justice climatique, elle fera sans doute appel à des valeurs comme la justice sociale ou l’égalité. L’apport et l’utilité des valeurs à l’action résident dans deux éléments selon Schwartz : les valeurs sont appropriées et convenables dans le contexte où l’action est posée et également parce qu’elles sont essentielles pour la personne concernée.
L’approche de Heinich
Dans son approche sociologique, Heinich (2017) distingue trois significations principales de la notion de valeur : valeur-grandeur, valeur-objet et valeur-principe. Dans la première signification, valeur-grandeur, la valeur correspond intrinsèquement à la grandeur octroyée à un objet qui détermine son estimation. La valeur-grandeur peut avoir un sens identique à des notions comme l’importance, le mérite, la qualité, la quantité, la vertu ou encore le prix. C’est la définition la plus courante utilisée au sens commun et qui répond souvent aux questions suivantes : quelle est la valeur de cet objet? Que vaut cet objet? Quel prix est-on disposé à payer pour cet objet? Le plus souvent, la valeur qu’on accordera à un objet déterminera le prix auquel on souhaite l’acheter ou le vendre.
Dans la deuxième signification, valeur-objet, la « valeur est un objet crédité d’une appréciation positive, c’est-à-dire un objet communément considéré comme doté de valeur au premier sens du terme » (Heinich, 2017, p. 134). La valeur est ici un bien, par exemple, une lettre de change, une action, une obligation ou encore un billet de banque. La notion de bien peut s’appliquer à la fois à des objets de manière concrète comme une maison ou une voiture, mais également à des entités auxquelles nous accordons de l’importance telles que la famille, le travail, la religion ou l’art.
Enfin, dans la troisième signification, valeur-principe, la notion de valeur n’équivaut pas à une appréciation (valeur-grandeur) ni à un bien concret ou abstrait (valeur-objet), mais correspond davantage au principe qui est à la base de l’évaluation. Le jugement qu’on portera sur la valeur d’un film dépendra du principe de valeur qu’on utilisera pour son évaluation. Il peut y avoir autant de jugements sur la valeur du film que de principes si nous l’évaluons sur la base de sa beauté, de sa moralité, de son efficacité ou de son authenticité. Ce qui différencie une valeur-grandeur d’une valeur-principe est comparable « à la différence entre la qualité d’un objet et une qualité de cet objet, autrement dit une propriété motivant sa valorisation » (Heinich, 2017, p. 136).
La troisième signification d’Heinich (2017), considérant une valeur comme un principe, rejoint celle de Schwartz (2006) et c’est cette signification qui se rapproche le plus du concept de valeur évoqué dans un contexte d’engagement social. La valeur est ici définie comme un principe qui guide notre motivation à s’engager dans une cause. Trois caractéristiques d’une valeur-principe développées par Heinrich se présentent comme suit :
une valeur n’est ni une norme, ni une règle, ni une loi : celles-ci sont des applications de valeurs, lesquelles en justifient la création. Une première conséquence de cette spécificité est que, pour qu’une valeur puisse fonctionner comme telle, elle doit être comprise et utilisable par tous : autant on peut ne pas connaître l’existence d’une loi ou d’un règlement, autant tout adulte engagé dans la vie sociale sait ce que c’est que l’« honnêteté », la « solidarité » ou la « bonté ». Une valeur est à large spectre, temporel autant que spatial : elle implique à la fois le long terme et l’universalité, en tout cas présumée. Autrement dit, elle ne joue son rôle de valeur qu’à condition d’être à peu près commune à tous les participants d’une même culture. De ce fait, elle n’est pas accessible à la modification volontaire ou à court terme : contrairement à une norme et, plus encore, à une règle ou à une loi, l’on ne peut décider que telle valeur est obsolète ou, à l’inverse, valide : tout au plus peut-on inciter à son abandon ou à son adoption. C’est pourquoi les changements de valeurs résultent de processus longs, diffus et collectifs. (Heinich, 2017, p. 200-201)
Heinich (2017) identifie trois principes hiérarchiques des valeurs : (a) La différence entre valeurs publiques et valeurs privées; (b) La différence entre valeurs et anti-valeurs; (c) La différence entre valeurs fondamentales et valeurs contextuelles. Les valeurs publiques renvoient aux valeurs clairement revendiquées comme des valeurs de référence contrairement aux valeurs privées, qui, tout en influençant notre action, ne sont pas facilement amenées à être revendiquées du fait qu’elles sont très faiblement conformes aux valeurs reconnues par le grand public. Le principe hiérarchique relatif à la différence entre valeurs et anti-valeurs sous-tend que l’accent est mis sur la valence opposée, positive ou négative, que peut recevoir une valeur en fonction des contextes dans lesquels elle est considérée. Enfin, les valeurs fondamentales sont celles qui ont toujours une valence positive, peu importe le contexte, et qui sont difficilement transformables en anti-valeurs contrairement aux valeurs contextuelles. Cependant, pour Heinrich, « il n’existe pas de valeur fondamentale “en soi”, traitée comme telle en tout temps et en tous lieux, mais seulement des degrés supérieurs de généralité, mesurables à la quantité de contextes où telle valeur est fondamentale » (Heinich, 2017, p. 224).
Les valeurs d’une personne correspondent à ce qui est important pour elle. Chaque valeur exprime un type de souhaits ou de raisons conduisant toute personne à s’engager socialement. L’important est de rendre explicite les valeurs qui animent les individus et de chercher à mieux comprendre quelles en sont les implications sur les plans individuel, organisationnel et sociétal. Il est essentiel que l’engagement des individus et les causes dans lesquelles ils s’impliquent soient en adéquation avec leurs valeurs. Il existe une multitude de valeurs qui guident les actions des personnes engagées dans des causes sociales.
À titre d’exemple, une personne pourrait s’engager en évoquant les valeurs suivantes : solidarité, fraternité, bienveillance, égalité, équité, besoin de redonner à la communauté, besoin de donner sens à leur vie à travers l’engagement communautaire et besoin de trouver un sens profond à la condition humaine.
1.3 Les aspirations
Lorsque nous posons une action, nous le faisons dans le but d’atteindre un but individuel ou collectif. Par exemple, lorsque nous mettons en place des actions en faveur de l’atténuation des changements climatiques ou de l’adaptation à ceux-ci, c’est avant tout parce que nous aspirons à un monde meilleur et au mieux-être de la vie sur terre. En d’autres mots, nous visons un monde où nos actions nous permettre d’éviter des conséquences des changements climatiques ou de nous en protéger. Les actions menées ont alors comme but de réduire leurs activités néfastes et de rendre nos comportements de vie plus écologiques afin de protéger notre planète non seulement pour nous, mais pour les générations futures. Nous nous engageons dans une cause parce que nous avons avant tout des aspirations et nous avons la conviction que nos actions pourront contribuer à les atteindre.
Une aspiration est un élan qui mène vers un idéal, vers un but ultime. L’important est de visualiser et de se représenter l’allure ou la forme que prend cet idéal et les caractéristiques qui permettront d’affirmer qu’on a atteint le but ultime. De façon générale, une aspiration sociale est définie comme « situation sociale désirée ou idéal social consistant en un mieux-être des individus et des collectivités à atteindre dans le futur (sans que soit identifiée dans le présent une situation difficile réclamant une solution) vers laquelle peut s’orienter une innovation sociale ou une lutte collective » (Bouchard et al., 2016, p. 146).
Les types d’aspirations selon Kasser et Ryan
Il existe deux types d’aspirations selon Kasser et Ryan (1996) : les aspirations intrinsèques et les aspirations extrinsèques. Les aspirations de types intrinsèques renvoient à des désirs de satisfaction des besoins fondamentaux d’autonomie, de compétence et d’appartenance. Les buts classés dans les aspirations intrinsèques sont l’acceptation de soi (désir d’atteindre l’épanouissement psychologique, l’autonomie et le respect de soi), l’affiliation (désir d’avoir des relations satisfaisantes avec la famille et les amis), la santé physique (désir de se sentir en bonne santé et à l’abri de la maladie) et la contribution communautaire (Kasser et Ryan; 1996).
Les aspirations extrinsèques, quant à elles, sont basées sur des facteurs externes de valorisation. Les individus avec des aspirations extrinsèques ont ainsi tendance à donner plus d’importance à des facteurs tels que l’admiration et l’approbation des autres ainsi que les récompenses externes. La réussite financière, la recherche de notoriété ou de popularité et la recherche d’une meilleure apparence physique sont des exemples d’aspirations extrinsèques. Les travaux de Kasser et Ryan (1996) les ont conduits à établir une corrélation entre le type d’aspirations des individus et leur santé mentale. Les personnes qui portent et privilégient des aspirations de nature intrinsèque, notamment la contribution communautaire, bénéficient d’une meilleure santé mentale que celles qui privilégient des aspirations de nature extrinsèque.
Les liens entre les aspirations et l’engagement
Il semble exister un lien direct entre les aspirations d’une personne et son engagement dans une cause. Les résultats des travaux de Quéniart et Jacques (2008) ont montré, par exemple, qu’afin que les jeunes militants et militantes puissent trouver un sens à leurs actions, leur engagement doit concorder avec leurs aspirations. C’est donc ce lien entre engagement et aspirations qui motive leurs actions en mobilisant leur identité et leurs propres valeurs. L’idéal social visé par une personne influence grandement son désir de s’engager. Avoir des aspirations permet de maintenir le dévouement et l’engagement d’une personne dans une cause. Bien qu’elle soit consciente que ce n’est qu’à long terme que les objectifs de son engagement seront atteints, le fait d’être guidé par ses aspirations et ses valeurs consolide sa motivation et son engagement.
Les aspirations réelles et idéales
Selon Lewin (1939), en fonction de ses propres valeurs, toute personne se donne arbitrairement un niveau d’aspiration idéal, mais aussi un niveau d’attente réaliste se basant sur la probabilité d’atteinte de ses buts. L’auteur fait la distinction entre les aspirations réelles d’une personne et ses aspirations idéales. Les aspirations réelles sont celles qu’une personne pense être en mesure d’atteindre et les aspirations idéales sont celles qu’elle espère atteindre dans le meilleur des mondes. Lorsqu’une personne s’engage dans une cause, elle espère souvent que ses actions combinées à celles de toutes les personnes qui se battent pour la même cause lui permettent d’atteindre l’idéal souhaité.
Déclaration d’engagement social de la communauté universitaire
À travers la Déclaration d’engagement social de la communauté universitaire, les membres de la communauté étudiante, du personnel, des corps professoraux et enseignants de l’Université Laval et les membres de sa communauté élargie déclarent leur volonté à s’engager socialement et à favoriser l’engagement social en s’appuyant à la fois sur des valeurs, des causes (nommées ici sous le nom d’enjeux) ainsi que des aspirations :
Ayant à cœur les valeurs de l’Université Laval que sont la solidarité, la responsabilité, le respect, le courage, l’intégrité et l’inclusion, ainsi que les valeurs d’équité, de bienveillance, de diversité et d’humilité;
Ayant en tête que les crises actuelles, ainsi que leurs enjeux sociaux, économiques, écologiques, politiques, culturels et sanitaires sous-jacents, influencent nos priorités ainsi que nos perspectives sur le monde et notre rapport à celui-ci, tout en invitant à l’action et en suscitant des occasions de réflexion critique;
Aspirant à servir les idéaux et causes qui nous interpellent afin de contribuer à un environnement sain, au vivre-ensemble, à la justice sociale ainsi qu’au mieux-être des personnes, des communautés et de l’humanité
Nous déclarons notre volonté à nous engager socialement. (Université Laval, 2024, 2e et 3e puces).
1.4 Les liens entre les causes, les valeurs et les aspirations
Jusqu’ici, nous avons visé à définir et à mieux appréhender le sens de trois concepts que sont les causes, les valeurs et les aspirations. Nous avons défini les causes sociales comme un ensemble d’intérêts ou d’enjeux sociaux qu’un individu ou encore un groupe soutient ou défend en faveur d’une personne, d’une communauté ou de l’ordre des choses. Les valeurs réfèrent à tout principe qui guide l’action d’une personne et influence son engagement. Une personne s’engagera prioritairement dans des causes qui sont en lien avec ses valeurs personnelles. Il en est de même pour les aspirations qui renvoient à l’idéal social qu’une personne ou un groupe souhaite atteindre à travers son engagement et ses actions. Les aspirations dépendent également des valeurs personnelles ou de groupe. Les valeurs et les aspirations doivent être explicitées, surtout s’il s’agit d’un engagement collectif.
Les concepts de valeur et d’aspiration peuvent parfois prêter à confusion selon la façon dont leur sens est perçu. Prenons l’exemple de la notion d’égalité qui peut être considérée par certaines personnes comme une valeur et par d’autres comme une aspiration. L’égalité est souvent définie comme un principe selon lequel toute personne, peu importe son origine sociale ou ethnique, sa race ou son sexe, doit être traitée de la même façon qu’une autre. Dans le domaine de l’éducation, par exemple, l’égalité des chances vise à garantir à tous les enfants les mêmes chances de réussite au début de leur parcours scolaire. Pour certaines personnes, cette égalité des chances est une valeur qu’ils promeuvent à travers leurs actions. Elle peut toutefois être également vue comme un idéal à atteindre, donc comme une aspiration. Les concepts de valeur et d’aspiration ne sont pas absolus, le sens qu’on leur donne peut varier d’un contexte à un autre ou d’une personne à une autre.
1.5 Les expériences comme source de causes, de valeurs et d’aspirations
Dans les précédentes sections de ce chapitre, nous avons défini les construits, les causes, les valeurs et les aspirations, montré les liens entre eux et expliqué comment ces liens peuvent influencer l’engagement social d’une personne ou d’un groupe. Les causes, les valeurs et les aspirations qui peuvent être à la base du choix de s’engager peuvent provenir de différentes sources. L’engagement social ayant un caractère évolutif dans le temps comme dans l’espace, les expériences de vie d’une personne ou les événements historiques peuvent contribuer à changer ou à faire évoluer les causes dans lesquelles une personne s’implique, de même que ses valeurs et ses aspirations. Nous évoquerons ici l’engagement social sous l’angle successivement de la transmission familiale, d’une cause qui nous touche personnellement et d’autres expériences vécues.
Une transmission de la fibre d’engagement par les parents
L’environnement familial demeure, pour plusieurs personnes, le premier et principal lieu de socialisation dans leur vie. L’engagement des parents dans une cause peut créer chez une personne des dispositions à s’engager afin de perpétuer cette culture familiale. L’engagement, ici, peut alors trouver son sens dans cette perspective de continuité d’une valeur ou d’une aspiration familiale qui serait transmise de génération en génération. Les raisons de l’engagement d’un individu peuvent être façonnées par la culture, la tradition ou les valeurs développées au fil des années, voire des décennies, dans sa famille. La transmission de cette fibre d’engagement favorise une implication, de la part des enfants, dans une cause sociale rappelant celle soutenue par leurs parents. Cette fibre d’engagement est donc transmise en héritage. Dans une même famille, les désirs et les aspirations d’engagement semblent se conserver d’une génération à une autre, bien que les initiatives plus personnelles aient gagné en popularité sur des actions collectives. Les différentes expériences d’engagement social vécues avec les parents participent à la construction chez l’enfant d’une volonté permanente de défendre une cause pour laquelle l’importance est bien saisie et la nécessité de la soutenir est comprise. Les enfants qui, par exemple, participent à des activités de mobilisation ou à des manifestations de soutien à la justice climatique auront développé un rapport particulier avec cette cause. La probabilité demeure très forte que ces enfants aient trouvé, à travers la participation à ces activités, les raisons de la défense de la justice climatique comme cause sociale.
En nous touchant de façon personnelle
L’engagement peut trouver son sens du fait qu’une personne au sein de la famille, des proches ou des collègues soit directement concernée. C’est le cas, par exemple, des parents d’un enfant autiste qui s’engagent dans des organismes communautaires œuvrant dans la défense de cette cause. L’implication des parents par des contributions financières ou du bénévolat permet que leur enfant reçoive l’aide nécessaire et le soutien requis dans son développement. En s’engageant dans une cause qui les touche personnellement et en se dévouant volontairement à cette cause, les parents semblent souvent avoir la conviction de l’utilité de leur implication, de son importance pour leur enfant et ensuite pour d’autres enfants vivant avec une condition similaire.
Un autre exemple très parlant est la hausse brusque du bénévolat pendant la pandémie de COVID-19, notamment dans les centres d’hébergement de soins de longue durée qui abritent des adultes en grande perte d’autonomie ne pouvant plus vivre dans leur environnement habituel. Plusieurs proches aidants ont choisi de s’engager en tant que bénévoles dans ces centres afin de contribuer au mieux-être de leurs parents. Cela étant, certaines expériences de vie marquantes peuvent contribuer à l’engagement dans une cause sociale.
Les expériences marquantes
Certaines expériences peuvent exercer une influence sur l’engagement d’une personne. Le fait de vivre certains événements historiques peut changer la trajectoire d’engagement d’une personne. L’exposition à ces événements aura pour conséquence de changer sa vision du monde et sa perception quant à certains enjeux sociaux, ce qui la conduira à s’engager pour défendre ou soutenir une cause sociale. En ce sens, certains individus trouvent dans leur engagement social une manière d’exprimer leur révolte ou leur indignation par rapport à une injustice sociale. Toutes les formes d’injustices sociales créent des bases à l’engagement social des individus. S’engager dans une cause sociale liée à des expériences marquantes permet à certains individus de donner sens à leurs actions, mais également de trouver la voie de leur accomplissement social.
Les chemins menant à l’engagement social sont multiples. On peut décider de s’engager socialement, par exemple, à la suite de la lecture d’un livre sur la crise climatique qui nous a interpellés. L’engagement peut aussi naître d’un traumatisme personnel et du désir de redonner qui nous vient par la suite. Ainsi, les motivations déterminées sont variées et propres aux cheminements individuels de chaque personne, mais elles passent toujours de près ou de loin par une expérience vécue qui aura pour conséquence de réorienter nos conduites. D’un point de vue sociologique, cela se décrit par des processus de politisation et de socialisation, qui permettent de reconnaître et de valoriser cet engagement. À titre d’exemple, je travaille avec le Mouvement des sans-terres au Brésil. Ces personnes occupent les terres illégalement et montent des campements afin de revendiquer lesdites terres. L’expérience politique d’une forme de vie collective et démocratique dans les campements a pour effet, chez la plupart des paysans et paysannes, de changer leur rapport à l’autre et au monde. Leurs choix de vie, et plus généralement leurs conduites, sont dorénavant teintés de cette expérience politique. Pour plusieurs, c’est donc le début d’une vie militante et engagée.
Dan Furukawa Marques, professeur agrégé, Faculté des sciences sociales, Université Laval, 2022
L’engagement social repose souvent sur les différentes formes d’injustice dont nous avons conscience. L’injustice peut être de nature sociale, économique, environnementale ou même épistémique.
Nolywé Delannon, professeure agrégée, Faculté des sciences de l’administration, 2022
La cause première de l’engagement, c’est l’indignation. C’est notre capacité à nous indigner devant les inégalités, les injustices, qu’elles soient cognitives, économiques, sociales ou de toute autre nature. À la suite de ce constat, il y a une volonté de faire œuvre utile, de faire bouger les choses, à sa mesure, en participant à un mouvement plus large visant à changer la commune façon de penser.
Thierry Belleguic, professeur titulaire, Faculté des lettres et des sciences humaines, 2022
Conclusion
Ce chapitre a abordé le pourquoi de l’engagement social, ce qui inspire l’action; d’où l’expression « une cause conforme à ses valeurs et aspirations ». Ce chapitre ne pouvait donc viser à proposer une liste préétablie de causes, de valeurs et d’aspirations devant nécessairement sous-tendre l’engagement social d’une personne, d’un groupe ou d’une organisation. Il visait plutôt à présenter un cadre permettant de faciliter la différenciation entre les causes, les valeurs et les aspirations pour ainsi mieux comprendre le pourquoi de l’engagement. Ce chapitre permet ainsi d’accompagner la pratique réflexive dans un contexte d’engagement social, afin d’en analyser le pourquoi et, le cas échéant, de se réapproprier les causes, aspirations et valeurs qui le sous-tendent.
Questions de réflexion
- Quelle cause(s) me touche(nt) profondément, au point de ressentir un besoin d’agir ?
- À quelle(s) cause(s) se consacre mon engagement social?
- Quels événements de ma vie m’ont sensibilisé à certaines réalités sociales ?
- Ai-je hérité de certaines causes (famille, milieu, culture) ou les ai-je choisies ?
- Dans quelle mesure mon engagement est-il influencé par mes expériences personnelles ou professionnelles ?
- Est-ce que je me sens plus interpellé par des causes locales ou globales ? Pourquoi ?
- Quelles sont les valeurs qui sous-tendent mon engagement social ?
- Quelles aspirations vise mon engagement ?
- Y a-t-il des causes que j’admire, mais pour lesquelles je n’ai jamais osé m’engager ?
- Comment réagis-je face aux conflits entre différentes causes qui m’interpellent ?
Bibliographie
Becquet, V. et Goyette, M. (2014). L’engagement des jeunes en difficulté. Sociétés et jeunesses en difficulté – Revue pluridisciplinaire de recherche, (14). http://journals.openedition.org/sejed/7828
Bouchard, M. J., Briand, L., Klein, J.-L., Lévesque, B., Trudelle, C., Duchesnes Blondin, A., Longtin, D., Olivier-Nault, J. et Pelletier, M. (2016). Base de données sur les études de cas en innovation sociale produites dans le cadre des activités du CRISES : Présentation générale et manuel de codification. Centre de recherche sur les innovations sociales. https://crises.uqam.ca/wp-content/uploads/2018/10/CRISES_ET1602.pdf
de St Aubin, E. E., McAdams, D. P. et Kim, T. C. E. (2004). The generative society: Caring for future generations. American Psychological Association.
Heinich, N. (2017). Des valeurs : une approche sociologique. Gallimard.
Kasser, T. et Ryan, R. M. (1996). Further examining the American dream: Differential correlates of intrinsic and extrinsic goals. Personality and Social Psychology Bulletin, 22(3), 280-287. https://doi.org/10.1177/0146167296223006
Larousse (2025, 4 avril). Cause. Dans Le dictionnaire Larousse. https://www.larousse.fr/dictionnaires/francais/cause/13860
Lewin, K. (1939). Field theory and experiment in social psychology: Concept and methods. American Journal of Sociology. 44(6), 868-896.
Mathieu, L. (2010). Les ressorts sociaux de l’indignation militante. L’engagement au sein d’un collectif départemental du Réseau éducation sans frontière. Sociologie, 1(3), 303-318. https://doi.org/10.3917/socio.003.0303
Quéniart, A. et Jacques, J. (2008). Trajectoires, pratiques et sens de l’engagement chez des jeunes impliqués dans diverses formes de participation sociale et politique. Politique et Sociétés, 27(3), 211–242. https://doi.org/10.7202/029853ar
Ryan, R. M. et Deci, E. L. (2000). Self-determination theory and the facilitation of intrinsic motivation, social development, and well-being. American Psychologist, 55(1), 68–78. https://doi.org/10.1037/0003-066X.55.1.68
Schwartz, S. H. (2006). Les valeurs de base de la personne : théorie, mesures et applications. Revue française de sociologie, 47(4), 929-968. https://doi.org/10.3917/rfs.474.0929
Sinek, S. (2015). Commencer par pourquoi. Performance édition.
Université Laval. (2024). Déclaration d’engagement social. https://www.ulaval.ca/engagement-social/declaration