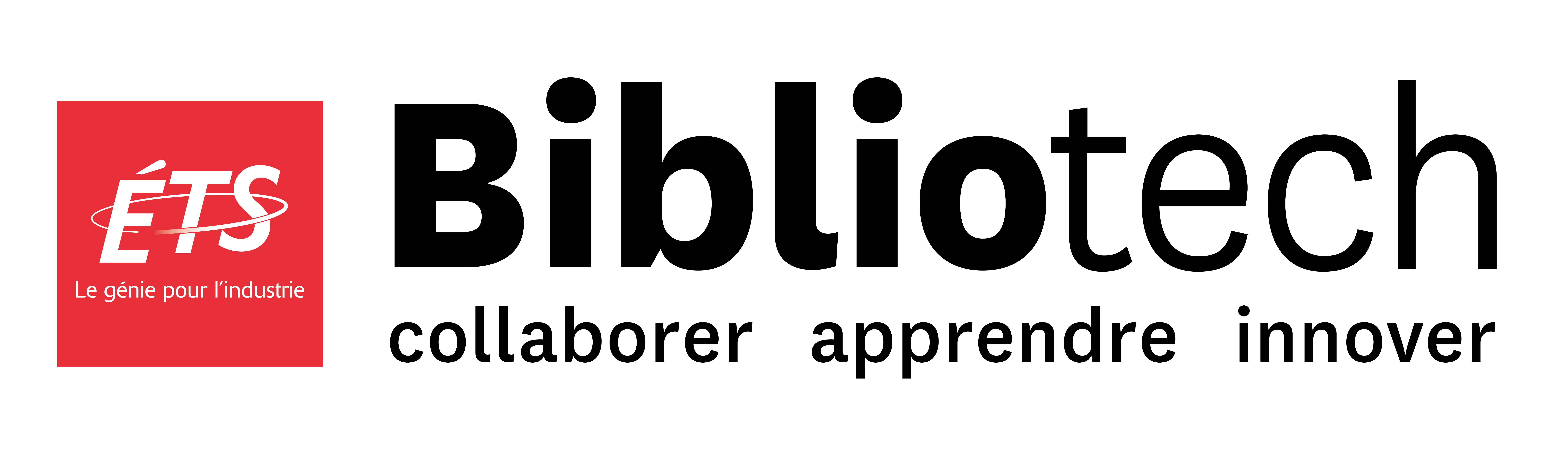Annexe I: présentation de la matrice des projets engagés
Matthias Pepin; Luc K. Audebrand; Ericka Rose Calvin; et Gabriel Huot
De quoi s’agit-il?
La matrice des projets engagés (MPE) est un outil de développement de projets créé par la Chaire de leadership en enseignement sur l’engagement social et la Chaire de leadership en enseignement sur le développement de l’esprit d’entreprendre et de l’entrepreneuriat de l’Université Laval.
Elle est conçue pour les personnes ou les groupes qui souhaitent se poser les bonnes questions pour concevoir et mener à bien leurs projets d’engagement social, ainsi qu’aux accompagnatrices et accompagnateurs afin de planifier leur soutien aux initiatives étudiantes ou citoyennes. La création de projets d’engagement social peut porter sur une activité ponctuelle, telle qu’une marche en faveur d’une cause sociale, sur une initiative d’intrapreneuriat social au sein d’une grande organisation ou encore viser la création d’un nouvel organisme.
La MPE contient 54 questions réparties en 4 zones, selon un code couleur : la zone de cohérence en rouge, la zone de désirabilité en orange, la zone de faisabilité en bleu et la zone de viabilité en vert. La MPE est un outil d’idéation, mais elle peut être utilisée à différentes étapes d’un projet engagé. Elle pourrait, par exemple, être utilisée à l’étude de faisabilité. En effet, les questions peuvent guider la réflexion des responsables, leur permettant de décider si le projet est réalisable ou de choisir le projet le plus intéressant. Cette technique peut également s’avérer utile lors de la phase de planification. En effet, les différentes questions peuvent servir de liste de vérification pour les responsables du projet, leur indiquant les tâches à accomplir, tout en les aidant à ne rien oublier d’important. Enfin, en comparant l’idée de départ résumée dans la matrice à ce qui a été réalisé, cet outil peut être utile pour réaliser le suivi et le bilan du projet.
La MPE est disponible en format avec questions et en version éditable.
Figure I : Matrice des projets engagés (Audebrand et al., 2022)
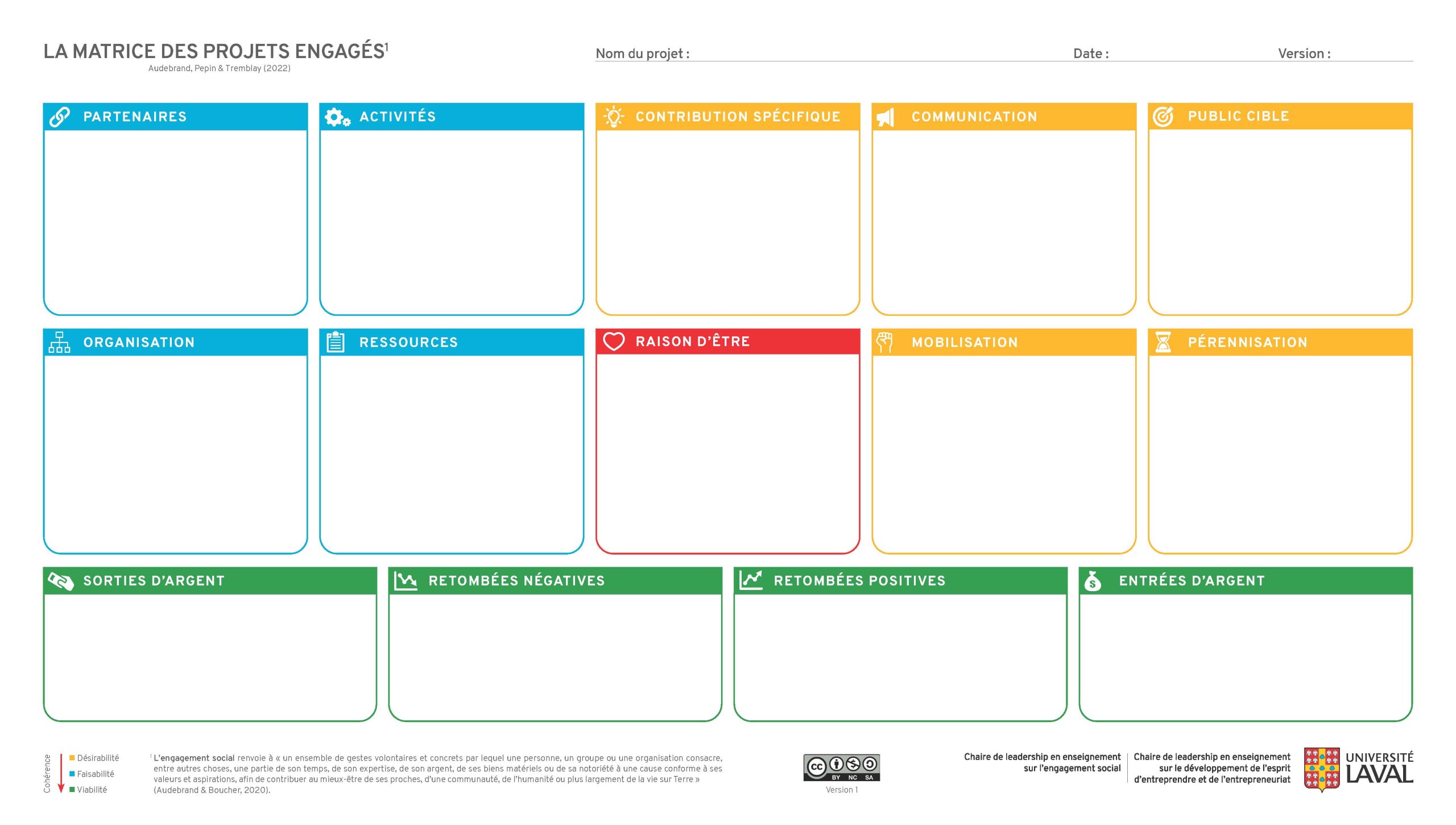
La zone de cohérence
La raison d’être (en rouge) est centrée sur la cause soutenue, la mission, la vision et les valeurs du projet. La raison d’être est mise au centre de la MPE, car elle en est le cœur, l’élément déclencheur. L’adéquation des projets engagés avec leur mission et leurs valeurs est un des critères les plus importants pour qu’ils appuient ou non ces projets.
La zone de désirabilité
Cette partie de la MPE, de couleur orange, se concentre sur le projet en lui-même et sa capacité à répondre aux besoins et les attentes du public cible (Pepin et al., 2023). On y trouve les cases suivantes : contribution spécifique, public cible, communication, mobilisation et pérennisation.
Contribution spécifique
La contribution spécifique est une variante de la « proposition de valeur » retrouvée dans le Canevas du modèle d’affaires (Business Model Canvas) et plus récemment dans la MMAR. En effet, dans un contexte de projets engagés, il est plutôt question de contribution que de proposition de valeur offerte à une clientèle donnée. Bien que le projet puisse être source de bénéfices pour certains publics, il ne s’inscrit habituellement pas dans une logique d’offre et de demande. De plus, les bénéficiaires du projet vont au-delà du public cible. Ainsi, cette case de la matrice permet de s’interroger sur la pertinence du projet en se demandant ce qu’il offre de nouveau et ce qui le différencie des initiatives similaires dans le milieu.
Public cible
Il est essentiel de bien connaître le public cible d’un projet engagé pour éviter de rater sa cible. Par conséquent, s’interroger sur l’adéquation entre les besoins du public cible et la contribution du projet est donc important.
Communication
La case de la communication renvoie au mode d’atteinte du public cible. En effet, la question de la communication est importante, car c’est grâce à elle que le public cible peut découvrir le projet.
Mobilisation
L’engagement des bénévoles joue un rôle crucial dans le succès d’un projet engagé. Par conséquent, il est important de se pencher sur la question de la mobilisation.
Pérennisation
Un projet engagé n’a pas toujours pour objectif de perdurer (par exemple, une manifestation a pour objectif de cesser quand la cause portée est résolue). Dans d’autres cas, il est dans l’intérêt de la communauté que ce dernier soit pérenne. Il est donc utile de réfléchir non seulement à sa pérennité, mais aussi à la manière dont on gère et transmet les connaissances, ainsi qu’à la valorisation du succès du projet.
La zone de faisabilité
Les quatre cases, en bleu, de la zone de faisabilité (partenaires, activités, organisation et ressources) visent à répondre à la question « Comment allons-nous réaliser notre projet? ». Les questions de cette zone de la matrice ont pour objectif d’aider la personne responsable du projet à réfléchir aux actions à entreprendre pour que le projet engagé voie le jour.
Partenaires
Les partenaires jouent un rôle important dans la réalisation des projets engagés. Il peut s’agir de parties prenantes au sein d’une organisation, tout comme d’organisations entières. Ces partenaires peuvent être à but non lucratif ou lucratif, issus du secteur privé ou du secteur public.
Organisation
L’organisation d’un projet engagé peut prendre de nombreuses formes, qu’elles soient juridiques ou non. Il peut s’agir d’une initiative individuelle, d’une équipe de travail, d’une association étudiante, d’un collectif, d’un OBNL, d’une coopérative, etc. Le choix du type d’organisation sera d’ailleurs influencé par les décisions prises dans la section « Pérennisation ».
Il est également important de déterminer le mode de fonctionnement au sein du groupe. La mobilisation étant un aspect important d’un projet engagé, il faut réfléchir à la façon dont les personnes impliquées seront entendues. Il est important de considérer la répartition des tâches et les moyens mis en place pour éviter de surcharger les personnes.
Activités
Il est important de s’interroger sur les tâches à accomplir afin que le projet devienne une réalité. Le fonctionnement quotidien, le contrôle et le suivi du projet sont des aspects tout aussi significatifs pour un projet de groupe.
Ressources
Pour qu’un projet soit réalisable, il est impératif de disposer des ressources adéquates, qu’il s’agisse de ressources humaines, financières ou matérielles. La question des ressources est donc cruciale pour la faisabilité d’un projet engagé. Comme mentionné précédemment, la mobilisation est au cœur d’un projet engagé, elle permet de pallier les manques possibles en ressources humaines et financières. C’est d’ailleurs pour cette raison que les ressources bénévoles sont abordées dans cette section.
La zone de viabilité
C’est dans cette zone, de couleur verte, que l’aspect financier et les répercussions indirectes du projet seront abordés. Cette zone contient quatre cases : entrées d’argent, sorties d’argent, retombées positives et retombées négatives.
Sorties d’argent et entrées d’argent
Tout projet nécessite des ressources financières adéquates. La MPE inclut le volet financier grâce aux cases « Sorties d’argent » et « Entrées d’argent ». Un projet engagé peut entraîner divers frais, tels que le loyer, la rémunération du personnel ou d’autres besoins liés au projet. Il peut également avoir des entrées d’argent, par exemple grâce à des subventions et des dons. La gestion des finances est alors importante. Bien que les projets engagés ne soient pas axés sur le profit, il demeure essentiel de réfléchir aux aspects financiers.
Retombées négatives et retombées positives
Les retombées, qu’elles soient négatives ou positives, sont les répercussions indirectes que pourrait avoir le projet engagé sur le plan économique, social ou écologique. Les retombées négatives, il peut par exemple s’agir de dépendance économique ou de déchets générés par le projet. D’un autre côté, l’émancipation de groupes marginalisés, la sensibilisation accrue ou la réduction et la réutilisation des matières résiduelles sont des exemples de retombées positives.