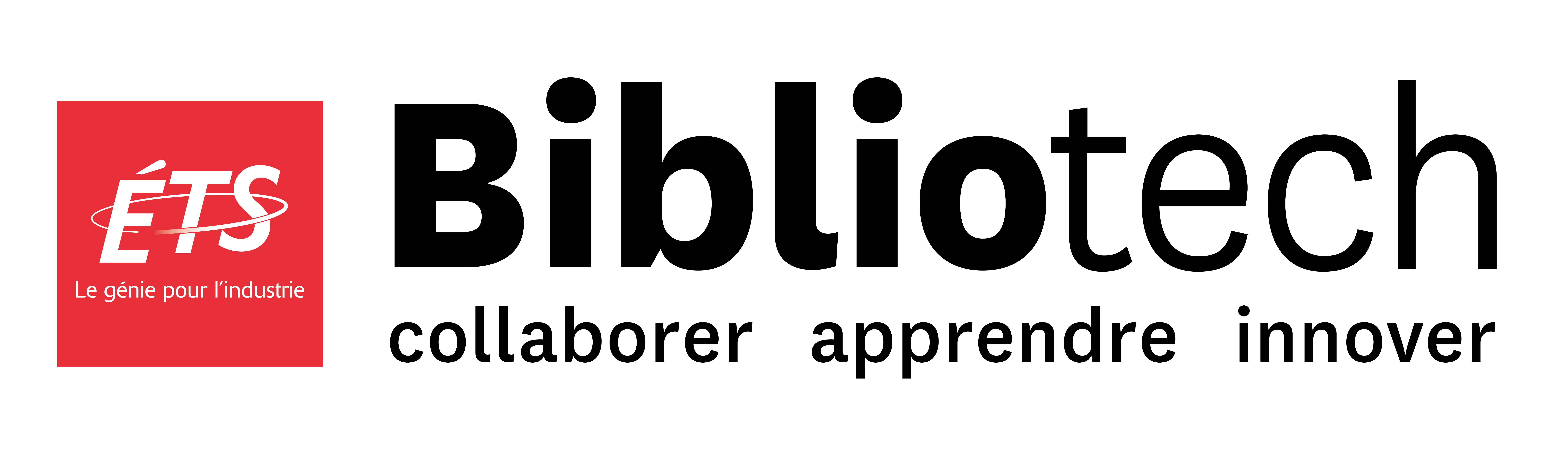Chapitre 6: l’engagement social et l’apprentissage
Luc K. Audebrand; Patrice C. Ahehehinnou; et Stephanie Beck
Introduction
Ce chapitre porte sur le lien étroit existant entre l’engagement social et l’apprentissage. Plus précisément, nous apportons des réponses aux questions suivantes : pourquoi et comment apprend-on d’une expérience d’engagement social? Dans un premier temps, nous présentons le concept d’apprentissage expérientiel en examinant ses prémisses, ses définitions, ses différentes formes et ses avantages. Dans un deuxième temps, nous nous attardons sur la manière dont le service communautaire, notamment le bénévolat, permet de développer divers types de savoirs (savoirs, savoir-faire, savoir-être, savoir-apprendre, savoir-agir). Dans un troisième temps, nous décrivons le processus de la pratique réflexive conduisant à l’apprentissage par l’expérience et à la construction des connaissances.
6.1 Présentation générale de l’apprentissage expérientiel
6.1.1 Prémisses de l’AE (Coget, 2023)
L’expérience comme vecteur d’apprentissage. Percevoir l’expérience ou les expériences comme une source d’apprentissage, c’est admettre que l’acquisition de connaissances et de savoirs peut se produire en dehors des établissements d’enseignement traditionnels, tels que les universités. C’est aussi réfuter l’idée que les enseignantes et enseignants sont les seuls à détenir le savoir et que ce dernier ne peut être transmis que par leur intermédiaire, à des apprenants perçus comme de simples récepteurs passifs. L’apprentissage expérientiel (AE) représente une approche novatrice de l’apprentissage, où l’expérience et la pratique jouent un rôle central.
D’après l’AE, certains apprentissages de la vie et certains savoirs pratiques ne peuvent se faire qu’à travers les expériences et les vécus d’une personne. L’idée selon laquelle l’expérience d’une personne est étroitement liée à la construction d’un apprentissage a été mise de l’avant par Dewey (1938). Il décrit l’expérience comme une interaction sociale. Pour lui, « il s’agit d’un événement social qui implique contacts et communication à l’intérieur desquels joue sans cesse le principe de l’interaction entre les conditions objectives de l’environnement et les états subjectifs de la personne » (Dewey, 1938; p. 69). Il postule néanmoins qu’on n’apprend pas de l’expérience. Selon lui, le fait de vivre une expérience ne conduit pas nécessairement à un apprentissage. L’expérience devient un vecteur d’apprentissage lorsqu’une réflexion sous-tend le processus d’apprentissage. Par exemple, une personne qui fait du bénévolat dans un organisme communautaire pourrait développer des compétences ou des connaissances à partir de cette expérience en réfléchissant à son sens et en essayant de construire des savoirs qui lui seront utiles pour les expériences ultérieures. Dans la lignée de Dewey, Kolb (1984) conçoit l’apprentissage comme un processus où la création de connaissances émerge de la transformation de l’expérience.
La vie comme continuum d’expériences. L’AE adopte également l’idée que la vie est un continuum d’expériences qui nous façonnent et qui nous transforment, en particulier grâce à la réflexion. La caractéristique fondamentale de ce continuum d’expériences, selon Dewey (2022), est que : « chaque expérience faite modifie le sujet et cette modification, à son tour, affecte – que nous le voulions ou non – la qualité des expériences suivantes, le sujet étant un peu différent après chaque expérience de ce qu’il était auparavant » (p. 472-473). Une première expérience réussie, selon Dewey (1938), prépare une personne à des expériences ultérieures qui seront plus bénéfiques. L’auteur soutient, en s’appuyant sur le principe de continuité de l’expérience, que « chaque expérience, d’une part, emprunte quelque chose aux expériences antérieures et, d’autre part, modifié de quelque manière la qualité des expériences ultérieures. » (Dewey, 2022, p. 473). C’est cette notion de continuité qui distinguerait une expérience favorisant l’apprentissage d’une autre qui ne le ferait pas. Le comportement d’une personne lors d’expériences futures dépendra du succès ou de l’échec de son processus d’apprentissage lors de sa première expérience.
L’apprentissage comme processus continu. Si les expériences présentent un aspect transformateur, comme nous l’avons vu dans la deuxième prémisse, la troisième prémisse met en évidence le caractère continu de ces expériences, c’est-à-dire les transformations tout au long de la vie. Jarvis (1991, cité dans Balleux, 2000) définit l’apprentissage comme « un processus continu qui cherche à donner un sens à l’expérience quotidienne, à la jonction de la conscience humaine avec le temps, l’espace, la société et leurs multiples relations. » (p. 280). L’apprentissage ne devrait pas être perçu comme un résultat ou un produit, mais plutôt comme un long processus. L’apprentissage découlant d’une expérience n’est donc pas une finalité, car nous apprenons tous les jours, et ce, tout au long de notre vie. Chaque expérience est accompagnée de son propre processus d’apprentissage. Abondant dans ce sens, Mezirow (1991, cité dans Balleux, 2000) perçoit l’apprentissage comme « un processus qui produit une nouvelle interprétation de sens ou révise les anciennes interprétations de sens de notre expérience. » (p. 280).
6.1.2 Définitions de l’AE
Les trois prémisses mentionnées plus tôt nous permettent d’explorer les divers sens que les auteurs ont attribués à l’AE au fil des ans. Bien que de nombreuses définitions du concept d’apprentissage expérientiel existent, il y a peu de consensus, car la compréhension globale du concept continue de faire l’objet de débats. L’approche de l’AE demeure très holistique et aborder tous ses aspects et ses caractéristiques a pendant longtemps été chose difficile pour plusieurs auteurs. Cependant, l’idée que l’expérience peut être une source d’apprentissage a été influencée par des pionniers dont les travaux ont grandement contribué au développement et à l’évolution de ce concept. Il s’agit notamment de Dewey (1938), de Lewin (1951), de Piaget (1971) et de Kolb (1984).
En termes simples, l’AE se définit comme l’acquisition de connaissances ou de savoirs à partir d’une expérience concrète de la vie. Coleman (1976) indiquait d’ailleurs que l’AE est la transformation d’une expérience vécue par une personne en des savoirs personnels. Pendant longtemps, la notion d’AE a été conceptualisée en dehors des salles de classe. Selon Legendre (2005), « l’apprentissage expérientiel est un modèle d’apprentissage préconisant la participation à des activités se situant dans des contextes les plus rapprochés possibles des connaissances à acquérir, des habiletés à développer et des attitudes à former ou à changer » (p. 95)
L’AE renvoie à deux types d’apprentissage selon Willingham (1977, cité dans Balleux, 2000). Le premier correspond à l’apprentissage grâce à une expérience vécue, qui est souvent informelle. Cela inclut tous les apprentissages qui découlent de notre environnement proche (notre travail, nos engagements, etc.), de notre vie sociale, ou de nos activités quotidiennes. Il s’agit d’un apprentissage non encadré qui n’est pas guidé ni provoqué par une force externe à la personne qui a vécu l’expérience. Le deuxième type d’apprentissage, qui a un caractère très formel, est l’apprentissage encadré et « concerne tout ce qui procure à l’étudiant une meilleure expérience dans l’intégration et dans la mise en application de sa formation, programme de travail, internat hors campus, amours, activités diverses » (Keeton, 1976, cité dans Balleux, 2000, p. 269). Cette classification des deux types d’apprentissage découlant de l’AE rejoint les deux principaux courants de ce concept, tels qu’ils ont été développés par Dewey (1938, cité dans Balleux, 2000) et Lindeman (1926, cité dans Balleux, 2000) avec deux approches divergentes, mais complémentaires. Dewey se concentre sur l’aspect éducatif et individuel alors que Lindeman s’intéresse à la dimension sociale de l’apprentissage par l’expérience. Balleux (2000) synthétise bien les approches des deux auteurs :
… pour Dewey, l’expérience doit être intégrée au processus d’apprentissage à l’école et toutes les méthodologies de l’éducation nouvelle doivent tendre vers cette direction. Alors que pour Lindeman, c’est la vie elle-même qui est éducatrice et l’expérience source première de tout apprentissage. Il n’est donc pas étonnant de trouver, tout au long des écrits qui font l’objet de cet article, ces deux tendances : l’une qui s’oriente vers la construction de savoirs et l’autre qui cherche davantage son chemin vers la construction de sens, même si les deux directions sont imprégnées l’une de l’autre. (p. 282)
Toujours selon Balleux (2000), les auteurs récents se concentrent sur la construction de sens dans leurs travaux. Il souligne d’ailleurs l’importance de la réflexion, qu’il considère comme l’élément central dans le processus d’apprentissage d’une expérience, car c’est « un moyen de reprendre possession de son expérience, d’élaborer une pensée à son propos et d’évaluer le sens que prend cette expérience dans l’existence » (p. 282).
6.1.3 Différentes formes et différents lieux d’AE
L’expérience peut être acquise dans divers milieux et contextes de notre vie quotidienne, ce qui signifie qu’il existe une variété de formes d’apprentissage expérientiel. Cependant, en partant du principe selon lequel l’expérience devient un vecteur d’apprentissage que si elle est accompagnée d’une réflexion, nous aborderons plus en détail, dans les sections suivantes, certaines interventions pédagogiques souvent associées à l’AE. La British Columbia Accountability Council for Co-operative Education (2017) a développé une matrice complète de comparaison entre l’éducation et l’apprentissage en milieu de travail. Cette matrice distingue deux grandes catégories d’AE : l’éducation intégrée au travail et l’apprentissage intégré au travail.
L’apprentissage en milieu de travail renvoie à un type d’apprentissage expérientiel dans lequel le lieu d’apprentissage et le lieu de travail sont unifiés, créant ainsi un lien étroit entre l’apprentissage et l’environnement professionnel. L’apprentissage intégré au travail regroupe neuf formes d’AE : le paraprofessionnel, l’assistanat de recherche, l’assistanat d’enseignement, les stages post-diplôme, l’apprentissage du service communautaire dans le cadre d’activités périscolaires, le bénévolat, l’étude de travail, les stages de courte durée et le travail temporaire des étudiants et étudiantes comme membre du personnel. L’éducation intégrée au travail, quant à elle, est une forme d’apprentissage intégré au travail qui combine une expérience substantielle et significative avec des liens intentionnels avec le programme d’études, la définition d’objectifs d’apprentissage, l’évaluation des résultats de l’apprentissage et une réflexion ciblée. Cette catégorie regroupe également neuf formes d’AE : la recherche appliquée, l’apprentissage obligatoire pour les métiers certifiés, les expériences cliniques, l’apprentissage du service communautaire dans le cadre du programme d’études, la coopération en alternance et en stage (stage coopératif), les stages professionnels de longue durée, le placement sur le terrain, les stages pratiques ou cliniques et les expériences professionnelles.
Moore (2010), pour sa part, a identifié six formes d’AE : les stages, l’apprentissage par le service communautaire, l’éducation coopérative, les expériences de recherche pour le personnel étudiant avec le personnel enseignant, la recherche communautaire et les études à l’international associées à une participation à des rencontres culturelles et professionnelles. L’organisme Enseignement coopératif et apprentissage intégré au travail (2020) dénombre neuf types d’apprentissage intégré au travail que sont : l’enseignement coopératif, les projets et recherches industrielles et communautaires, le stage clinique ou pratique obligatoire dans un milieu professionnel, le stage de travail de longue durée, le stage apprenti, l’entrepreneuriat, l’apprentissage par le service communautaire, le stage de courte durée ou placement en milieu de pratique et le stage de travail de courte durée incluant l’alternance travail-étude.
Selon Moore (2010), les expériences mentionnées précédemment ont lieu en dehors des salles d’enseignement et principalement dans les lieux de travail ou de stage. Moore (2010) insiste en soulignant que les collaborations de recherche ou d’enseignement entre le personnel étudiant et le personnel enseignant pour les postes d’auxiliaires de recherche, d’enseignement ou d’administration peuvent parfois se dérouler en classe, mais jamais dans les cours où est inscrite la personne étudiante. Il existe donc une autre catégorie d’AE qui englobe des méthodes d’apprentissage, telles que les études de cas, les jeux de rôle, les simulations, les travaux de groupe, etc. De nouvelles formes d’AE ont émergé ces dernières années, incluant les incubateurs, les accélérateurs, les bootcamps et les hackathons (Coget, 2023).
En résumé, il existe plusieurs types d’AE et nous en avons énuméré une liste non exhaustive. Les différentes formes d’AE citées peuvent être regroupées sous deux grandes catégories : l’apprentissage issu des expériences de terrain (travail, communauté, lieux de formation) et l’apprentissage issu des expériences de classe.
6.1.4 Avantages de l’AE
L’AE présente des avantages pour toutes les parties prenantes, notamment le personnel étudiant, le personnel enseignant et les établissements d’enseignement. Les bénéfices pour les étudiantes et étudiants sont ceux qui ont été plus documentés et tournent autour de quatre axes : les bénéfices liés au développement cognitif, les bénéfices liés au développement des compétences, les bénéfices liés au développement des liens sociaux et, enfin, les bénéfices liés à la compétitivité pédagogique et à l’amélioration de l’employabilité (Yang et al., 2021). Dans un premier temps, nous mettrons en évidence les avantages de l’apprentissage expérientiel pour le personnel étudiant, nous aborderons ensuite les avantages pour le personnel enseignant et les établissements d’enseignement.
Les bénéfices liés au développement cognitif et à la motivation affective des étudiants et étudiantes
Sur le plan du développement psychologique, la participation à des programmes d’apprentissage expérientiel peut avoir plusieurs avantages pour les étudiants et étudiantes comme l’augmentation de l’estime, de la confiance en soi et de la motivation intrinsèque. Les étudiants et étudiantes acquièrent de l’autonomie dans leurs manières de faire et de se comporter (Conrad et Hedin, 1995). Mei et Genshu (2018) ont démontré que les étudiants et étudiantes de l’international qui ont participé à un cours d’apprentissage expérientiel et interculturel en Chine ont vu leur estime de soi et leur compréhension de soi augmenter. Ils soulignent que le développement personnel à travers un apprentissage expérientiel se produit dès que les environnements d’apprentissage et sociaux offrent aux étudiants et étudiantes des possibilités d’accroître et d’enrichir leurs compétences, leur autonomie et leurs relations (Mei et Genshu 2018). Les occasions de développement cognitif et personnel qu’offre une expérience interculturelle permettent aux étudiants et étudiantes de mieux se connaître en découvrant leurs compétences, leurs qualités et leurs faiblesses, mais également en développant des interactions avec les autres.
Les bénéfices liés au développement des compétences
Le développement des compétences professionnelles et sociales est au cœur de l’apprentissage expérientiel. L’un des avantages majeurs de ce type d’apprentissage est de placer les étudiants et étudiantes dans des environnements de pratique, leur permettant ainsi de découvrir concrètement les applications des concepts étudiés en cours. En reliant les concepts et les théories pédagogiques à la réalité, les étudiants et étudiantes deviennent des protagonistes de leur apprentissage, plutôt que de simples spectateurs, comme cela peut être le cas dans un cours magistral plus traditionnel. Apprendre par la pratique facilite l’acquisition de savoirs, de savoir-faire et de savoir-être dans un contexte professionnel. Par exemple, des étudiants et étudiantes en soins infirmiers ont pu développer des compétences professionnelles grâce à une collaboration dans le cadre d’une expérience d’apprentissage communautaire (Jacobs, 2020). Cette expérience en service à la communauté leur a permis d’accroître des compétences interpersonnelles, telles que la confiance en soi et le développement de la pensée critique. La participation au service à la communauté a permis aux étudiants et étudiantes de prendre conscience des besoins des populations et d’échanger des savoirs et des compétences avec d’autres acteurs ou actrices sur le terrain (Jacobs, 2020). De plus, les étudiants et étudiantes ont pu développer et renforcer leur sens des responsabilités sociales et améliorer leurs compétences professionnelles et interpersonnelles.
Les bénéfices liés au développement des liens sociaux
Les différents types d’apprentissage expérientiel permettent aux étudiants et étudiantes de collaborer avec d’autres acteurs ou actrices sur le terrain. Il peut s’agir de personnes professionnelles ou expertes dans leur domaine au sein d’entreprises, de bénévoles ou de membres de la population dans le service à la communauté ou encore de membres du personnel enseignant ou étudiant provenant d’horizons divers. Les interactions sociales avec ces différents acteurs ou actrices créent chez une personne, notamment chez les étudiants et étudiantes, un sentiment de responsabilité et de compétence sociales, mais également un désir de participation sociale (Conrad et Hedin, 1995). Ces interactions sociales permettent aussi aux étudiants et étudiantes de tisser et de consolider des liens avec les personnes rencontrées sur les lieux d’apprentissage, puis de créer un réseau professionnel ou social. Dans un contexte professionnel de plus en plus complexe, la constitution de ces réseaux sociaux peut être utile pour les étudiants et étudiantes pour leurs futurs emplois.
Les bénéfices liés à la compétitivité pédagogique et à l’amélioration de l’employabilité
Il existe une différence entre les étudiants et étudiantes d’un programme d’apprentissage expérientiel et ceux et celles des programmes traditionnels. Au-delà de tous les avantages cités ci-dessus, la participation à un programme d’apprentissage expérientiel rend les personnes étudiantes plus compétitives sur le plan scolaire et améliore leur employabilité grâce aux compétences professionnelles et interpersonnelles acquises, ainsi qu’à leurs réseaux sociaux nouvellement développés (Coget, 2023). Les expériences professionnelles et les implications communautaires sont des points très importants sur les curriculums vitae et ils peuvent jouer un rôle décisif de succès pour une personne ou une entreprise qui désire embaucher du personnel. Pour les personnes étudiantes étrangères, par exemple, les compétences acquises lors des expériences de stages à l’international semblent être davantage valorisées par ceux et celles à la recherche de personnel que les compétences acquises dans leur propre pays. Sur le plan pédagogique, les personnes étudiantes qui participent à un programme d’apprentissage expérientiel à l’international reviennent souvent avec des ressources, des outils ou encore des méthodes pédagogiques différentes de celles auxquelles elles sont habituées dans leurs établissements. Cela leur permet d’acquérir des compétences, telles que l’ouverture d’esprit, la curiosité, le sens de l’initiative ou des compétences communicationnelles internationales.
Les avantages pour le personnel enseignant
L’apprentissage expérientiel présente également des avantages pour d’autres parties, comme le personnel enseignant et les établissements d’enseignement. Le personnel enseignant occupe une place centrale, servant de guide et de catalyseur du processus d’apprentissage expérientiel pour la personne étudiante. Il est garant de la connaissance de la matière, mais également de la connaissance des apprenants et apprenantes individuellement. Selon Dewey (1938, cité dans Crosby, 1995), le but de l’éducation est de cultiver chez les apprenants et apprenantes leur aptitude à comprendre et à tirer parti de leurs expériences. Ce but est atteint dès lors que ces apprenants et apprenantes développent des capacités de réflexions suffisantes leur permettant d’analyser leurs expériences. Le rôle du personnel enseignant est de favoriser l’apprentissage des apprenants et apprenantes en les impliquant dans des expériences essentiellement réflexives et pertinentes pour leur vie (Estes, 2004).
Les avantages d’opter pour un apprentissage expérientiel comme méthode pédagogique sont multiples pour le personnel enseignant.
En effet, cette méthode permet de favoriser l’engagement et la motivation des apprenants et apprenantes tout au long du processus d’apprentissage. Les expériences auxquelles participent les apprenants et apprenantes facilitent la construction des connaissances. Elles leur permettent d’être des acteurs et des actrices clés du processus d’apprentissage plutôt que de simples consommateurs et consommatrices de théories déjà existantes. L’apprentissage par l’expérience permet aux enseignants et enseignantes de se développer dans leur profession en coconstruisant les connaissances avec les apprenants et apprenantes, et en mettant en place des activités et des outils pédagogiques innovants. L’interactivité entre le personnel enseignant et le personnel étudiant tout au long du processus d’apprentissage crée et consolide des liens personnels et professionnels significatifs.
Ceux et celles qui supervisent les stages ou les services à la communauté jouent un rôle crucial en guidant les stagiaires dans leur réflexion sur leurs expériences. Cela facilite l’intégration des connaissances acquises dans leur vie professionnelle ou personnelle. Tant du côté du personnel enseignant que de supervision, conduire un processus d’apprentissage par l’expérience peut aider à mettre à jour ses propres connaissances.
Les avantages pour les établissements d’enseignement et les entreprises
Tous les avantages que tirent le personnel étudiant, le personnel enseignant, les entreprises d’accueil ainsi que les organismes communautaires correspondent aux bénéfices retirés par les établissements d’enseignement grâce à la mise en place de programmes d’apprentissage expérientiel, ou à l’incitation des enseignants et enseignantes à intégrer cette innovation pédagogique. Les établissements d’enseignement peuvent effectivement accroître leur attractivité en instaurant des programmes d’apprentissage expérientiel. Ces programmes présentent plusieurs avantages, tels que la réduction du taux de décrochage et d’abandon scolaires, ainsi qu’une augmentation du taux d’employabilité des apprenants et apprenantes (Coget, 2023). L’apprentissage expérientiel peut permettre aux établissements d’enseignement de solidifier leurs partenariats avec les entreprises et les communautés tout en améliorant leur visibilité et leur notoriété sur les plans national et international.
L’organisme La table ronde des affaires + de l’enseignement supérieur (2024) a identifié six avantages majeurs pour les entreprises qui proposent aux personnes étudiantes des possibilités d’apprentissage intégré au travail (AIT). Ces avantages se présentent comme suit :
- Vivier de talents qualifiés. L’accès à des candidats qualifiés et prêts à l’emploi peut permettre de remplir des rôles clés, d’améliorer la rétention et de réduire les coûts de recrutement.
- Avantages de l’innovation. Les personnes étudiantes apportent des idées et des innovations à leur organisation pendant leur AIT.
- Gains de productivité. Travail de qualité à coût réduit et meilleure préparation à l’emploi après l’AIT.
- Gestion du personnel. L’AIT crée des opportunités [sic] de gestion et de développement pour vos employés actuels.
- Responsabilité sociale des entreprises. L’AIT fait progresser les objectifs de votre organisation en matière de responsabilité sociale des entreprises.
- Diversité et inclusion. Les personnes étudiantes d’AIT contribuent à la mission, aux stratégies et aux pratiques de votre organisation pour soutenir un lieu de travail diversifié. (3e encadré)
En résumé, cette section nous a permis de dresser un portrait global de l’apprentissage expérientiel en mettant l’accent sur ses prémisses, ses définitions, ses différentes formes et enfin ses avantages. Parmi les différentes formes d’apprentissage expérientiel mentionnées, l’apprentissage à travers une expérience de bénévolat représente l’une des principales formes de l’apprentissage par le service à la communauté. Dans la section suivante, nous aborderons plus en détail le bénévolat comme source particulière d’apprentissage expérientiel.
6.2 Apprentissage par l’engagement social communautaire : le cas du bénévolat
6.2.1 Apprentissage par le service à la communauté
Pour plusieurs personnes, l’engagement social au sein de leur communauté constitue une expérience particulièrement enrichissante, car cela leur permet d’être témoins des difficultés rencontrées par les populations, ce qui développe chez elles une certaine responsabilité sociale. Les services offerts aux communautés représentent non seulement une source, mais aussi un moyen d’apprentissage. Comme tout apprentissage expérientiel, l’apprentissage par le service part du principe que l’apprentissage ne résulte pas nécessairement de l’expérience elle-même, mais plutôt du résultat d’une réflexion conçue pour atteindre des résultats d’apprentissage déterminés (Jacoby et Howard, 2014). L’apprentissage par le service est défini comme une forme d’éducation expérientielle dans laquelle les étudiants et étudiantes s’engagent dans des activités qui répondent aux besoins humains et communautaires, ainsi que dans des activités structurées, des occasions de réflexion conçues pour atteindre les résultats d’apprentissage souhaités (Jacoby, 1996; Jacoby et Howard, 2014).
L’une des composantes essentielles de l’apprentissage par le service est la réflexion intentionnelle, qui vise à aider les étudiants et étudiantes à établir des liens entre leur expérience en tant que bénévoles, par exemple, et les concepts théoriques abordés en classe. Cette réflexion permet également d’approfondir leur compréhension de ces concepts et d’acquérir d’autres savoirs transformationnels qui pourront leur être utiles pour l’analyse d’expériences ultérieures (Callan, 2020). Cette réflexion intentionnelle serait donc primordiale afin de distinguer un apprentissage par le service à la communauté ou d’autres types de service à la communauté, comme le bénévolat, qui ne sont pas soutenus par une telle réflexion. Les occasions d’apprentissage et de réflexion sont souvent intégrées directement au programme d’études ou au cours (Jacoby et Howard, 2014). Elles peuvent s’étendre sur une courte période, comme une seule session ou sur une période plus longue, couvrant l’ensemble d’un cycle d’études.
Il existe de nombreuses formes d’engagement communautaire par lesquelles toute personne peut soutenir des communautés, individuellement ou par l’intermédiaire d’organismes communautaires. Bénévoles Canada (2006) distingue les services où l’engagement des personnes est libre et volontaire de ceux où l’engagement est contraint, donc obligatoire. La première catégorie correspond aux formes suivantes : (a) bénévolat traditionnel; (b) programmes appuyés par l’employeur; (c) cadres détachés; (d) travail juridique bénévole; (e) service donnant droit à des allocations; (f) apprentissage par le service; (g) service civique outre-mer. La deuxième catégorie est constituée des formes de participation communautaire suivantes : (a) service communautaire ordonné par le tribunal; (b) service communautaire requis par les écoles; (c) participation communautaire dans le cadre de stratégies de travail obligatoire; (c) travail communautaire dans le cadre de programmes de réadaptation ou de conditionnement au travail; (d) parents subissant des pressions pour offrir leurs services comme condition à l’inscription de leur enfant à un programme éducatif ou communautaire, ou obligés de le faire. Ces différentes formes de services volontaires et obligatoires énumérées ci-dessus constituent une liste non exhaustive. Quelle que soit la nature du service communautaire, volontaire ou obligatoire, il offre des occasions d’apprentissage, puisqu’il constitue une expérience vécue. Dans le cadre de ce chapitre, nous nous concentrerons principalement sur le bénévolat réalisé à travers le don de temps, le don d’argent, le don d’expertise ou le don de notoriété à une cause sociale.
L’apprentissage par le service à la communauté ou l’apprentissage par l’engagement communautaire présente plusieurs avantages tant pour les personnes apprenantes que pour les organismes communautaires et les communautés concernées. Plusieurs de ces avantages ont déjà été énumérés, mais de manière plus précise, les étudiants et étudiantes qui s’engagent dans un processus d’apprentissage par le service à la communauté ont une meilleure compréhension de la complexité des enjeux sociaux et des problématiques, et se sentent plus proches de leur communauté (Jacoby et Howard, 2014). Pour les communautés, l’apprentissage par le service offre une nouvelle énergie et une aide pour élargir la prestation des services existante ou pour créer de nouveaux services; de nouvelles approches pour résoudre les problèmes; une capacité accrue à mener et à utiliser des recherches; un accès aux ressources institutionnelles; et des occasions de participer au processus d’enseignement et d’apprentissage (Jacoby et Howard, 201). Participer à un processus d’apprentissage dans le service permet aux organisations de former des étudiants et étudiantes comme de futures personnes engagées dans leur communauté et dans la société de façon plus générale.
L’un des services à la communauté, source d’apprentissage, est le bénévolat. Mais qu’est-ce que le bénévolat? Quels sont les critères pour qualifier une action ou un comportement de bénévole? Qu’est-ce qui fait du bénévolat une source d’apprentissage expérientiel? Ces points seront abordés dans les sections suivantes.
6.2.2 Bénévolat comme source d’apprentissage expérientiel
Notre conceptualisation du bénévolat, présentée dans la section 3,2, est utile pour préciser l’objet d’étude. Notre définition prend en considération toute action faite de façon volontaire (elle exclut le service communautaire), non rémunérée, réalisée au sein d’une organisation ou à l’extérieur de celle-ci, qui profite à nos proches (familiers ou amis), aux autres (communauté ou étrangers) ou à soi-même. L’action peut être ponctuelle ou continue, sur une courte ou une longue période. Elle peut être individuelle, collective ou réalisée au sein d’une organisation. Peu importe la définition qu’on lui attribue, le bénévolat demeure, pour plusieurs personnes, une occasion de contribuer au mieux-être collectif, et ce, tout en constituant une source d’apprentissage expérientiel, à condition d’en être conscient.
La dimension d’apprentissage de l’expérience bénévole occupe une place périphérique, car d’une part, l’apprentissage est tacite et d’autre part, la plupart des personnes bénévoles en sont inconscientes (Duguid et al. 2013). Les personnes bénévoles voient leur engagement social comme une action plutôt qu’une occasion d’apprentissage (Cox, 2002). Pour Duguid et al. (2013), la perception dominante du lien entre un apprentissage et une expérience de bénévolat est que nous apprenons à l’école et, dans une certaine mesure, dans notre travail professionnel, et que nous pouvons ensuite mettre les connaissances et compétences acquises au profit de la société en s’engageant comme bénévole. Cette perception exclut l’idée qu’une expérience de bénévolat peut être une occasion d’apprendre ou de renforcer ses savoirs.
Il existe une pluralité de raisons qui motivent les gens à faire du bénévolat. Comme nous l’avons mentionné dans le chapitre 1, les motivations des bénévoles peuvent être liées au mieux-être collectif et au mieux-être individuel, sans donner forcément lieu à une dichotomie, c’est-à-dire qu’une personne peut faire du bénévolat en visant ces deux types de mieux-être à la fois. Les personnes agissent principalement en fonction d’une combinaison de motivations qui s’apparente à une récompense globale (Cnaan et Goldberg-Glen, 1991). L’une des motivations liées au mieux-être individuel est l’acquisition de nouvelles connaissances et compétences. Plusieurs personnes font du bénévolat, notamment les étudiantes et étudiants, afin d’avoir leur première expérience professionnelle et ainsi acquérir des savoirs sur le plan de la pratique que seul un travail bénévole peut leur offrir. Le bénévolat offre également la possibilité de construire un réseau professionnel ou social, ainsi que de découvrir les défis sociaux auxquels les communautés sont confrontées quotidiennement. Bien que certaines personnes soient guidées par leurs croyances et valeurs personnelles, le fait de contribuer au mieux-être des autres peut leur procurer une satisfaction sur le plan psychologique. Le bénévolat demeure donc une expérience de vie ou une aventure pour plusieurs personnes qui en ressortent renforcées sur les plans éducatif, social ou professionnel.
Nous considérons le bénévolat comme une source d’apprentissage informel. À ce titre, deux notions essentielles doivent être prises en compte : l’intentionnalité et la conscience de l’apprentissage. Duguid et al. (2013) ont mis en perspective un continuum d’intentionnalité dans l’apprentissage d’une expérience bénévole liant un apprentissage principalement délibéré d’un côté à un apprentissage principalement implicite de l’autre. C’est le cas des personnes étudiantes dont le travail bénévole est intégré à leur programme d’études et dont l’apprentissage est guidé par le personnel enseignant ou de supervision. D’autres personnes, en revanche, font du bénévolat de façon spontanée sans forcément avoir l’intention d’acquérir ou de renforcer des connaissances ou des compétences à travers leurs actions. En ce qui concerne le continuum de la conscience d’apprentissage, Duguid et al. (2013) distinguent les expériences d’apprentissage conscientes, telles que l’apprentissage autorégulé et planifié, des expériences potentiellement inconscientes, comme la socialisation.
6.3 Construction de différents types de savoirs à travers le bénévolat
Partant du principe que toute expérience, qu’elle soit professionnelle ou personnelle, individuelle ou collective, peut être une source potentielle d’apprentissage, il serait donc impossible de dissocier une expérience vécue par quelqu’un de l’émergence de nouvelles connaissances chez lui (Baechler, 2019). Le processus d’acquisition de nouvelles connaissances repose sur l’implication d’une personne dans une activité (Bourgeois, 2013; Dewey, 1938). Vivre une expérience comme le bénévolat c’est donc mobiliser ses connaissances actuelles au profit de cette activité, mais c’est également saisir l’occasion de se construire d’autres savoirs dits expérientiels. La notion de savoir expérientiel a été définie par sa précurseure, Borkman (1976), comme étant une vérité issue de l’expérience personnelle relative à un phénomène, plutôt qu’une vérité obtenue par le raisonnement discursif, l’observation ou la réflexion sur des informations fournies par d’autres. Un savoir expérientiel est un type de savoir qui est concret, déterminé et de sens commun (Borkman, 1976). Un savoir expérientiel est qualifié de concret parce qu’il est acquis par l’expérience plutôt que par l’enseignement magistral ou la lecture (Godrie, 2016). C’est un savoir déterminé, puisqu’il a une portée individuelle, c’est-à-dire qu’il n’est valable que pour soi-même prioritairement. Enfin, le sens commun peut avoir deux significations : ce type de savoir peut être possédé par toute personne ayant vécu une expérience, indépendamment de l’obtention d’un diplôme. De plus, un savoir expérientiel ne bénéficie pas d’une structure systématique ni d’une élaboration formelle qui faciliteraient sa transmission ou son utilisation directe par d’autres personnes (Godrie, 2016).
Les savoirs issus d’une expérience ne doivent pas être considérés exclusivement comme des savoirs pratiques. Ils sont plutôt « un ensemble de savoir-faire, [de] savoir-dire ou [de] savoir-être dérivés des expériences vécues, mais ne sont pas réductibles à ces expériences » (Godrie, 2022, 7e paragr.). Les savoirs expérientiels peuvent donc prendre la forme d’une simple familiarité avec un phénomène, d’une longue réflexion systématisée, logique et rigoureuse, mais aussi d’une multitude de savoirs : savoir d’action, savoir technique, savoir-être, savoir procédural ou théorique, etc. (Gardien, 2019). Réduire les savoirs expérientiels aux seuls savoirs pratiques, c’est omettre toutes les nombreuses connaissances sociales, interpersonnelles et humaines qui découlent de l’engagement dans une activité bénévole. Les milieux sociaux ou communautaires offrent une multitude de savoirs qui favorisent les interactions sociales avec les partenaires communautaires, mais ils offrent également des occasions d’acquisition de connaissances à travers des observations, des réflexions et des expérimentations (Gardien, 2019). D’autres facteurs peuvent contribuer à la production du savoir expérientiel, notamment le vécu personnel, la réflexion sur le témoignage et l’avis de pairs, l’observation de situations similaires ou connexes, les résultats de raisonnements analytiques, l’appropriation d’autres contenus (éventuellement scientifiques), etc. (Gardien, 2017). Un physiothérapeute qui met son expertise à la disposition d’un organisme communautaire pour aider les jeunes sportifs autochtones devra certainement s’adapter aux exigences de son nouvel environnement et à une clientèle particulière. Il devra également faire appel à d’autres connaissances sur le plan humain afin de répondre favorablement aux besoins de ces jeunes et éventuellement de leurs parents, car seuls son savoir-faire et ses compétences ne suffiront pas dans un tel milieu social. Il devra s’imprégner des modes de vie et de la culture de cette communauté autochtone.
Lorsqu’une personne apprend d’une expérience, c’est qu’elle est en mesure de mettre en signification ce qu’elle a vécu. L’explication qu’elle produit de son expérience ne lui est pas révélée, mais provient d’un apprentissage et d’une construction (Gardien, 2019). Tout processus de production et de construction des savoirs expérientiels trouve sa source dans la sémantisation de l’expérience vécue. La sémantisation (interprétation, attribution d’un sens) est caractérisée par un processus de mise en signification progressive de l’expérience à travers une interprétation des éléments issus de ladite expérience. Lorsqu’une personne n’est pas en mesure de donner des significations à une expérience vécue en se basant sur ses savoirs expérientiels antérieurs ou les significations préexistantes dans son milieu social, elle devrait donc utiliser ce processus de sémantisation pour créer de nouvelles connaissances.
La vie ordinaire est un continuum d’expériences sémantisées à la fois à partir des significations intersubjectives produites collectivement et constitués [sic] en savoirs expérientiels légitimes, ainsi qu’à partir des significations issues d’une réflexivité sur les expériences de vie personnelle et professionnelle par les individus. (Gardien, 2020, 10e paragr.)
Les savoirs expérientiels ont un caractère évolutif, car leur sémantisation et les significations qui en découlent sont susceptibles d’être modifiées par l’apparition de nouvelles informations ou de nouvelles réflexions (Gardien, 2017).
Selon les définitions précédentes, il existe une multitude de savoirs expérientiels, tels que le savoir, le savoir-faire, le savoir-être, etc. Nous développerons chacun de ces savoirs, mais également le savoir-agir, qui est peu documenté.
6.3.1 Savoirs
Le terme « savoir » renvoie ici aux connaissances théoriques acquises en classe ou dans tout autre contexte d’apprentissage. Ces connaissances peuvent être générales ou spécialisées. Lorsqu’une personne suit une formation d’agent communautaire, elle acquiert les connaissances nécessaires pour intervenir auprès des populations aux prises avec des problématiques diverses liées à leur environnement personnel ou social. Ces connaissances définissent donc un type de savoir qu’elle détient, mais d’un point de vue théorique. Ces savoirs peuvent aussi être des savoirs locaux, propres à une communauté, une entreprise, une organisation à but non lucratif, etc. Ce sont des savoirs propres à chaque communauté, comme des savoirs endogènes, des cultures, des traditions qu’il est important de connaître pour répondre efficacement aux besoins sociaux de ces communautés. Selon la théorie constructiviste, la construction des savoirs n’est plus l’exclusivité des institutions universitaires. Le processus de construction des savoirs et de développement des connaissances peut également se dérouler localement. Plusieurs universités nouent désormais des partenariats avec des organismes locaux ou communautaires pour mener des projets de coconstruction de savoirs.
Dans le cadre du bénévolat, les personnes bénévoles possèdent des savoirs avant leur engagement, mais en acquièrent d’autres pendant leur engagement. Il s’agit souvent des savoirs existants dans les organismes communautaires d’accueil. Ces savoirs concernent les procédures, les lois, les protocoles cliniques, la culture organisationnelle, les règlements, les statuts, l’organisation du travail, etc. Les sources d’apprentissage de ses savoirs sont donc multiples (formations, lecture, observations, discussion avec une autre personne, etc.). Reconnaître ses savoirs se fait notamment avec le verbe « connaître ». Ainsi, quelqu’un peut affirmer « Je connais la théorie de l’action sociale de Parsons » ou « Je connais la culture du peuple inuit », indiquant ainsi sa maîtrise approfondie de ce sujet.
Il nous semble néanmoins important d’apporter une clarification entre les concepts de savoir et de connaissance, qui sont souvent utilisés comme des synonymes dans les écrits et dont la distinction demeure difficile à établir (Dallaire et Jovic, 2021). Les auteures définissent le savoir en ces termes :
Le savoir est un construit formalisé pour être transmis. Il est décrit dans des ouvrages, des programmes d’études, des documents. Le savoir est admis et partagé par une communauté, qui le place justement au rang de « savoir »; il peut dès lors être transmis (par exemple, enseigné), acquis et valorisé. (p. 8)
Selon Dallaire et Jovic (2021), pour devenir « connaissance », le savoir doit être appris et il n’est transmis que par l’apprentissage, qu’il soit formel ou informel. La connaissance a un caractère volontaire et individuel, tandis que le savoir peut demeurer invariable pendant une période donnée, malgré sa nature évolutive. Le caractère individuel de la connaissance provient du fait qu’elle est produite à partir de l’intériorisation et de l’incorporation de savoirs et d’expériences par une personne.
Une personne qui a acquis les savoirs nécessaires pour intervenir auprès d’enfants ayant des besoins particuliers sait, en théorie, le protocole à suivre pour travailler avec ces enfants. Lorsqu’elle mobilise ses connaissances dans le cadre d’une ou de plusieurs situations concrètes, elle démontrera un savoir-faire et mettra en pratique son savoir.
Une démarche d’engagement ne vise pas exclusivement le transfert d’expertise pour répondre à un besoin. Elle implique également de considérer le point de vue de l’autre, d’accueillir des savoirs locaux, différents et expérientiels, et de travailler pour la justice cognitive. Cela permet d’intégrer plusieurs savoirs épistémologiques, c’est-à-dire différentes façons de penser, de faire et d’interagir. Les savoirs locaux, soit les savoirs qui émanent des milieux communautaires, doivent donc être considérés comme des composantes essentielles et indispensables dans la démarche d’engagement.
Thierry Belleguic, professeur titulaire, Faculté des lettres et des sciences humaines, 2022
6.3.2 Savoir-faire
Si les connaissances théoriques sont importantes, le savoir-faire est indispensable, notamment lorsqu’on s’engage dans des activités bénévoles. Le bénévolat demande de passer à l’action, d’agir pour aider ou répondre aux besoins d’une personne ou d’une communauté. Vous ne pouvez agir que lorsque vous possédez le savoir-faire nécessaire pour le faire. Lorsqu’une personne est en mesure de porter secours à des enfants blessés dans les zones de guerre en leur prodiguant les premiers soins nécessaires à leur survie, elle fait appel à son savoir-faire et le démontre. Généralement, le savoir-faire est défini comme étant la mise en pratique des connaissances théoriques. Pour Theureau (1996), le savoir-faire représente « la capacité d’un acteur à mettre en œuvre des délimitants et interprétants usuels efficaces dans la planification de l’action, le raisonnement au niveau fonctionnel de la détermination, et la communication pour l’action » (51e paragr.). Contrairement à un savoir théorique, un savoir-faire ne peut être développé par les bénévoles que dans l’action ou dans l’accomplissement d’une tâche liée à leur travail. Le savoir-faire est donc l’expérience pratique qui témoigne d’une maîtrise des procédures dans une activité bénévole. Les bénévoles ont ainsi l’occasion de mettre en application toutes les connaissances acquises.
En reprenant l’exemple mentionné précédemment, les personnes bénévoles de la Croix-Rouge suivent des formations théoriques en premiers soins et en secourisme d’urgence avant d’être déployées sur le terrain. Bien que ces formations soient principalement théoriques, elles comprennent plusieurs enseignements pratiques pour assurer une préparation adéquate. Toutefois, ce n’est qu’en situation réelle, en portant assistance aux personnes dans le besoin, que les bénévoles mettront en pratique et développeront leur savoir-faire, et pourront le démontrer. Les bénévoles s’appuient également sur les savoir-faire développés dans d’autres contextes de bénévolat ou dans leur vie professionnelle et sociale pour mener à bien leur mission.
Le bénévolat est bénéfique pour les personnes engagées, car il leur offre des occasions dans plusieurs domaines. Le champ de développement de savoir-faire est très vaste, puisque les besoins des bénéficiaires sont variés et en permanence croissants. Qu’il s’agisse de santé, d’éducation, de sport, d’art, de culture, etc., une personne engagée trouvera assurément des occasions pour enrichir ses connaissances pratiques dans son domaine de prédilection ou même dans d’autres domaines de connaissances. Un informaticien peut, par exemple, développer un savoir-faire en aide aux personnes âgées, en animation sportive ou en accompagnement scolaire en s’impliquant dans une organisation bénévole. Le bénévolat n’est donc pas uniquement la mise à disposition volontaire et gratuite de son temps, de ses savoir-faire ou de sa notoriété au profit d’une cause, mais c’est également une occasion pour les personnes engagées de développer plusieurs autres compétences. Au-delà des connaissances théoriques et pratiques, le travail bénévole, qui se fait le plus souvent auprès des personnes dans le besoin et en situation de vulnérabilité, nécessite des attitudes et des comportements qui favorisent le vivre-ensemble avec les autres, c’est-à-dire la possession ou le développement d’un savoir-être.
6.3.3 Savoir-être
Combien de fois, dans notre vie professionnelle ou personnelle, rencontrons-nous des personnes qui sont méprisées par leur entourage, non pas en raison de leurs savoirs ou de leurs savoir-faire, mais simplement parce qu’elles ne possèdent pas les attitudes ou les comportements nécessaires pour bien vivre en communauté? Souvent cités en dernier lieu dans une trilogie qui comprend également les savoirs et les savoir-faire, les savoir-être se définissent comme « des dispositions individuelles, des traits de personnalité, des dispositifs d’attitudes, qui touchent, par exemple, à l’image de soi et des autres, au caractère introverti ou extraverti manifesté dans l’interaction sociale » (Conseil d’Europe, 2001, p. 17). Ce sont des dimensions personnelles et transversales des compétences, tant en situation de travail qu’en contexte social (Faure et Cucchi, 2020). Les savoir-être d’une personne sont en perpétuelle évolution, puisque les contacts avec d’autres cultures et d’autres réalités de vie peuvent modifier considérablement sa manière de voir la vie ou de se comporter. Les savoir-être regroupent les attitudes, les motivations, les valeurs, les croyances, les styles cognitifs et les traits de personnalité d’une personne qui démontre sa capacité à s’intégrer facilement dans un groupe ou à socialiser avec les autres. Les savoir-être sont donc perçus comme des comportements individuels, mais également des compétences organisationnelles et sociales (Faure et Cucchi, 2020). Ce sont surtout des connaissances indispensables à l’activité bénévole dont le but est avant tout de contribuer au mieux-être des autres.
Aider une personne dans le besoin requiert de la compassion et de la solidarité. Les activités bénévoles permettent aux personnes engagées d’utiliser leurs savoir-être, mais également d’en acquérir d’autres grâce aux interactions sociales et au soutien qu’offre le bénévolat. Lorsqu’une personne travaille, par exemple, avec des populations dans les communautés autochtones, elle est appelée à adopter des valeurs et des attitudes différentes qui doivent être en adéquation avec les réalités locales. Il en est de même pour les bénévoles de la Croix-Rouge canadienne qui travaillent dans des pays africains ou du Moyen-Orient. Une personne bénévole aura plus de chances de vivre une expérience positive et d’avoir un contexte de travail favorable lorsqu’elle mobilise des savoir-être qui correspondent aux réalités du milieu dans lequel elle intervient.
Un bénévole peut développer un savoir-être en s’imprégnant des réalités sociales des autres. Une personne qui n’a jamais vécu les conséquences d’une catastrophe naturelle comme un séisme ou qui n’a jamais connu la guerre peut découvrir des valeurs différentes en observant l’entraide et la vie commune qui émergent au sein des communautés touchées. Avec des savoir-être adaptés au contexte social d’intervention, la personne bénévole peut mobiliser ses savoirs et savoir-faire pour répondre aux besoins des communautés locales. Elle doit toutefois être capable de recourir de façon appropriée et efficace à un ensemble de ressources internes ou externes selon les situations.
L’expérience d’engagement social peut se développer en apprentissage de plusieurs façons. La façon, qui me semble la plus importante, part du moment où l’on reconnaît en soi la nécessité de participer à la société, de faire œuvre utile. Je crois qu’on fait alors un grand pas vers l’apprentissage de son humanité.
Thierry Belleguic, professeur titulaire, Faculté des lettres et des sciences humaines, 2022
Des personnes qui se sont engagées dans des organismes luttant contre la pauvreté ont découvert une réalité qui leur était méconnue. Cela a fait évoluer leurs valeurs personnelles. Elles ont réalisé que les personnes en situation de pauvreté rencontrent des obstacles auxquels elles n’ont jamais été confrontées elles-mêmes, et que ces problématiques sociales sont beaucoup plus compliquées qu’elles ne l’avaient imaginé. Leur engagement a donc fait évoluer leur vision du monde.
Nancy Charland, vice-présidente au développement social, Centraide Québec et Chaudière-Appalaches, 2022
6.3.4 Savoir-agir
La réussite d’une action bénévole nécessite la mobilisation d’un ensemble de savoirs, de savoir-faire, de savoir-être et de savoir-apprendre. En situation réelle, une personne mettra intentionnellement et efficacement ses savoirs en pratique pour résoudre les problèmes qu’elle rencontre. Elle aura ainsi démontré son savoir-agir, notion souvent associée à celle de compétence. D’ailleurs, Tardif (2006) définit la compétence comme « un savoir-agir complexe prenant appui sur la mobilisation et la combinaison efficaces d’une variété de ressources internes et externes à l’intérieur d’une famille de situations » (p. 22). Le savoir-agir est donc la combinaison intentionnelle de plusieurs types de savoir et de ressources pour résoudre de manière optimale une problématique donnée dans une situation et un contexte bien précis. Selon Perrenoud (1999), posséder un savoir-agir représente une capacité d’action efficace face à une famille de situations, qu’on arrive à maîtriser parce qu’on dispose à la fois des connaissances nécessaires et de la capacité de les mobiliser à bon escient, en temps opportun, pour identifier et résoudre de vrais problèmes.
La plupart des actions bénévoles se déroulent dans un contexte bien précis. Cela exige des personnes bénévoles qu’elles mobilisent ou développent un savoir-agir important face aux différentes situations rencontrées. Posséder un ensemble de savoir, de savoir-faire et de savoir-être ainsi que plusieurs ressources constitue une chose; savoir les combiner et les utiliser efficacement au bon moment, en est une autre. Dans la mobilisation d’un savoir-agir efficace, une personne bénévole devra mettre en œuvre deux catégories de ressources : les ressources personnelles, aussi nommées « internes », et celles des réseaux, aussi nommées « externes » (Le Boterf, 1999). Les ressources personnelles regroupent les connaissances, les savoir-faire, les savoir-être, les qualités, la culture, les ressources émotionnelles, etc. En ce qui concerne les ressources des réseaux, elles incluent les banques de données, les réseaux documentaires, les réseaux d’expertise, etc.
Le savoir-agir possède deux caractéristiques importantes : son utilisation ne peut se faire hors contexte ni être automatisée, contrairement au savoir-faire (Tardif, 2006). Chaque situation nécessitant une action bénévole est unique et s’inscrit dans un contexte particulier. Aider les femmes qui sont victimes d’agressions sexuelles dans les pays en développement nécessiterait un savoir-agir plus complexe qu’en Occident, où des ressources politiques, législatives et sociales facilitent déjà la lutte contre ce fléau. Le savoir-agir mobilisé n’est pas un concept statique; il s’adapte en fonction des changements de situation. Lorsqu’une personne bénévole qui donne les premiers soins à une personne blessée lors d’un accident se retrouve face à une situation d’urgence critique impliquant plusieurs personnes, elle ne mobilise plus le même savoir-agir. Il est crucial d’adapter le savoir-agir initial en réponse aux changements de la situation, que ceux-ci soient positifs ou négatifs.
6.3.5 Savoir-apprendre
Chaque jour, nous apprenons de nouvelles connaissances de différentes manières. Parfois, nous le faisons de manière volontaire, car nous voulons acquérir de nouvelles connaissances, comme apprendre une nouvelle langue, maîtriser un nouveau logiciel ou encore développer de nouveaux savoir-faire ou de nouvelles valeurs. Il est aussi possible d’apprendre de manière involontaire et spontanée, sans intention ni planification, en regardant la télévision, en naviguant sur son téléphone ou en discutant avec ses proches. Mais apprendre est avant tout un processus par lequel nous acquérons de nouvelles connaissances, maîtrisons des habiletés ou développons des attitudes (Robbes, 2019).
Selon la définition de de Landsheere (1992), l’apprentissage correspond à un « processus d’effets plus ou moins durable par lequel des comportements nouveaux sont acquis ou des comportements déjà présents sont modifiés en interaction avec le milieu ou l’environnement » (p. 20). Cependant, selon Reboul (2010, chapitre II), cette définition manque de précision, car, pour lui, si tout ce qui est appris est acquis, tout ce qui est acquis n’est pas appris. Il définit, pour sa part, l’apprentissage comme « l’acquisition d’un savoir-faire, c’est-à-dire d’une conduite utile au sujet ou à d’autres que lui, et qu’il peut reproduire à volonté si la situation s’y prête » Reboul (2010, p. 41). Dans sa définition, Reboul (2010, chapitre II) s’est limité à un seul type de savoir : le savoir-faire. Cependant, il est tout à fait possible d’acquérir les autres types de savoir, comme les savoirs théoriques, le savoir-être (au contact d’autres cultures, par exemple), ou un savoir-agir pertinent. Lorsqu’il est considéré comme un processus volontaire, apprendre consiste alors à définir, à planifier, à évaluer et à gérer un apprentissage (Holec, 1990). Avec cette conceptualisation de la notion d’apprentissage, que signifie alors savoir-apprendre?
La notion de savoir-apprendre renvoie à « posséder les connaissances et la capacité de mise en œuvre pratique de ces connaissances qui permettent de définir, [de] réaliser, [d’]évaluer et [de] gérer un apprentissage » (Holec, 1990, p. 82). Savoir-apprendre, c’est donc savoir se donner des objectifs d’acquisition des différents types de savoir, savoir se donner les moyens d’atteindre ces objectifs, savoir évaluer les résultats obtenus et, enfin, savoir organiser son apprentissage (Holec, 1990). Bien que cette définition se concentre sur une approche plutôt prospective de la notion de savoir-apprendre, il est possible de l’envisager sous un angle rétrospectif grâce à une démarche réflexive.
Selon les raisons qui les poussent à s’engager socialement, les bénévoles tirent de nouvelles connaissances de leur expérience de bénévolat. En effet, le bénévolat permet de consolider les connaissances, les savoir-faire et les savoir-être déjà acquis avant leur engagement, mais aussi d’en acquérir d’autres à travers un processus d’apprentissage qui est basé sur un savoir-apprendre propre à la personne bénévole. De nombreuses personnes qui s’engagent dans une expérience de bénévolat ne tirent pas réellement de bénéfices en matière d’acquisition de nouvelles connaissances. Cette situation est souvent due à l’absence de développement d’un savoir-apprendre nécessaire en fixant des objectifs d’apprentissage réalisables ou en utilisant les moyens d’apprentissage disponibles dans leur milieu d’accueil. La figure 6.1 présente le cycle de l’apprentissage d’une expérience d’engagement social que nous proposons à la suite de tout ce que nous avons présenté précédemment.
Figure 6.1 Le cycle de l’apprentissage d’une expérience d’engagement social
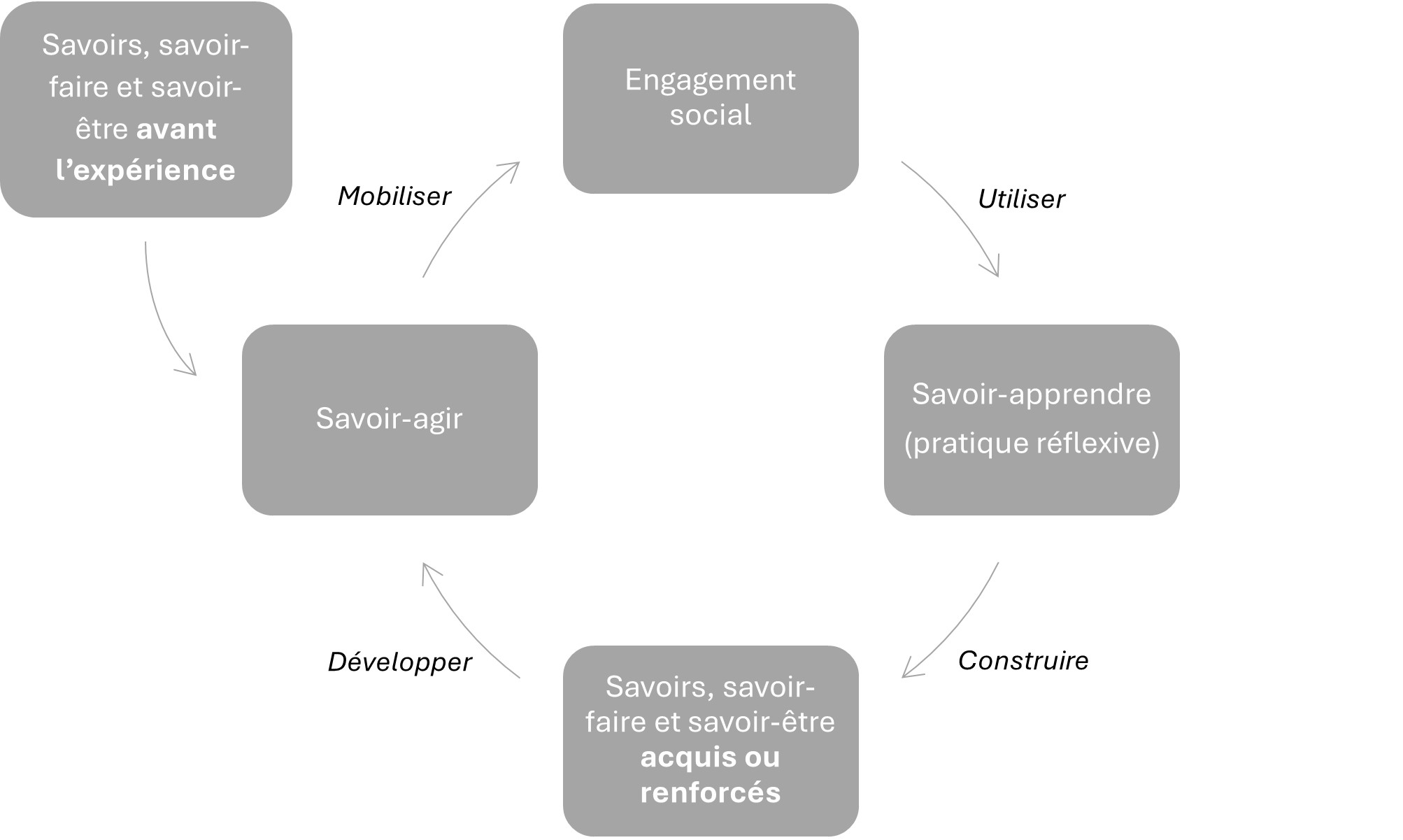
Cette section nous a permis de décrire quatre types de savoirs que les personnes bénévoles peuvent acquérir grâce à une expérience de bénévolat ou d’engagement social. Cependant, ces savoirs ne se développent pas de façon automatique, ils se construisent à travers une expérience de bénévolat. Cette démarche permet aux personnes concernées de distinguer les savoirs mobilisés, les savoirs acquis et ceux qui sont utilisés. Ce diagnostic se fait à travers une pratique réflexive où les personnes bénévoles, seules ou avec l’aide d’une personne enseignante ou d’un proche, parviennent à déterminer les objectifs d’apprentissage que leur expérience leur a permis d’atteindre.
Une expérience d’engagement social est potentiellement porteuse d’apprentissages. Elle est évidemment susceptible d’amener les personnes concernées à faire face à l’incertitude et à remettre en question leurs points de vue et leurs méthodes habituelles. Ces défis peuvent conduire à la croissance et au changement. Mais qu’est-ce qu’une « épreuve » exactement? L’épreuve correspond à un état de déséquilibre plus ou moins important, un état d’incertitude, un état de crise qui se crée lorsque la personne fait face à un écart entre sa situation actuelle et ses connaissances antérieures. Elle représente donc une occasion de se remettre en question et d’interroger ses savoirs qui se sont pourtant avérés viables en d’autres temps et d’autres contextes. Par conséquent, l’épreuve peut représenter une occasion unique de clarifier ce que la personne sait, de comprendre ce qu’elle ne sait pas et d’identifier les nouveaux apprentissages qui pourront guider ses actions futures. Pour apprendre, il est non seulement nécessaire de vivre ces épreuves, mais aussi d’exploiter celles-ci pour en tirer parti.
Afin d’apprendre des épreuves qui surviennent en cours d’expérience, il peut s’avérer utile d’en faire une analyse plus approfondie. C’est ce que propose la posture du praticien réflexif qui consiste à prendre du recul pour expliciter et mieux comprendre les facteurs déterminants qui sont à l’origine des difficultés rencontrées. Il en va de la qualité de l’engagement social et de son potentiel d’innovation. Il est important de se pencher sur les épreuves, les moments de déséquilibre vécus, pour ainsi devenir un praticien réflexif de son expérience d’engagement social. Cela signifie prendre le temps de réfléchir lors de ces moments difficiles pour analyser les enjeux qui ont émergé afin d’accéder à de nouveaux savoirs, de progresser et d’innover. L’approche réflexive occupe donc une place centrale dans l’apprentissage de l’engagement social.
Bruno Bourassa, professeur associé. Faculté des sciences de l’éducation, Université Laval, 2022
Interagir avec des éléments nouveaux peut former des micro-incidents, ce qui inévitablement amènera une réflexion. En effet, nous serons contraints de réévaluer nos convictions, de remettre en question notre engagement social ou notre manière d’envisager la réalisation d’un projet d’engagement. C’est ainsi que l’engagement social se transforme en une occasion d’apprentissage.
Les micro-incidents peuvent avoir pour effet d’enclencher un processus de réflexion. Différents outils peuvent nous aider à analyser cette expérience, tel un journal réflexif à titre d’exemple. En effet, revenir sur des moments importants de notre engagement nous permettra d’entreprendre une réflexion critique. Communément appelée la méthode de l’incident critique, elle vise à se donner l’espace de réajustement nécessaire à la suite de l’analyse des micro-incidents qui se sont produits, afin d’analyser ce que le processus de réflexion aura fait ressortir pour ainsi revoir notre manière de s’engager à la lumière de ces constats.
Manon Chamberland, professeure titulaire, Faculté des sciences de l’éducation, Université Laval, 2022
6.4 Conception et diagnostic d’une expérience d’apprentissage à travers le bénévolat
Les précédentes sections nous ont permis de définir l’apprentissage expérientiel à travers sa définition, d’en énumérer les formes et les avantages, et de présenter le bénévolat comme une source d’apprentissage expérientiel en mettant en évidence les différents types de savoirs qu’une personne bénévole peut acquérir à travers son expérience de bénévolat. Cette section se concentrera sur la manière dont une personne peut apprendre d’une expérience d’engagement social, notamment le bénévolat. Nous décrirons de façon détaillée les différentes étapes du processus de diagnostic et de réflexion qui permettent de tirer un réel apprentissage d’une expérience. Mais avant cela, nous allons nous concentrer sur la pratique réflexive qui sous-tend tout le processus d’apprentissage expérientiel.
6.4.1 Pratique réflexive
Lorsqu’une personne est confrontée à des situations nouvelles, elle agit soit en improvisant, soit en développant une capacité d’apprentissage de l’expérience, ce qui lui permettra d’agir plus efficacement lors de futures situations similaires (Perrenoud, 2001). Cet apprentissage constituerait, pour la personne, une sorte d’entraînement puisque sa réaction face à une situation future sera plus rapide, plus assurée et plus efficace, ce qui limiterait les erreurs et les hésitations dont elle aurait pu faire preuve dans la première situation (Perrenoud, 2001). Ainsi, l’apprentissage peut se faire de manière involontaire, par un ajustement progressif, par essais et erreurs. Il peut également se produire à la suite d’un travail réflexif délibéré et intensif, consenti pour mieux préparer la personne face à une situation future. Cette pratique réflexive permet à une personne engagée de réfléchir à son engagement social, par exemple en tant que bénévole, en donnant un sens à ses actions.
La pratique réflexive est définie comme un processus métacognitif comprenant la connexion avec les sentiments qui se produit avant, pendant et après les situations dans le but de développer une plus grande conscience et une compréhension de soi, des autres et des situations, pour faire en sorte que les pratiques à venir – comprenant les actions, les savoir-être et les relations – soient nourries par les pratiques précédentes (Wald, 2015). La pratique réflexive est donc un moyen efficace d’approfondir et de comprendre notre expérience d’engagement bénévole en développant notre connaissance de soi et notre conscience de soi, ainsi que notre manière d’agir et de réagir. Cette prise de conscience de soi et de ses capacités intellectuelles et sociales permet à la personne bénévole de mieux comprendre comment elle peut contribuer au mieux-être des autres, de l’environnement et de la vie sur Terre. Un retour réflexif sur son expérience et son action bénévole permet également le développement de différents savoirs et de compétences. Il facilite l’évaluation par la personne bénévole de ses forces et de ses faiblesses, ainsi que des ressources dont elle dispose pour mener à bien son engagement.
6.4.2 Notion de réflexion selon Dewey
Pour Dewey (1933, cité dans Ménard et Ratnapalan, 2013), la réflexion renvoie à « une prise en considération active, persistante et attentive d’une conviction ou d’une forme donnée de connaissances à la lumière des fondements sur lesquels elle repose et des conclusions vers lesquelles elle tend » (p. e 57). Pour Dewey, la réflexion découle du besoin d’une personne de trouver une solution à un état de doute, c’est-à-dire à une situation problématique. Par conséquent, le processus réflexif sera donc guidé par ce besoin de résoudre ce doute. Ainsi, il est convaincu que la connaissance ne se limite pas à un événement vécu, mais découle plutôt du processus de réflexion qui en émane.
La théorie de Dewey repose sur le fait que la réflexion sur l’expérience est indispensable pour l’apprentissage, mais qu’elle doit donner lieu à d’autres actions. Par exemple, une personne qui réfléchit sur son don de sang doit être en mesure de le refaire après avoir donné un sens à son action. Les nouvelles connaissances que la personne a acquises grâce à sa réflexion visent à développer des hypothèses qui devront ensuite être confirmées ou infirmées par de nouvelles actions bénévoles. La réflexion ne vise donc pas seulement à faire un retour réflexif sur son expérience ou encore à chercher un sens à son action, elle doit être orientée vers de nouvelles actions. Dewey (1933, cité dans Ménard et Ratnapalan, 2013) perçoit le processus réflexif comme une succession infinie d’étapes, car, pour lui, chaque réflexion mène à une autre réflexion jusqu’à ce qu’une solution soit trouvée pour dissiper le doute ou résoudre la problématique. Pour Schön (1983) et Dewey (1933, cité dans Ménard et Ratnapalan, 2013), la réflexion est considérée comme un processus faisant partie intégrante d’une pratique réflexive. Dewey a identifié cinq étapes illustrées à la figure 6.2 et que Chaubet (2010) résume comme suit :
1) au cours du vécu, une situation interpellante « déclenche » 2) une investigation, notamment par l’observation, qui entraîne 3) une analyse menant à 4) une restructuration de la compréhension de la situation initiale (reconceptualisation), débouchant ou non sur 5) une action différente. (p. 63)
La réflexion peut, au bout du compte, avoir des effets psychologiques sur l’acteur ou l’actrice ou être pragmatique sur l’action.
Figure 6.2 Synthèse du cycle de pensée réfléchie deweyenne revisité par un courant contemporain de pratique réflexive
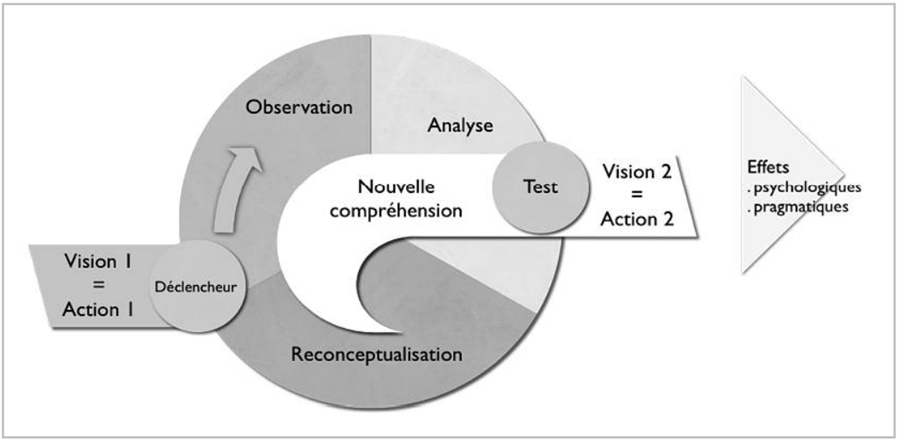
Source : Chaubet (2010, p. 64)
L’élément déclencheur peut être une difficulté rencontrée, une situation inattendue ou tout autre événement qui viendra remettre en question l’importance ou la nécessité de l’action posée. Par exemple, une personne engagée qui donne régulièrement son sang peut se demander pour quelles raisons elle pose cette action sociale. Lorsqu’une personne prend conscience de la difficulté qu’elle rencontre, cela peut la pousser à réfléchir sur son engagement bénévole et sur le sens qu’il revêt pour elle. Le fait de remarquer la difficulté ou la situation problématique peut déclencher chez la personne une investigation ou une enquête réflexive à travers une observation délibérée afin de comprendre et de clarifier la nature de la difficulté. Cette étape d’investigation doit mener à l’identification d’une explication ou d’hypothèses comme solutions possibles à la difficulté ou à la situation. La personne engagée qui donne son sang peut avoir comme hypothèses : (a) elle accorde une importance à aider les autres en sauvant des vies, (b) elle-même ou une personne proche pourrait avoir besoin de sang ou encore (c) elle-même ou une personne proche a bénéficié du don de sang dans le passé. Il peut s’agir de plusieurs de ses hypothèses en même temps. Après cette étape d’émission d’hypothèses, il est maintenant temps de creuser et d’analyser chacune des hypothèses en poussant sa réflexion sur les réponses possibles, en fonction du sens que la personne souhaite donner à son action. Cela demande de prendre le temps de bien mûrir sa réflexion sur chaque hypothèse en ressortant ses points forts et ses points faibles. Enfin, les idées ou l’hypothèse retenue après cette réflexion doivent être soumises à d’autres expériences. L’expérimentation permettra de vérifier, par exemple par l’observation directe, l’hypothèse plausible issue de la phase de réflexion approfondie. L’apprentissage, grâce à une pratique réflexive, est donc un processus continu et sans fin, puisque les expériences futures servent de laboratoire aux savoirs et aux connaissances.
La théorie de la réflexion de Dewey a servi de référence pour d’autres auteurs et auteures, dont Kolb (2014), qui s’en est inspiré pour élaborer son propre modèle. Celui-ci repose sur les mêmes principes que celui de Dewey : le savoir expérientiel est construit à partir d’une réflexion sur une expérience vécue. Kolb (2014) définit d’ailleurs l’apprentissage comme le processus à travers lequel la connaissance est créée par la combinaison de la saisie et de la transformation de l’expérience. Le développement des connaissances transférables en compétences quotidiennes repose sur un cycle d’apprentissage en quatre étapes qui est présenté à la figure 6.3 : l’expérimentation concrète (Concret Exprerience), l’observation réfléchie (Reflective Observation), la conceptualisation abstraite (Abstract Conceptualization) et l’expérimentation active (Active Experimentation). Kolb (2014) résume les quatre étapes comme suit : Les expériences immédiates ou concrètes servent de base aux observations et aux réflexions. Ces réflexions sont ensuite assimilées et transformées en concepts abstraits à partir desquels de nouvelles perspectives d’action peuvent être déduites. Ces implications peuvent être testées activement et servir de guides pour créer de nouvelles expériences.
Figure 6.3 Les quatre étapes du cycle d’apprentissage expérientiel
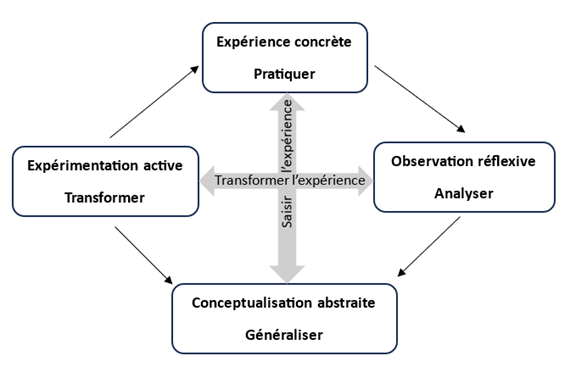
Source : Traduction libre à partir de Kolb, D. A. (2014).
6.4.3 Étapes de la réflexion selon Schön
Schön (1983) théorise les trois moments de la pensée réflexive (dans l’action, sur l’action et pour l’action). Il avance l’idée que la réflexion ne se déroule pas uniquement à la fin d’une expérience, mais au fur et à mesure qu’une personne rencontre des situations qui suscitent chez elle des questionnements. Selon Schön (1983), s’engager dans une pensée réflexive permet à toute personne ayant vécu une expérience d’acquérir une compréhension plus profonde de ses pensées, de ses émotions et de ses actions. Cette pensée réflexive vise, avant tout, à réfléchir à ses expériences en se basant sur ce qui a été positif ou négatif afin d’analyser les raisons et les motivations qui les sous-tendent. Il est généralement plus simple de se demander ce qui nous a plu dans une action que nous avons posée, ce qui était satisfaisant ou non, plutôt que d’essayer de décrire ce que nous avons appris.
Le modèle réflexif de Schön (1991) s’appuie sur une première dimension qu’il nomme « connaissance en action ». Cette notion renvoie à la capacité d’une personne à exécuter une tâche sans réfléchir. C’est cette capacité qu’a une personne professionnelle à exécuter une action de façon habile sans être capable d’expliquer verbalement le processus l’ayant guidée et sans faire recours nécessairement aux savoirs théoriques et pédagogiques acquis antérieurement. C’est une connaissance tacite acquise à travers une enquête et des réflexions propres à la personne professionnelle, mais également sur la base de ses expériences. La connaissance en action représente la connaissance instinctive et procédurale que les personnes professionnelles développent par la pratique et qui informe des prises de décision automatisées (Andersen, 2019).
La deuxième dimension de Schön (1983), la réflexion dans l’action, renvoie à la capacité dynamique d’une personne à évaluer et à adapter ses décisions et ses comportements pendant l’activité ou l’action qu’elle mène. Cela nécessite de grandes capacités mentales pour se poser les bonnes questions en temps réel dans l’action. Dans l’action, la personne réfléchit instinctivement à l’évolution de son activité en faisant usage sur ses savoirs, de son analyse critique et de sa faculté du moment à juger ses propres actions pour essayer de maîtriser ou de modifier ses pratiques pendant l’action. La réflexion dans l’action permet de combiner ses connaissances antérieures avec une projection sur les actions et les résultats ultérieurs de son expérience actuelle. Il s’agit d’une réflexion de l’instant, au moment où l’action se déroule, ce qui permet de renforcer son efficacité immédiate. Selon Beckers et Leroy (2012) :
La réflexion dans l’action (reflection in action) consiste à « être à l’écoute, voire se laisser surprendre » par l’action en cours, grâce à une prise de distance consciente de ce qui est en train de se passer et une tentative de régulation pour une meilleure efficacité. (p. 63)
La troisième dimension, et non la moindre, de la pensée réflexive de Schön (1983), est la réflexion sur l’action. Cette forme de réflexion rétrospective offre la possibilité de prendre du recul pour évaluer et analyser ses actions menées lors de son expérience, ce qui permet d’en tirer des apprentissages et de réfléchir sur les résultats futurs. Dans le cadre d’une réflexion sur l’action, la personne peut analyser, investiguer et évaluer son action ou son engagement bénévole dans le but de développer des connaissances qui lui serviront à améliorer ses expériences futures (Finlay, 2008). Par exemple, lorsqu’une personne fait un don d’argent à un orphelinat, il se peut qu’elle croie, dans un premier temps, que cette action est suffisante pour montrer son engagement envers les enfants démunis, puisqu’elle-même a vécu cette situation dans son enfance. Réfléchir sur ses actions pourrait lui permettre de mieux comprendre pourquoi elle les mène et comment elle pourrait les améliorer dans le futur. Cela pourrait se faire en augmentant le montant de ses dons ou en s’impliquant comme bénévole dans cet orphelinat.
Enfin, cette réflexion rétrospective est suivie d’une réflexion pour l’action ou prospective qui consiste à se projeter dans l’avenir en planifiant, en anticipant et en préparant les actions futures. Il existe un lien étroit entre la réflexion sur l’action et celle pour l’action : « la réflexion sur l’action est à la fois rétrospective (réflexion sur), au sens où elle explicite une expérience vécue, et prospective (réflexion pour), au sens où elle vise à transformer, à améliorer l’action » (Guillemette et al., 2021, p. 1). Des outils de réflexion sont fournis en annexe.
Conclusion
L’apprentissage par les expériences d’engagement social demeure un processus dont le cœur n’est rien d’autre que la capacité de la personne engagée à adopter une pratique réflexive rigoureuse et efficace, mais surtout, qui conduit à la construction de différents types de savoir. Même s’il n’existe plus aucun doute quant au fait que les expériences vécues à travers le bénévolat constituent une source pertinente d’apprentissage, il n’en demeure pas moins que la personne engagée joue un rôle de premier plan dans ce processus d’apprentissage.
En somme, si nous acceptons l’idée que les savoirs et les connaissances, qu’ils soient théoriques ou pratiques, que nous tirons d’une pratique réflexive doivent aboutir à d’autres engagements futurs, il est dont essentiel de prendre le temps nécessaire et de disposer des outils adéquats pour ce processus de réflexion. L’acquisition de nouvelles connaissances au moyen d’une pratique réflexive permet également à une personne d’être plus efficace lorsqu’elle est confrontée à des situations analogues.
Afin d’aider toute personne ayant vécu ou vivant une situation d’engagement social à effectuer une réflexion efficace, et ainsi, à apprendre de son expérience, ce chapitre propose en annexe le modèle de pratique réflexive sur l’engagement social. Ce modèle permet non seulement d’accompagner ce processus, mais aussi de faciliter l’apprentissage tout au long de la vie en favorisant le savoir-apprendre, et ce de manière autonome.
Bibliographie
Anderson, J. (2019). In search of reflection-in-action: An exploratory study of the interactive reflection of four experienced teachers. Teaching and Teacher Education, 86. https://doi.org/10.1016/j.tate.2019.102879
Baechler, J. (2019). Que valent nos connaissances ? Essais et échecs cognitifs. Hermann.
Balleux, A. (2000). Évolution de la notion d’apprentissage expérientiel en éducation des adultes : vingt-cinq ans de recherche. Revue des sciences de l’éducation, 26(2), 263-286. https://doi.org/10.7202/000123ar
Beckers, J. et Leroy, C. (2012). Le rôle de la réflexion dans et sur l’action dans l’activité des enseignants stagiaires : étude exploratoire. Travail et Apprentissages, 10(2), 61-84. https://doi.org/10.3917/ta.010.0061
Bénévoles Canada. (2006). Bénévolat et service communautaire obligatoire : choix – incitatif – coercition – obligation. Incidence sur la gestion des programmes de bénévolat. https://benevoles.ca/wp-content/uploads/2024/06/Benevolat-et-service-communautaire-obligatoire-Incidence-sur-la-gestion-des-programmes-de-benevolat.pdf
Borkman, T. J. (1976). Experiential knowledge: A new concept for the analysis of self-help groups. Social Service Review, 50(3),445-456. https://doi.org/10.1086/643401
Bourgeois, É. (2013). Expérience et apprentissage. La contribution de John Dewey. Dans L. Albarello, J. M. Barbier, É. Bourgeois et M. Durand (dir.), Expérience, activité, apprentissage (p. 13-38). Presses Universitaires de France. https://doi.org/10.3917/puf.albar.2013.01.0013
British Columbia Accountability Council for Co-operative Education. (2017). Comparative matrix of co-operative education with other forms of work-integrated education and work-integrated learning. https://acewilbc.ca/wp-content/uploads/2017/07/ACCE_Matrix.pdf
Callan, M. J. (2020) An examination of benefit and equity in community-university service learning partnerships [Thèse de doctorat, William and Mary School of Education]. http://dx.doi.org/10.25774/w4-mgnb-4n96
Chaubet, P. (2010). Saisir la réflexion pour mieux former à une pratique réflexive : d’un modèle théorique à son opérationnalisation. Éducation et francophonie, 38(2), 60-77. https://doi.org/10.7202/1002164ar
Cnaan R. A. et Goldberg-Glen R. S. (1991). Measuring motivation to volunteer in human services. The Journal of Applied Behavioral Science, 27(3), p. 269-284. https://doi.org/10.1177/0021886391273003
Coget, L. (2023). Théorie et pratiques de l’apprentissage expérientiel au Canada : une revue de littérature. Université de Montréal. https://www.umontreal.ca/public/www/recteur/documents/ApprentissageExperientiel_RevueLitterature_finale.pdf
Coleman, J. S. (1976). Differences between experiential and classroom learning. Dans M. T. Keeton (dir.), Experiential learning: Rationale, characteristics and assessment (p. 49-61). Jossey-Bass.
Conrad, D. et Hedin, D. (1995). National assessment of experiential education: Summary and implications. Dans R.J. Kraft et J. Kielsmeier (dir.), Experiential learning in schools and higher education (p. 382-403). Kendall Hunt.
Conseil de l’Europe. (2001). Cadre européen commun de référence pour les langues : apprendre, enseigner, évaluer. https://rm.coe.int/16802fc3a8
Cox, E. G. (2002). Rewarding volunteers: A study of participant responses to the assessment and accreditation of volunteer learning. Studies in the Education of Adults, 34(2), 156-170.
Crosby, A. (1995). A critical look: The philosophical foundations of experiential education. Dans K. Warren, M. Sakofs et J. S. Hunt (dir.), The theory of experiential education (3e éd., p. 3-14). Kendall/Hunt.
Dallaire, C. et Jovic, L. (2021). Distinguer savoir et connaissances. Recherche en soins infirmiers, 144(1), 7-9. https://doi.org/10.3917/rsi.144.0007
de Landsheere, G. (1979). Dictionnaire de l’évaluation et de la recherche en éducation : avec lexique français-anglais. Presses universitaires de France. https://hdl.handle.net/2268/86580
Dewey, J. (1938). Expérience et éducation. Collier Books
Dewey, J. (2022). Démocratie et éducation : suivi de expérience et éducation. Armand Colin.
Duguid, F., Mündel, K. et Schugurensky, D. (2013). Volunteer work and informal learning. Dans F. Duguid, K. Mündel et D. Schugurensky (dir.), Volunteer work, informal learning and social action. SensePublishers. https://doi.org/10.1007/978-94-6209-233-4_2
Enseignement coopératif et apprentissage intégré au travail (2020). Définitions relatives à l’AIT. https://www.cewilcanada.ca/CEWILFR/CEWIL-FR/About-Us/Apprentissage%20int%C3%A9gr%C3%A9%20au%20travail.aspx?hkey=a8d75bc6-e161-4261-9363-f82159969682
Estes, C. A. (2004). Promoting student-centered learning in experiential education. Journal of Experiential Education, 27(2), 141-160. https://doi.org/10.1177/105382590402700203
Faure, F. et Cucchi, A. (2020). Quelle caractérisation du savoir-être? Une revue de la littérature en deux temps. RIMHE : Revue Interdisciplinaire Management, Homme & Entreprise, 39(9), 3-25. https://doi.org/10.3917/rimhe.039.0003
Finlay, L. (2008). Reflecting on ‘Reflective practice’. Practice-based professional learning centre. The Open University, 8, Article 52.
Gardien, È. (2017). Qu’apportent les savoirs expérientiels à la recherche en sciences humaines et sociales? Vie sociale, 20(4), 31-44. https://doi.org/10.3917/vsoc.174.0031
Gardien, È. (2019). Les savoirs expérientiels : entre objectivité des faits, subjectivité de l’expérience et pertinence validée par les pairs. Vie sociale, 25-26(1), 95-112. https://doi.org/10.3917/vsoc.191.0095
Gardien, È. (2020). Pairjectivité : des savoirs expérientiels ni objectifs, ni subjectifs. Éducation et socialisation. Les cahiers du CERFEE, (57). https://doi.org/10.4000/edso.12581
Godrie, B. (2016). Vivre n’est pas (toujours) savoir – Richesse et complexité du savoir expérientiel. Le partenaire, 24(3), 35-38.
Godrie, B. (2022). Savoir expérientiel. Dans G. Petit, L. Blondiaux, I. Casillo, J.-M. Fourniau, G. Gourgues, S. Hayat, R. Lefebvre, S. Rui, S. Wojcik et J. Zetlaoui-Léger (dir.), Dictionnaire critique et interdisciplinaire de la participation, la démocratie et la citoyenneté, DicoPart (2e éd.). GIS Démocratie et Participation. https://www.dicopart.fr/savoir-experientiel-2022
Guillemette, F., Leblanc, C. et Renaud, K. (2021). Journal réflexif. Document de présentation. Observatoire de la pédagogie de l’enseignement supérieur, Université du Québec à Trois-Rivières. https://oraprdnt.uqtr.uquebec.ca/Gsc/Portail-ressources-enseignement-sup/documents/PDF/noir_blanc_journal_reflexif_presentation.pdf
Holec, H. (1990). Qu’est-ce qu’apprendre à apprendre? Mélanges pédagogiques, 1990, 75-87.
Jacobs, A. C. (2020). The benefits of experiential learning during a service-learning engagement in child psychiatric nursing education. African Journal of Health Professions Education, 12(2), 81-85. https://scielo.org.za/pdf/ajhpe/v12n2/06.pdf
Jacoby, B. (1996). Service Learning in higher education: Concepts and practices. Jossey-Bass.
Jacoby, B. et Howard, J. (2014). Service-learning essentials: questions, answers, and lessons learned. John Wiley & Sons.
Kolb, D. A. (1984). Experiential learning: Experience as the source of learning and development. Prentice-Hall.
Kolb, D. A. (2014). Experiential learning: Experience as the source of learning and development (2e éd.). Pearson Education.
De Landsheere, G. (1992). Dictionnaire de l’évaluation et de la recherche en éducation : avec lexique anglais-français (2é édition revue et augmentée). Presses universitaires de France (Paris).
La Table ronde des affaires + de l’enseignement supérieur. (2024, 3 avril). Aperçus des bénéfices de l’AIT pour les employeurs. https://bher.ca/fr/resource/employer-wil-benefits-at-a-glance
Le Boterf, G. (1999). L’ingénierie des compétences (2e éd.). Éditions d’Organisation.
Le Boterf, G. (2004). Construire les compétences individuelles et collectives (3e éd.). Éditions d’Organisation. https://oraprdnt.uqtr.uquebec.ca/portail/docs/GSC1413/F1004542635_Exercice_Le_Boterf.pdf
Legendre R. (2005). Dictionnaire actuel de l’éducation (3e éd.). Guérin.
Lewin, K. (1951). Field theory in social sciences. Harper and Row.
Mei, T. et Genshu, L. (2018). Intercultural learning, adaptation, and personal growth: A longitudinal investigation of international student experiences in China. Frontiers of Education in China, 13(1), 56-92. http://doi:10.1007/s11516-018-0003-3
Ménard, L. et Ratnapalan, S. (2013). Réflexion en médecine : Modèles et application. Canadian Family Physician, 59(1), p. e57-e59.
Moore, D. T. (2010). Forms and issues in experiential learning. Experiential Education: Making the Most of Learning outside the Classroom: New Directions for Teaching and Learning, 124, 3-13. https://doi.org/10.1002/tl.415
Perrenoud, P. (1999). Construire des compétences, est-ce tourner le dos aux savoirs? Pédagogie collégiale, 12(3), 14-17. https://oraprdnt.uqtr.uquebec.ca/portail/docs/GSC510/F625638269_PC_1999_Perrenoud.pdf
Perrenoud, P. (2001). De la pratique réflexive au travail sur l’habitus. Dans L. Paquay et R. Sirota (dir.), Recherche & Formation – Le praticien réflexif : la diffusion d’un modèle de formation (No 36, p. 131-162). https://doi.org/10.3406/refor.2001.1694
Piaget, J. (1971). Psychology and epistemology: Towards a theory of knowledge Penguin Books.
Reboul, O. (2010). Qu’est-ce qu’apprendre : Pour une philosophie de l’enseignement (10e éd.). Presses Universitaires de France. https://doi.org/10.3917/puf.rebo.2010.01
Robbes, B. (2019). Qu’est-ce qu’apprendre? Collection EMA–École. https://www.meirieu.com/ECHANGES/ROBBES_APPRENDRE.pdf
Schön, D. A. (1983). The reflective practitioner: How professionals think in action. Ashgate.
Schön, D. A. (1991) The reflective practitioner (2e éd.). Avebury.
Tardif, J. (2006). L’évaluation des compétences : Documenter le parcours de développement. Chenelière Éducation.
Theureau, J. (1996). Cours d’action et savoir-faire. Dans D. Chevallier (dir.), Savoir faire et pouvoir transmettre (p. 43-60). Éditions de la Maison des sciences de l’homme. https://doi.org/10.4000/books.editionsmsh.3834
Wald, H. S. (2015). Refining a definition of reflection for the being as well as doing the work of a physician. Medical Teacher, 37(7), 696-699. https://doi.org/10.3109/0142159X.2015.1029897
Willingham, W.W. (1976). Critical issues and basic requirements for assessment. In M. Keeton (dir.), Experiential learning: Rationale, characteristics and assessment (p. 224-244). Jossey-Bass.
Yang, C. Y., Xie, D. et Wong, J. W. C. (2021). Challenges and benefits of experiential learning: The case of overseas exchange programs. Advanced Education, 8(19), 79-81. https://doi.org/10.20535/2410-8286.239232