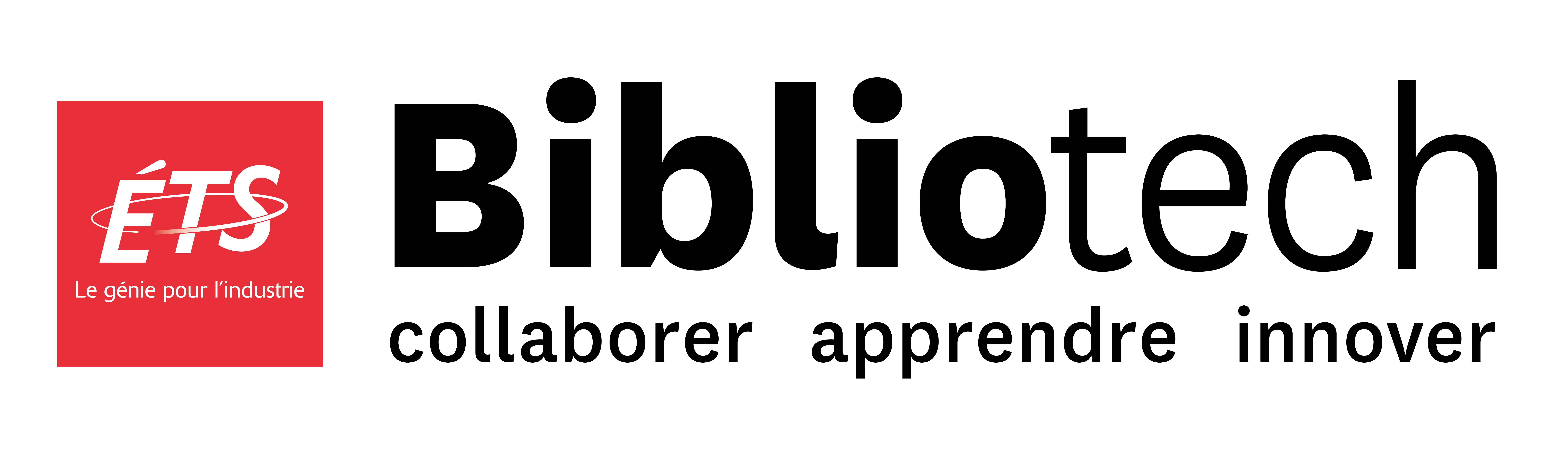Section 1 : dissémination des connaissances, identité de projet et public cible
Qu’est-ce que la dissémination des connaissances
Introduction
Dans des réseaux aussi complexes que ceux de la santé ou de l’éducation, des projets d’amélioration des pratiques professionnelles sont de plus en plus fréquemment mis en place, que ce soit par des personnes travaillant au sein d’une organisation publique ou privée ou par des équipes de recherche contribuant à l’avancement des connaissances. Ces projets peuvent prendre différentes formes : une initiative locale d’un groupe d’intervenants et d’intervenantes, un projet de recherche-action directement sur le terrain, le déploiement de programmes ministériels, des ajustements pour se conformer aux exigences d’organismes d’agrément, etc.
En raison de la distribution complexe du pouvoir dans le système de la santé (Ham, 2003 ; Van Aerde et Dickson, 2017), les personnes menant des projets d’amélioration des pratiques peuvent assumer divers rôles, à différents niveaux, et appartenir à des disciplines professionnelles variées. Pour favoriser le changement dans leur milieu, les personnes menant des projets doivent incidemment exercer un leadership collaboratif, une condition de succès en matière d’amélioration des pratiques (Silva et al., 2022). Toutefois, de multiples obstacles compliquent ces initiatives, notamment la charge de travail élevée, les postes vacants, le roulement de personnel, le manque de financement et le manque d’expertise terrain pour mener les projets (Parmar et al., 2022). Dans un tel contexte, une démarche à la fois structurante, souple et agile aide à créer des outils concrets et à garder le cap vers l’amélioration souhaitée. Cette structure implique des boucles itératives d’analyse des besoins, de conception de nouvelles pratiques ou d’adaptation de pratiques existantes, d’implantation et de dissémination. C’est précisément à cette dernière dimension — la dissémination — que s’intéresse le présent ouvrage. Cette phase essentielle des projets d’amélioration des pratiques joue à la fois un rôle de levier pour favoriser l’implantation de nouvelles pratiques professionnelles et de moyen permettant de transmettre et de mobiliser les connaissances issues des initiatives auprès des publics concernés.
Cette première section définit la dissémination des connaissances et la positionne dans le champ plus large de la mobilisation des connaissances. Dans le contexte de la santé, la dissémination des connaissances peut être comprise à travers de multiples cadres théoriques. Dans cet ouvrage, quatre principaux cadres sont proposés pour définir la dissémination des connaissances dans les projets visant l’amélioration des pratiques.
Mobilisation des connaissances
La mobilisation des connaissances représente un concept parapluie qui englobe plusieurs termes différents : partage, échange, transfert, traduction, application, valorisation, mise en valeur, diffusion, dissémination (FRQ, s.d.).
Bien qu’il n’existe pas de consensus clair quant à la définition de ce concept, on peut définir la mobilisation des connaissances comme un processus global visant à recourir à divers savoirs pour qu’ils mènent à l’action et au changement (FRQ, s.d.). Ces savoirs peuvent provenir de la recherche (ex. connaissances scientifiques) ou d’initiatives d’amélioration (ex. connaissances organisationnelles). Le terme « mobilisation des connaissances » est plus courant dans les milieux francophones, tandis que l’expression « transfert des connaissances » (knowledge transfer) est davantage utilisée dans les milieux anglophones.
Dissémination des connaissances
La dissémination des connaissances constitue donc un sous-concept de la mobilisation des connaissances qui désigne l’ensemble des processus et des pratiques permettant de transmettre, de partager et de diffuser des savoirs (qu’ils soient tacites ou explicites) des acteurs ou des organisations vers des individus, des groupes ou des entités concernées, dans le but de favoriser l’apprentissage, l’innovation ou l’amélioration des pratiques (Lejeune et Vas, 2012).
Diffuser ou disséminer?
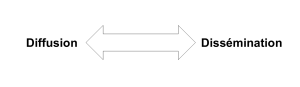
Dans le milieu de la santé, on entend plus fréquemment le terme diffusion des connaissances que celui de dissémination des connaissances. Certains pensent à tort qu’il s’agit de synonymes alors qu’en fait, en sciences de l’implantation (implementation sciences), la dissémination est conceptualisée sur un continuum de la diffusion des connaissances, comme l’illustre le schéma ci-contre (Greenhalg et al., 2004). On distingue donc les deux concepts ainsi:
Diffusion |
Dissémination |
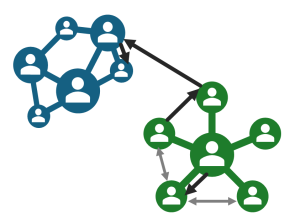 Processus passif de communication d’une information entre utilisateurs par un réseau ou des groupes (Dearing et Kreuter, 2010) qui survient au fil du temps (Rogers, 2003). L’information est relayée par l’intermédiaire des pairs de façon non planifiée et non surveillée (Rabin et al., 2008; Gagnon, 2010). Processus passif de communication d’une information entre utilisateurs par un réseau ou des groupes (Dearing et Kreuter, 2010) qui survient au fil du temps (Rogers, 2003). L’information est relayée par l’intermédiaire des pairs de façon non planifiée et non surveillée (Rabin et al., 2008; Gagnon, 2010).
C’est le bouche-à-oreille du savoir. |
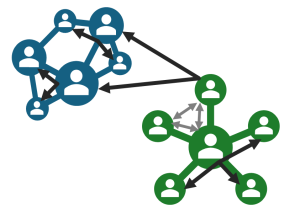 Processus actif de communication d’une information ciblant un réseau d’acteurs concernés (Randall, 2015). La dissémination, contrairement à la diffusion, requiert la définition d’un public cible et l’adaptation du message et de son format à ce même public (Rabin et al., 2008; Gagnon, 2010) à l’aide des stratégies de communication (interactives ou non). En outre, ce processus de communication des connaissances ciblé doit être planifié et surveillé. Une dissémination des connaissances, pour être qualifiée ainsi, doit comporter un plan détaillé et stratégique (Grol, 2020), souvent appuyé sur des principes de communication tel que le model ACME : audience–channel–message–evaluation (Noar, 2012). Processus actif de communication d’une information ciblant un réseau d’acteurs concernés (Randall, 2015). La dissémination, contrairement à la diffusion, requiert la définition d’un public cible et l’adaptation du message et de son format à ce même public (Rabin et al., 2008; Gagnon, 2010) à l’aide des stratégies de communication (interactives ou non). En outre, ce processus de communication des connaissances ciblé doit être planifié et surveillé. Une dissémination des connaissances, pour être qualifiée ainsi, doit comporter un plan détaillé et stratégique (Grol, 2020), souvent appuyé sur des principes de communication tel que le model ACME : audience–channel–message–evaluation (Noar, 2012).
C’est la transformation du savoir à travers l’action intentionnelle. |
Exemple d’application du concept de dissémination des connaissances
Afin d’implanter des innovations dans les systèmes de soins de santé, il est essentiel d’instaurer une communication ouverte, continue et efficace entre les différentes équipes (McGuier, et al. 2024). La dissémination des connaissances est l’un des moyens permettant de structurer ce type de communication active. Par exemple, lors de la pandémie de COVID-19, dès l’apparition des premiers cas graves nécessitant une intubation et une sédation aux soins intensifs du CHUM, une équipe interdisciplinaire a développé un protocole innovant pour faciliter la mise en décubitus ventral afin de limiter les complications et de permettre aux appareillages de demeurer en place.
Grâce à des capsules vidéo et à des simulations qui ont été partagées stratégiquement aux autres unités de soins intensifs, cette pratique a rapidement été disséminée afin que d’autres milieux puissent en tirer profit. De nombreux établissements du Québec et de l’Ontario ont ainsi pu faire appel aux soins intensifs du CHUM pour adopter à leur tour cette nouvelle pratique dans leurs milieux de pratique respectifs. Par ailleurs, l’équipe en question a remporté un prix pour cette innovation.
En résumé, ce qui différencie le terme dissémination des connaissances des autres termes sous le concept parapluie de mobilisation des connaissance est la nature structurée de la communication et la présence d’une stratégie ciblant des acteurs précis (publics cibles). Disséminer des connaissances, c’est donc plus que transmettre de l’information, c’est rendre accessibles et utilisables les connaissances produites ou acquises aux bonnes personnes au bon moment afin d’en maximiser l’impact au sein d’une organisation ou d’un secteur donné. Finalement, il est important de comprendre que bien qu’ils se situent sur un même continuum, la dissémination des connaissances n’entraîne pas nécessairement une diffusion des mêmes connaissances par la suite. Ainsi, après la dissémination des connaissances, la diffusion d’une innovation peut ou non survenir, et inversement (Randall, 2015).
Cadres conceptuels sous-tendant la dissémination des connaissances
Dans cette section, nous vous proposons quatre cadres théoriques différents qui aident à comprendre la dissémination des connaissances dans le domaine de la santé.
1. Théorie de la diffusion de l’innovation de Rogers (2003)
Ce cadre explique le processus d’adoption des innovations selon une courbe en S, où les innovations sont adoptées par un nombre croissant d’individus qui augmente d’abord lentement, puis plus rapidement au fil du temps. Il permet d’identifier les composantes clés favorisant la diffusion d’une innovation au sein d’un réseau, telles que les qualités perçues de l’innovation (avantages relatifs, compatibilité, observabilité, capacité d’essai, complexité, etc.) et la propension à l’innovation chez les membres du public cible (innovateurs, adopteurs précoces, majorité précoce, majorité tardive et retardataires).
Utilité de ce cadre :
- Ce cadre issu de la discipline du marketing offre une feuille de route structurée pour comprendre, planifier et accompagner l’adoption d’innovations. Dans le domaine de la santé, il permet notamment d’anticiper les obstacles, de mobiliser les bons leviers et d’augmenter les chances de succès d’un plan d’amélioration des pratiques, notamment en passant d’une simple diffusion à une dissémination active et ciblée des connaissances.
- Ce cadre permet aussi de bien circonscrire le public cible en se basant sur la propension à l’innovation du milieu dans lequel se déroule un projet.
- C’est à partir de la théorie de Rogers (2003) que la diffusion est définie comme un processus passif. Elle est présentée comme un concept complémentaire à celui de la dissémination des connaissances.
Exemple concret d’une utilisation de ce cadre théorique en santé
Implantation d’une nouvelle procédure de prévention des infections :
- Analyse des qualités perçues : Mettre de l’avant les avantages (moins d’infections, gain de temps, etc.), montrer des résultats concrets.
- Cibler les innovateurs : Former d’abord les leaders d’opinion, les impliquer comme ambassadeurs et relayeurs de la nouvelle pratique.
- Dissémination active : Organiser des ateliers pratiques, offrir du soutien personnalisé, recueillir et partager des témoignages de succès.
- Suivi de l’adoption : Adapter les stratégies pour la majorité, répondre aux préoccupations des retardataires.
2. Cadre de la création des connaissances organisationnelles de Nonaka, Von Krogh et Voelpel (2006)
Ce deuxième cadre, couramment appelé modèle SECI (socialisation, externalisation, combinaison, internalisation), décrit la façon dont les connaissances circulent et se transforment au sein des organisations. Ce modèle met en lumière le processus dynamique de conversion réciproque entre connaissances tacites (difficiles à formuler) et connaissances explicites (facilement transmissibles). Selon ces auteurs, plusieurs facteurs peuvent influencer ce processus de création de connaissances : les ressources organisationnelles disponibles, la capacité à instaurer un dialogue productif au sein des équipes (Baralou et Tsoukas, 2015; Tsoukas, 2009), l’existence d’une culture organisationnelle favorable à l’apprentissage, ainsi que la présence d’un leadership partagé ou distribué (Silva et al., 2022; Currie et Spyridonidis, 2019). Ensemble, ces éléments facilitent l’enrichissement, le partage et l’intégration des savoirs, figures de proue de l’innovation et de l’adaptation organisationnelle.
Utilité de ce cadre :
- Ce cadre décrit le processus nécessaire pour connecter les connaissances actuelles avec d’autres connaissances (qu’elles soient coconstruites lors d’un projet d’amélioration des pratiques ou qu’elles proviennent de la recherche) pour en créer de nouvelles au sein d’une organisation.
- Il souligne l’importance de créer un environnement propice à l’échange et à la création de nouvelles connaissances.
Exemple concret d’une utilisation de ce cadre théorique en soins à domicile
Implantation d’un nouveau protocole d’évaluation des besoins à domicile :
- Socialisation : Organiser des visites croisées entre des intervenants de différentes professions pour observer les besoins à domicile, puis discuter des meilleures pratiques en équipe interdisciplinaire.
- Externalisation : Demander à chaque intervenant d’écrire un cas clinique illustrant l’application du nouveau protocole.
- Combinaison : Compiler ces cas et les intégrer à un guide d’implantation enrichi de recommandations issues des écrits scientifiques.
- Internalisation : Proposer des formations pratiques et encourager la réflexion individuelle sur l’intégration du protocole dans les routines professionnelles.
3. Cadre d’application des connaissances à la pratique de Graham (2006)
Ce cadre, également connu sous le nom de Knowledge-to-Action Framework (KTA), guide le passage des connaissances théoriques vers l’action pratique à travers un processus cyclique itératif qui se décline en sept étapes :
- Déterminer le problème, l’analyser et sélectionner les connaissances les plus utiles pour le résoudre.
- Adapter ces connaissances au contexte local.
- Évaluer les obstacles à l’utilisation des connaissances.
- Déterminer, adapter et appliquer les pratiques innovantes.
- Faire le suivi de l’utilisation.
- Évaluer les résultats.
- Soutenir l’utilisation.
Utilité de ce cadre :
- Ce cadre souligne l’importance d’adapter les connaissances au contexte et de planifier leur dissémination en évaluant les obstacles potentiels.
- Il encourage une évaluation du projet à chaque étape, des résultats de la démarche de dissémination des connaissances et du processus d’implantation.
Exemple concret d’application de ce cadre théorique en physiothérapie
Mise en place d’un protocole visant l’utilisation systématique d’un outil d’évaluation standardisé de l’autonomie à domicile chez les personnes âgées.
- Identifier le problème et sélectionner les connaissances pertinentes: Les physiothérapeutes constatent une variabilité dans l’évaluation de l’autonomie à domicile et une revue des meilleures pratiques permet l’identification d’un outil validé, mais peu utilisé localement.
- Adapter les connaissances au contexte local: Le guide d’utilisation est adapté à partir de l’outil pour tenir compte des réalités des clientèles et des ressources de l’établissement. Les instructions sont traduites, la documentation est simplifiée, des exemples locaux sont intégrés.
- Évaluer les obstacles et facilitateurs: Les physiothérapeutes sont consultés pour identifier les freins potentiels (ex. un manque de temps, une formation insuffisante, etc.) et les possibles leviers (ex. l’intérêt pour l’outil, le soutien de la direction, etc.).
- Sélectionner, adapter et mettre en œuvre des interventions: Des ateliers de formation pratique sur l’outil sont organisés, un mentorat est mis en place entre les pairs pour accompagner les premiers utilisateurs et des supports visuels ou rappels sont fournis dans les salles de réunion.
- Surveiller l’utilisation des connaissances: Le taux d’utilisation de l’outil est suivi dans les dossiers clients et les commentaires des intervenants sont recueillis sur les difficultés rencontrées.
- Évaluer les résultats: L’impact sur la qualité des évaluations est mesuré (ex. complétude, pertinence des recommandations, etc.) et la satisfaction des intervenants et de la clientèle est évaluée.
- Assurer la durabilité: L’outil est intégré dans les procédures officielles de l’établissement, les formations continuent pour les nouveaux employés et des mises à jour régulières sont offertes.
4. Cadre d’évaluation RE-AIM (Glascow et al., 2019)
Le cadre RE-AIM (reach, effectiveness, adoption, implementation, maintenance) est utilisé pour planifier et évaluer les processus de transfert des connaissances dans le domaine de la santé, principalement en santé publique. Il est composé de cinq dimensions :
-
- Portée : L’atteinte des publics cibles.
- Efficacité : L’impact du message.
- Adoption : L’acceptation du changement par les organisations et les personnes ciblées.
- Mise en œuvre : L’uniformité dans l’application de l’intervention.
- Maintien : La continuité des effets de l’intervention pour les individus et les milieux.
Utilité de ce cadre :
- Ce cadre offre une démarche structurante pour évaluer le processus et les résultats de la démarche de dissémination des connaissances et d’implantation.
Exemple concret en réadaptation
Implantation d’un nouveau programme de réadaptation à domicile pour les personnes âgées après une chute.
- Portée (Reach): Mesurer le nombre de clients admissibles et le pourcentage de ceux-ci qui participent au programme, déterminer si le programme rejoint des groupes diversifiés (ex. différents quartiers, niveaux socio-économiques, etc.).
- Efficacité (Effectiveness): Évaluer la réduction du nombre de rechutes après la mise en place du programme, l’amélioration de l’autonomie, la satisfaction des clients et des proches et recueillir des données qualitatives sur l’expérience des participants.
- Adoption (Adoption): Mesurer le nombre d’intervenants et de services qui intègrent le programme dans leur pratique et identifier les caractéristiques des milieux qui adoptent ou non le programme.
- Implantation (Implementation): Vérifier si le programme est appliqué comme prévu (fidelity) (fréquence des visites, respect des protocoles, utilisation des outils recommandés, etc.). Noter les adaptations apportées et identifier les raisons de ces modifications.
- Maintien (Maintenance): Évaluer si le programme continue d’être utilisé 6 mois ou 1 an après son implantation, surveiller la pérennité des effets chez les clients et l’intégration durable dans les pratiques des intervenants.
Conclusion
La dissémination des connaissances constitue une branche du concept plus large de la mobilisation des connaissances et elle joue un rôle clé dans le succès des projets d’amélioration des pratiques dans le domaine de la santé. Comme nous l’avons vu dans cette section, elle ne représente pas un simple acte de diffusion passif, elle repose sur une démarche qui doit être structurée, stratégique et contextualisée. Pour ce faire, quatre cadres théoriques phares peuvent être mobilisés pour soutenir l’exercice de dissémination efficace des connaissances afin de rendre accessibles les savoirs issus de la recherche ou de l’expérience, mais aussi afin de favoriser leur adoption à long terme.
Une fois les bases théoriques intégrées, il est essentiel de bien cerner l’identité du projet que l’on souhaite disséminer : qu’est-ce qu’on souhaite faire? quels savoirs ou pratiques souhaite-t-on partager et pourquoi ? Cette réflexion doit aussi permettre l’identification claire du ou des publics cibles, c’est-à-dire des personnes ou des groupes que l’on souhaite engager. Les prochains chapitres de cette première section du livre proposent un pas à pas pour définir ces deux éléments clés avant d’établir une stratégie de dissémination des connaissances efficace.
Pour citer ce chapitre :
Mélançon, A., Raymond, K. et Lamoureux, V. (2025). Qu’est-ce que la dissémination des connaissances? Dans K. Raymond et A. Mélançon (dir.). Dissémination média : concevoir des stratégies de communication pour une dissémination efficace des connaissances. Université de Sherbrooke. https://pressbooks.etsmtl.ca/dissemination-media. CC-BY 4.0.
Références
- Baralou, E., Tsoukas, H. (2015). How is New Organizational Knowledge Created in a Virtual Context? An Ethnographic Study. Organization Studies, 36(5), 593‑620. https://doi.org/10.1177/0170840614556918
-
Currie, G., Spyridonidis, D. (2019). Sharing leadership for diffusion of innovation in professionalized settings. Human Relations, 72(7), 1209‑1233. https://doi.org/10.1177/0018726718796175
- Dearing, J. W., Kreuter, M. W. (2010). Designing for diffusion: How can we increase uptake of cancer communication innovations? Patient Educ Couns, 81 Suppl, S100-110. https://10.1016/j.pec.2010.10.013
- Fonds de recherche du Québec (FRQ) (s.d.). Mobilisation des connaissances. https://frq.gouv.qc.ca/mobilisation-des-connaissances/
- Gagnon, M. (2010). Section 5.1 : La dissémination et l’échange des connaissances. Instituts de recherche en santé du Canada. https://cihr-irsc.gc.ca/f/41953.html
- Glasgow, R. E., Harden, S. M., Gaglio, B., Rabin, B., Smith, M. L., Porter, G. C., Ory, M. G., Estabrooks, P. A. (2019). RE-AIM Planning and Evaluation Framework : Adapting to New Science and Practice With a 20-Year Review. Frontiers in Public Health, 7. https://www.frontiersin.org/articles/10.3389/fpubh.2019.00064
- Graham, I.D., Logan, J., Harrison, M.B., et al. (2006). Lost in knowledge translation: time for a map? Journal of Continuing Education in the Health Professions, 26(1), 1324.
- Grol, R., Wensing, M. (2020). Chapiter 11 : dissemination of innovations. Dans Wensing, M., Grol, R., Grimshaw, J. (Eds.). Improving patient care: the implementation of change in health care (3e éd.). John Wiley & Sons.
-
Greenhalgh, T., Robert, G., Macfarlane, F., Bate, P., & Kyriakidou, O. (2004). Diffusion of Innovations in Service Organizations : Systematic Review and Recommendations. The Milbank Quarterly, 82(4), 581‑629. https://doi.org/10.1111/j.0887-378X.2004.00325.x
- Greenhalgh, T., Papoutsi, C. (2019). Spreading and scaling up innovation and improvement. BMJ, l2068. https://doi.org/10.1136/bmj.l2068
- Ham, C. (2003). Improving the performance of health services: The role of clinical leadership. Lancet, 361(9373), 1978–1980. https://doi.org/10.1016/S0140-6736(03)13593-3
- Lejeune, C., Vas, A. (2012, 1 avril). La capacité de dissémination des connaissances au sein des multinationales : une approche par les pratiques managériales. Revue Gestion 2000, 29, 15‑35. https://doi.org/10.3917/g2000.292.0015
- McGuier, E. A., Kolko, D. J., Aarons, G. A., Schachter, A., Klem, M. L., Diabes, M. A., Weingart, L. R., Salas, E., & Wolk, C. B. (2024). Teamwork and implementation of innovations in healthcare and human service settings : A systematic review. Implementation Science, 19(1), 49. https://doi.org/10.1186/s13012-024-01381-9
- Noar, S. M. (2012). An audience–channel–message–evaluation (ACME) framework for health communication campaigns. Health Promotion Practice, 13(4), 481-488. https://doi.org/10.1177/1524839910386901
- Nonaka I., von Krogh G. et Voelpel S. (2006). Organizational knowledge creation theory: Evolutionary paths and future advances. Organization Studies, 27(8), 1179-208
- Parmar, J., Sacrey, L. A., Anderson, S., Charles, L., Dobbs, B., McGhan, G., Shapkin, K., Tian, P., Triscott, J. (2022). Facilitators, barriers and considerations for the implementation of healthcare innovation: A qualitative rapid systematic review. Health & Social Care in the Community, 30(3), 856–868. https://doi.org/10.1111/hsc.13578
- Perplexity AI. (2025, 21 mai). Réponses personnalisées générées par intelligence artificielle à des questions sur des exemples en ergothérapie d’utilisation des cadres théoriques en dissémination des connaissances [Communication personnelle]
- Rabin, B. A., Brownson, R. C., Haire-Joshu, D., Kreuter, M. W., Weaver, N. L. (2008). A glossary for dissemination and implementation research in health. Journal of Public Health Management and Practice, 14(2), 117–123. https://doi.org/10.1097/01.PHH.0000311888.06252.bb
- Randall S. (2015). Using communications approaches to spread improvement. London: The Health Foundation. https://www.health.org.uk/publications/using-communications-approaches-to-spread-improvement
- Rogers, E. M. (2003). Diffusion of innovations (5th ed.). Free Press.
- Silva, J. A. M., Miniel, V. A., Agreli, H. F., Peduzzi, M., Harrison, R., Xyrichis, A. (2022). Collective leadership to improve professional practice, healthcare outcomes and staff well‐being. Cochrane Database of Systematic Reviews, 10, Article CD013850. https://doi.org/10.1002/14651858.CD013850.pub2
- Tsoukas, H. (2009). A Dialogical Approach to the Creation of New Knowledge in Organizations. Organization Science. https://doi.org/10.1287/orsc.1090.0435
- Van Aerde, J., Dickson, G. (2017). Livre blanc : Accepter notre responsabilité (plan directeur pour un leadership des médecins dans la transformation du système de santé du Canada. Société canadienne des leaders médicaux. https://physicianleaders.ca/assets/wpfrenchsummary.pdf