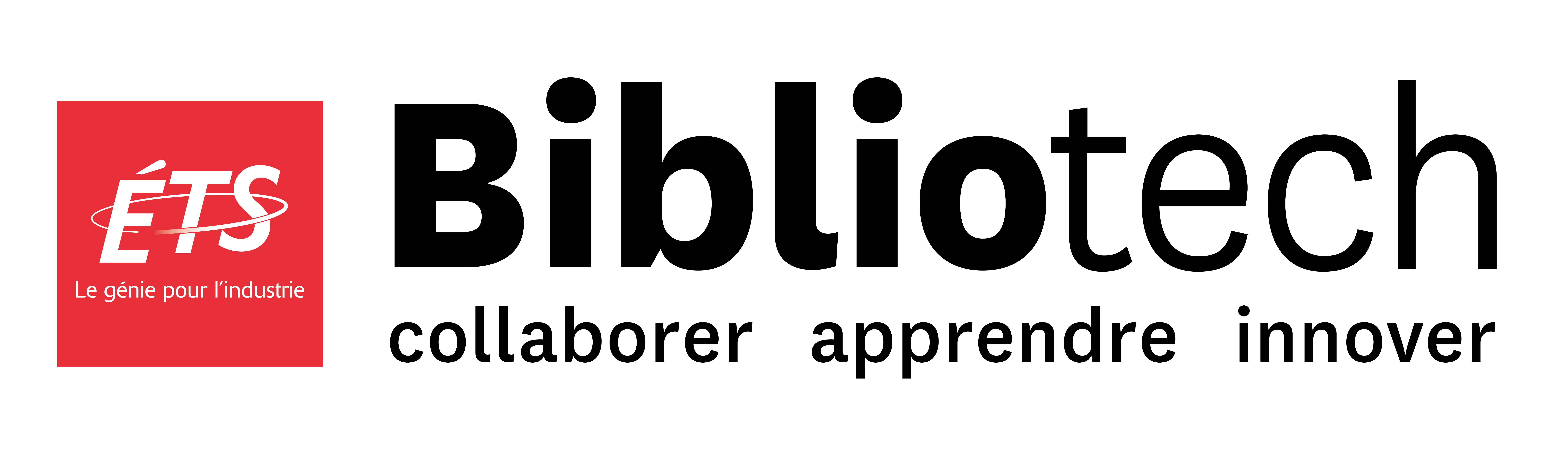Section 2 : Moyens
Production vidéo
Objectifs d’apprentissage
Deux objectifs principaux sont ciblés par ce module :
1) Mieux comprendre les éléments menant au choix une production vidéo pour communiquer clairement et efficacement les connaissances tirées d’une démarche d’amélioration des pratiques professionnelles dans le domaine de la santé et de l’éducation.
2) Expérimenter l’effet d’une production vidéo comme modalité de dissémination des connaissances.
Pour atteindre ces deux objectifs, le module a choisi comme moyen pédagogique d’utiliser une production vidéo pour communiquer les avantages et les inconvénients des productions vidéos ainsi que la démarche de conception. Les apprentissages réalisés permettront de planifier et de justifier une stratégie de dissémination des savoirs qui soit cohérente ainsi que d’être outillé pour réaliser des productions vidéos lorsque cela s’y prête.
Un exemple en introduction
Une équipe d’orthophonistes souhaite ajuster une pratique de téléréadaptation ayant été mise en place il y a plusieurs années déjà. Pour ce faire, elle souhaite engager les parties prenantes dans le processus d’amélioration en mettant en action les gestionnaires, les collègues d’autres départements ayant la même pratique et les personnes usagères des soins aux nouvelles pratiques et actions concrètes à poser. Puisqu’une image et des données textuelles ne suffisaient pas pour rendre compte de la complexité du changement nécessaire dans le processus d’amélioration, une production vidéo a été retenue comme moyen de dissémination. La production vidéo sera sous le thème de chroniques de l’amélioration de la téléréadaptation du service en orthophonie, clientèle 0-7 ans pour les consultations de suivi, soit le projet en cours dans le CISSS de l’équipe. La production vidéo permettra de voir concrètement comment procéder pour mettre en place l’amélioration souhaitée, elle offrira une présentation sommaire de la planification (ce qu’on anticipait les données de l’analyse 360) et des explicitations sur les barrières et les solutions mises en place (ce qui se passe réellement). Un épisode de 2 minutes aux 4 semaines, scripté et narré par le porteur du projet et sans invité avec des images captées en temps réel, mais sans personne usagère de services permettent de procéder avec agilité pour la réalisation de la production vidéo (1h30 de préparation, production et post-production par épisode). Des autorisations des collègues pour l’utilisation de leur image ainsi que du service des communications du CISSS ont été obtenues. L’équipe a choisi de déposer les productions vidéos sur la plateforme commerciale Youtube et de les disséminer dans l’infolettre du CISSS et dans les médias sociaux, tels que LinkedIn, pour « étiqueté » les autres CISSS/CIUSSS (30 minutes d’activités de diffusion par épisode).
Synopsis #1 |
|
| Nature du projet | |
| Titre | Accès vidéo : concevoir une production vidéo |
| Idée générale de la production | Ressource éducative libre (REL) visant à enseigner pourquoi choisir et comment concevoir une production vidéo à peu de frais dans un cadre de dissémination des connaissances. |
| Intentions poursuivies | Développer une vidéo qui s’adresse à toutes personnes faisant un projet (recherche/amélioration de pratiques) à l’intérieur d’une organisation visant à transmettre des informations à autrui. L’idée est de documenter le processus tout en coachant une équipe qui produit une capsule vidéo sur une thématique (ex. : contrer l’âgisme). |
| Description des personnes impliquées | Exemple : Carine Bétrisey et personnes étudiantes finissantes en ergothérapie de l’UdeS qui ont fait une revue des ressources pour sensibiliser à l’âgisme. Le pourquoi et le quoi (récit de vie et témoignages intergénérationnel)
|
| Objets ou thèmes à illustrer |
|
| Lieux de tournage | Studio SSF, Salle grande conférence avec fenêtre, campus principal UdeS, Sherbrooke |
| Diffusion prévue | Licence : Ressource éducative libre (Creative Common 4.0 – CC-BY) |
| Autres points importants | Libération de 4 heures avec les étudiantes et les étudiants |
Scénario : Contenu
Définition du projet
Objectifs
Public cible
Diffusion
Types de vidéos avec exemples
Pour déterminer le type qui convient le mieux à votre sujet, appuyez-vous sur la nature des contenus à transmettre, les cibles visées, les caractéristiques de votre public-cible et l’effet que vous voulez produire avec votre vidéo.
- – Série avec diffuseur (Canal Savoir)
- – Vidéo pour diffusion restreinte (contenus de cours, communication interne)
- – Vidéo publique sur plateforme (YouTube)
- – Vidéo spontanée sur médias sociaux (LinkedIn, Instagram)
Définition d’une vidéo
Ensemble des techniques permettant la formation, l’enregistrement, le traitement, la transmission ou la reproduction d’images (y compris les techniques de reproduction du son associé à ces images) sur un écran de visualisation.
Source : https://vitrinelinguistique.oqlf.gouv.qc.ca/fiche-gdt/fiche/8371126/video
Avantages et inconvénients
- Saisir des choses qui sont en mouvement et du non verbal, l’émotion, l’expertise (une photo ne suffit pas) – 1 à 3 min recommandé (Randall, 2015)
- o Communiquer en peu de temps une information pour le public cible
- Est un moyen efficace de dissémination pour soutenir la prise de conscience (awareness) dans le domaine de la santé et a un potentiel pour soutenir le changement social (Dagenais, et al. 2021; Boydell et Croguennec, 2022), susciter l’intérêt (Tascona, et al. 2021).
- Selon le format voulu = Temps considérable (conception, prod et post-prod.
ratio : 2-3h pour 1 min)- o Importance de s’assurer d’un retour sur investissement :
Contrer l’âgisme – s’assurer que le contenu sera efficace et adapté au public cible : fouiller dans les écrits pour voir ce qui est pertinent (ex. : sensibilisation âgisme, contact intergénérationnel et récit de vie sont importants : Bocksnick et Dyck, 2018)
- o Importance de s’assurer d’un retour sur investissement :
- Si grande ampleur et niveau de qualité important nécessaire = coûts
Ressources matérielles, temporelles, humaines et financières, si applicables
Recherche et rédaction des documents de base
- Synopsis
- Scénario
- Scénarimage
- Plan de tournage
- Calendrier de production
Coconstruction de la scénarisation : Meilleur impact si on voit les parties prenantes dans la vidéo, en sollicitant celles-ci dans le projet, cela crée du changement et de l’intérêt. Meilleur impact aussi pour disséminer des innovations est lorsque la vidéo est diffusée sur une plateforme simple d’utilisation (user-friendly) et complémentaire à des ressources ou à la possibilité d’interaction entre pairs (ex. : groupe sur média sociaux, intranet ou communauté de pratique) (Feo et al., 2021)
Un scénario est un document qui décrit les différentes étapes d’une vidéo, du début à la fin. Un peu comme une maison qui se construit à partir d’un plan – sauve du temps si bien fait! Il contient les informations suivantes : le titre, le sujet, le public visé, le message principal, les objectifs, les sources, le découpage en séquences, les dialogues, les images, les sons, les transitions, les effets spéciaux et le générique . Un scénario permet de structurer et d’organiser son projet de vidéo, de clarifier ses idées, de faciliter la réalisation et la diffusion, et de vérifier la cohérence et la pertinence du contenu. Voici quelques recommandations dans l’élaboration d’un scénario :
- Définir le thème et le but de la vidéo
- Identifier le public cible et adapter le ton et le langage
- Rechercher les informations nécessaires et les vérifier
- Écrire le synopsis, c’est-à-dire le résumé de l’histoire
- Découper le synopsis en séquences, c’est-à-dire en parties logiques et chronologiques
- Détailler chaque séquence en indiquant les éléments visuels, sonores et textuels
- Relire et corriger le scénario
- Faire valider le scénario par des personnes compétentes
Principes techniques (image, son et éclairage)
Optimisez votre configuration pour la captation pour un tournage en solo
- – Avant de passer en mode selfie et d’appuyer sur le bouton d’enregistrement, voici quelques points à prendre en compte.
- – L’éclairage : Choisissez un endroit bien éclairé. La lumière naturelle est souvent la meilleure, mais la lumière artificielle peut aussi fonctionner à la rigueur – faites attention aux ombres. Veillez également à ce que les sujets ne soient pas en contre-jour, sinon ils se transformeront en silhouette.
- – Son : Utilisez des microphones externes (micro-cravate, micro à main ou perche) dès que la situation l’exige : entrevue, conférence, dialogues… L’utilisation d’un microphone externe garantit une qualité sonore de base. Le microphone intégré au téléphone est utile dans un environnement silencieux ou pour l’enregistrement de sons ambiants.
- – Position de la caméra : Personne n’a envie de voir votre nez. Faites un essai vidéo et ajustez le trépied ou ajoutez ou enlevez quelques livres sous la caméra si nécessaire. Près ou loin de vous, le cadrage + ou – serré doit permettre une bonne visibilité des personnes ou objets. Si 2 plans souhaités : règle du 180 degré.
- – Caméra : Si vous enregistrez à partir de votre téléphone, utilisez la caméra arrière. La plupart des téléphones ont une plus grande ouverture et offrent une meilleure résolution à partir de la caméra arrière. Utilisez un trépied ou un support de fortune pour maintenir l’appareil photo stable.
- – Arrière-plan : Évitez les arrière-plans encombrés ou distrayants. De même, si vous prenez des photos dans un bureau, veillez à ce que les documents confidentiels et autres logos de marque soient rangés.
- – Le langage corporel : Maintenez une présence détendue en répétant votre script. Regardez directement la caméra, souriez et respirez naturellement.
Trucs de pros : À compléter, s’il y lieu.
Tournage vidéo
Avant toute chose
Connaître et maîtriser les informations contenues au scénarimage et dans le plan de tournage
Prévoir une rencontre de pré-production avec tous les membres de l’équipe pour discuter et voir à aux détails de tournage (aviser contacts, confirmer locations, aviser des attentes face aux maquillage/vêtements – éviter les rayures, motifs, etc.)
S’assurer que les équipements nécessaires au tournage ont été réservés et vérifiés, que les besoins en alimentation électrique ont été évalués (extensions, batteries chargées ) et qu’un inventaire de tout le matériel a été rédigé afin que rien ne soit oublié sur place une fois le tournage complété
Sur les lieux du tournage
Arriver à l’avance et prendre contact avec les personnes qui vous attendent , les informer de votre plan de tournage, leur remettre une copie du scénarimage au besoin
Répondre aux questions et s’assurer que tout le monde est à l’aise et sait ce qu’il a à faire
Déterminer les endroits où installer le matériel de tournage et délimiter un périmètre de sécurité tout autour
Veiller à la stabilité du matériel lors de l’installation et du tournage, par exemple en munissant les caméscopes de trépieds ou en activant la fonction anti-vibration lors des séquences en mouvement
Faire des tests d’enregistrement afin de s’assurer de la qualité de l’image et du son
Pendant l’enregistrement
Exiger l’attention de tous, il faudra sans doute répéter certaines scènes , s’adapter à la réalité du tournage, prendre des décisions en tenant compte des contraintes, etc.
Vérifier régulièrement le plan de tournage pour ne rien omettre et…
3, 2, 1 Silence! Action!
Avant de quitter les lieux
Ramasser tous les équipements et accessoires
Pour être sûr de ne rien oublier, se référer à la liste d’inventaire rédigée avant de partir
Replacer les lieux tels qu’ils étaient avant votre arrivée
Remercier les gens qui ont participé à la production et qui vous ont accueillis
Trucs de pros : À compléter, s’il y lieu.
Vidéocapture d’écran (screencast)
Avant toute chose
Faire le choix d’un outil logiciel adéquat pour la réalisation de votre projet ou à défaut
Réserver un espace de travail qui offre les installations nécessaires à ce genre de travail
Apprivoiser le logiciel et vérifier qu’il réponde bien aux besoins
Maîtriser les informations contenues au scénarimage
Pratiquer le commentaire audio ou la narration suffisamment pour être capable de le dire de façon naturelle
Avoir en main tous les autres médias (images, graphiques, photos, diaporama, trames musicales, etc.) indispensables à la composition de votre projet
Pendant le temps de la capture
Être attentif à l’environnement dans lequel se déroule l’enregistrement, les bruits ambiants (surtout ceux que l’on entend plus –ventilation, circulation, appareils électriques, etc.) peuvent nuire à la qualité des enregistrements
Lors de l’enregistrement d’une présentation avec commentaire vocal, utiliser un ton, un rythme et un vocabulaire adaptés au public cible
Synchroniser le plus possible contenu visuel et commentaire
Accepter les imperfections – la prise parfaite n’existe pas et le montage permet toujours certains ajustements. Concernant la narration : son contenu doit toujours ajouter de nouvelles informations ou permettre une compréhension plus complète de ce qui est présenté à l’écran. La narration ne doit pas contredire, ni répéter mais bien compléter ce qui montré, à moins bien sûr que ce soit l’effet recherché.
Une fois la capture complétée
Vérifier que vous avez tous les plans prévus au scénarimage et que ceux-ci vous satisfont avant de passer à la prochaine étape.
Trucs de pros : À compléter, s’il y lieu.
Visionnement du matériel tourné ou capturé
Visionner l’ensemble du matériel tourné vous permet
- d’annoter chaque plan
- de faire le résumé des contenus en vue d’établir des liens cohérents entre les scènes
- d’analyser et d’évaluer techniquement les séquences
- de sélectionner les plans qui sont de qualité
- d’indiquer la position en temps (début et fin) de chaque plan retenu
- de préciser les plans qui pourront servir d’illustration, de complément, d’insert.
L’essentiel est de retrouver facilement toutes les informations nécessaires à l’organisation et à la structuration du contenu.
Organisation de séquences en structure
Une vidéo se déroule avec une structure qui comporte au moins trois moments :
- un début, qui introduit et accroche,
- un cœur, qui développe, explique ou apporte des éléments nouveaux,
- et une fin, qui propose des solutions et conclut.
Ces trois moments doivent être suffisamment intéressants pour que l’intérêt de la personne qui regarde soit conservé du début à la fin et que l’enchaînement de tous les éléments permette l’atteinte des cibles visées.
Montage et optimisation
Ne pas sous-estimer le temps.
Logiciel accessible
Importance d’avoir un ordinateur suffisamment puissant (espace disque disponible, bonne RAM/mémoire vive : 32 go (selon Adobe, 64 go si vidéo 4K))
Format pour quel canal de diffusion (vertical pour médias sociaux et consommation sur téléphone; paysage pour site web et consommation sur ordinateur)
Trucs de pros : À compléter, s’il y lieu.
- 1.1 Compression et intégration multimédia (.mp4 vs .mov)
- 1.2 Archivage (cycle de vie) – combien de temps la vidéo sera-t-elle d’actualité
- 1.3 Licence de diffusion (droits)
- 1.4 Plateforme de diffusion (devrait être déjà prévue à ce moment et devrait être multicanaux pour rejoindre le public cible, McCormack, 2013)
- 1.5 S’assurer de mettre en évidence la vidéo (titre, mot clés, métadonnées)
- 1.6 Évaluation (plan de dissémination – s’insérer dans les objectifs et stratégies de comm. de l’organisation)
Trucs de pros : À compléter, s’il y lieu.
Exemple – Livrable 2 (par le groupe étudiant)
Idées pour la vidéo AQDR
- Définir le thème et le but de la vidéo
Sensibiliser les futurs travailleurs de la santé sur les bonnes pratiques à adopter dans leurs interactions chez leurs patients plus âgés.
- Identifier le public cible et adapter le ton et le langage
Les futurs travailleurs du réseau de la santé et des services sociaux.
- Écrire le synopsis, c’est-à-dire le résumé de l’histoire
Trois duos de personnes ainées et étudiants (futurs professionnels) discutent d’expériences âgistes possiblement vécues en consultant un professionnel de la santé et ils en discutent. Expriment leurs impressions. Ensuite, étudiants demandent comment pourraient améliorer leurs pratiques auprès de PA et étudiants complètent avec ce qu’ils
Avoir 3 duos de personnes aînées et d’étudiants pour avoir trois (3) thématiques différentes avec une démarche de co-construction
- Se faire dire notre petite madame
- Parler très fort
- Ne pas offrir la version code QR ou électronique d’un questionnaire, seulement le format papier
- Se faire dire que le vélo c’est terminé à cause de leur âge
Entrecouper de faits sur la problématique qu’est l’âgisme (sans nommer l’âgisme) ou en mettre juste à la fin
Finir avec des moyens sur ce qui pourrait être fait à la place de ces phrases là (leur poser la question)
FORMAT VIDÉO
- Vidéo de 3min
- Participants : 3 duos de 1 PA et 1 étudiant en santé
- Format question-réponse pour sensibiliser à l’âgisme
- Vidéo sur plateforme sur Youtube qui sera diffuser via site web de l’AQDR + réseaux sociaux (FB, Instagram, sur les pages et groupes touchant des futur(e)s professionnel(le)s de la santé (réadaptation, sciences infirmières, médecine, travail social, etc.)
FORMAT SCÉNARIO
Intro : Nom, âge, programme d’étude
- 3 questions de type “scénario” lues par étudiants aux PA :
- Réponse des PA, réactions des PA
- 1 question de type “comment ça te fait sentir d’entendre ces propos/scénario” lues par réalisateurs aux étudiants
- Réponse des étudiants
- 1 question de type “comment éviter cela / changer” lues par les deux/adressée aux deux
- Réponse des étudiants et PA pour trouver solution
IDÉES DE QUESTIONS D’ENTREVUE
Les situations choisies seront des moments âgistes vécus par des PA dans leurs interactions avec les professionnels de la santé.
- A) Demander « Comment vous réagiriez .. » (dire une situation)
- Un intervenant appelle votre nom très fort dans la salle d’attente ;
- On ne vous offre pas la version code QR ou électronique d’un questionnaire alors qu’on l’offre à votre fils ou votre fille ;
- Votre médecin vous appelle « ma petite madame » ou « mon petit monsieur » en utilisant un ton infantilisant ;
- Votre professionnel de la santé s’adresse uniquement à votre proche aidant et lui parle de vous, sans vous parler directement ;
- Un intervenant vous demande de signer des formulaires sans les expliquer et de prendre une décision rapidement, sans savoir ce à quoi vous donné votre accord ;
- Demander si d’autres anecdotes/histoires sur l’âgisme
- Expériences positives ?
- B)
- Comment tu te sens après avoir entendu XX dire ça?
- Qu’est-ce que ça te fait ressentir?
- Es-tu surpris d’entendre cela?
- C)
- Comment mieux agir pour éviter de telles situations?
- Un conseil à suggérer aux futurs professionnels pour éviter cela?
- Qu’est-ce que les futurs professionnels de la santé devraient faire ?
Exemple de vidéo réalisée par des étudiants en réadaptation de l’Université de Sherbrooke, 2024. Osez parler d’âgisme, https://youtu.be/A04Ip53CT3c?si=cCqgsCaNPFTOdBIi.
Références
Bocksnick, J. G., & Dyck, M. (2018). Identifying age-related stereotypes: Exercising with older adults. Activities, Adaptation & Aging, 42, 278-291.
Boydell, K. M., & Croguennec, J. (2022). A Creative Approach to Knowledge Translation: The Use of Short Animated Film to Share Stories of Refugees and Mental Health. International journal of environmental research and public health, 19(18), 11468. https://doi.org/10.3390/ijerph191811468
Dagenais C, Hébert C, Ridde V. Video as an effective knowledge transfer tool to increase awareness among health workers and better manage dengue fever cases. Journal of Global Health Reports. 2021;5:e2021100. https://doi.org/10.29392/001c.29879
McCormack, L., Sheridan, S., Lewis, M., Boudewyns, V., Melvin, K. L., Kistler, C., Lux, L. J., Cullen, K., & Lohr, K. N. (2013). Communication and Dissemination Strategies to Facilitate the Use of Health-Related Evidence. Agency for Healthcare Research and Quality. https://doi.org/10.23970/AHRQEPCERTA213
Randall, S. (2015). Using communications approaches to spread improvement : A practical guide to help you effectively communicate and spread your improvement work. Health Foundation.
Pour citer cette ressource éducative libre : Association québécoise de défense des droits des personnes retraitées et préretraitées (AQDR), Bétrisey, C., Brind’Amour Riffou, A., Côté, É., Joyal, D., Lebeau, J., Lebeuf, S., Magliocco, A., Mélançon, A. et Raymond, K. (2024). Accès vidéo : concevoir une production vidéo. Université de Sherbrooke. CC-BY 4.0.