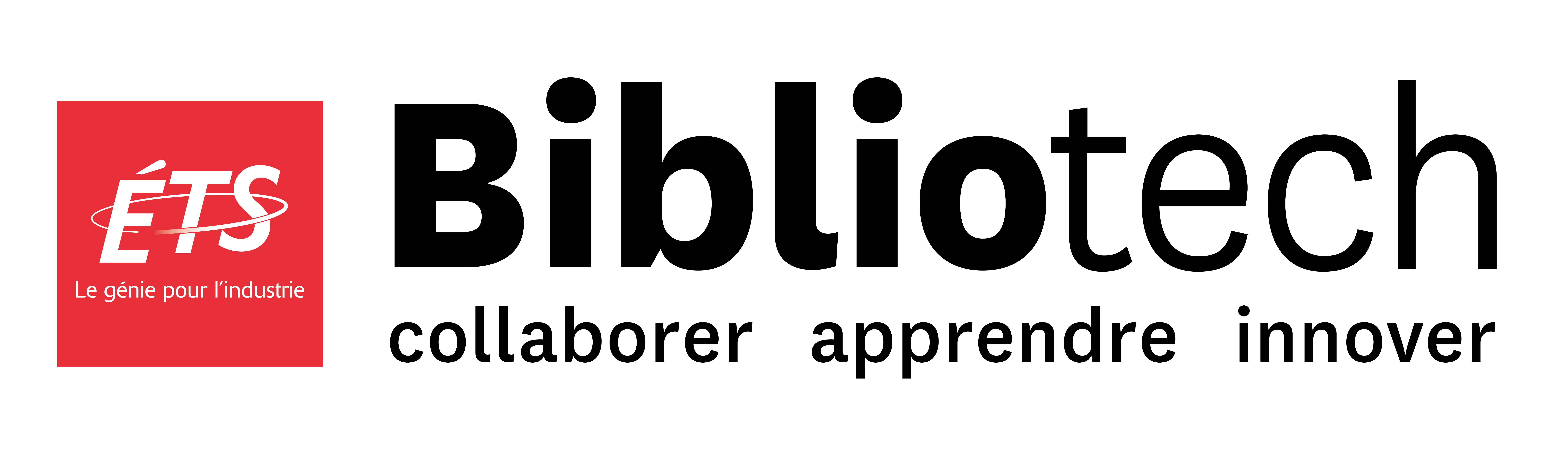Section 1 : dissémination des connaissances, identité de projet et public cible
Connaître son public : un pilier de la dissémination efficace
Introduction
L’identification du public cible constitue une étape clé dans l’élaboration d’une stratégie de dissémination des connaissances efficace. Cette démarche précède la sélection des canaux de diffusion, puisque le choix du canal est étroitement lié aux publics visés. Autrement dit, savoir à qui l’on s’adresse conditionne comment et par quels moyens on communique.
Dans les prochaines sections, nous explorerons en profondeur ce qu’est un public cible en précisant son rôle dans une stratégie de dissémination des connaissances efficace. Nous passerons ensuite en revue certains types de publics couramment rencontrés dans le domaine de la santé, avant d’aborder les méthodes permettant de bien les identifier.
Définition du concept de public cible
Le public cible désigne le groupe précis de personnes ou de professionnels de santé auquel une activité de dissémination des connaissances est destinée. Il se définit par des caractéristiques telles que la fonction (ex. gestionnaires, décideurs politiques, professionnels de la santé, patients ou citoyens), le niveau de connaissances, les besoins informationnels, les contextes de pratique, etc.
Définir le public cible, c’est donc répondre aux questions suivantes : à qui souhaite-t-on transmettre ces connaissances, et pourquoi ?
Comment bien identifier les publics cibles?
L’identification des publics cibles ne se résume pas à dresser une simple liste de personnes ou d’institutions intéressées par un projet donné. Il s’agit surtout d’une étape stratégique, guidée par des étapes qui permettent d’assurer que la dissémination des connaissances atteint les bons destinataires, avec un message pertinent, au bon moment et à travers les bons canaux.
Alignement avec les objectifs du projet
Le choix des publics cibles prend racine dans la réponse à une question simple : quels sont les changements concrets visés par le projet? Par exemple, un projet dont l’objectif serait d’améliorer l’observance médicamenteuse chez les personnes âgées ne ciblerait pas les mêmes groupes qu’un projet sur la gestion des données cliniques dans les hôpitaux. Les cibles doivent donc être identifiées en fonction des objectifs d’impact du projet.
Un bon public cible est un acteur qui :
-
peut utiliser directement les résultats du projet (ex. un infirmier appliquant un protocole amélioré) ;
-
influence la mise en œuvre du projet (ex. un gestionnaire de service de soins) ;
-
bénéficie directement des extrants du projet (ex. les patients ou les aidants).
Il est donc essentiel de distinguer :
-
les utilisateurs finaux des connaissances;
-
les intermédiaires ou relais (leaders d’opinion, associations, médias spécialisés);
-
les décideurs ou financeurs, qui peuvent institutionnaliser ou diffuser plus largement les innovations.
Publics fréquents dans le domaine de la santé
Dans le domaine de la santé, une stratégie de diffusion des connaissances peut cibler différents publics. Voici quelques exemples :
1. Les professionnels de la santé
-
Inclut médecins, infirmières, pharmaciens, intervenants sociaux, etc.
-
Ces acteurs sont à la fois relais et utilisateurs directs de nouvelles pratiques, de protocoles ou de recommandations.
2. Les décideurs et gestionnaires
-
Responsables politiques, administrateurs d’établissements de santé, gestionnaires de programmes, etc.
-
Ils utilisent les connaissances pour orienter les politiques, allouer des ressources et planifier les services de santé.
3. Les partenaires et organismes communautaires
-
Associations de patients, groupes communautaires, ONG, etc.
-
Ils jouent un rôle de relais, d’accompagnement ou de plaidoyer auprès de populations spécifiques.
4. La population générale
-
Grand public, citoyens, familles.
-
Ce groupe est souvent visé par des campagnes de sensibilisation, d’éducation à la santé ou de prévention. Ils sont souvent les bénéficiaires directs des projets d’amélioration des soins.
5. Les groupes spécifiques ou vulnérables
-
Adolescents, personnes âgées, minorités culturelles, populations à risque, etc.
-
Ces groupes ont besoin que les messages soient adaptés à leurs besoins, contextes et niveaux de littératie en santé.
6. Les chercheurs et universitaires
-
Bien qu’ils soient souvent producteurs de connaissances, ils peuvent aussi être utilisateurs des résultats issus d’autres équipes de recherche ou d’autres disciplines pour nourrir leur propre recherche ou enseignement. Ce type de public peut s’avérer un partenaire scientifique précieux (financement, crédibilité, déploiement à grande échelle, etc.)
L’élaboration de cette section a été réalisée grâce à un échange exploratoire avec un modèle de langage (ChatGPT, OpenAI, 2025) qui nous a aidé à déterminer quels sont les publics les plus fréquents en santé.
Comment identifier son ou ses publics cibles?
Le cadre GuiDiR (Guide to Disseminating Research), développé par Scott et al. (2024) offre quelques pistes pour faire cette analyse. Il recommande entre autres d’utiliser la cartographie des parties prenantes (stakeholder mapping). Cet outil vous aide à :
-
lister les différents publics potentiellement concernés;
-
comprendre leurs besoins, leurs attentes, leurs priorités;
-
évaluer leur influence et leur niveau d’intérêt envers le projet;
-
repérer des personnes clés susceptibles de jouer un rôle de relais ou de pont avec les publics visés.
Le cadre souligne également les avantages de repérer des courtiers du savoir (knowledge brokers), c’est-à-dire des personnes capables de faire le lien entre les personnes porteuses de projets et les publics ciblés. Leur rôle est de faciliter la compréhension et l’adoption des messages scientifiques dans des contextes plus pratiques. Par exemple, dans les organisations, les agents de programmation et de planification de la recherche (APPR) agissent parfois comme des courtiers du savoir.
Pourquoi c’est important de bien identifier son ou ses publics cibles?
Bien connaître son public permet de :
-
formuler des messages clairs, adaptés au langage et aux préoccupations des publics visés;
-
choisir les bons canaux de communication (ex. publication scientifique, fiche synthèse, vidéo, présentation orale, etc.);
-
maximiser les chances que le projet soit compris, utilisé et qu’il ait un impact réel.
Outils et ressources pratiques
Plusieurs outils et ressources académiques aident à effectuer une bonne analyse de qui sont les acteurs clés, leurs caractéristiques et ultimement, qui guident les personnes porteuses de projets sur les manière de les mobiliser efficacement.
Cartographie des parties prenantes
La cartographie des parties prenantes consiste à détailler tous les individus ou groupes potentiellement concernés par le projet d’amélioration des pratiques. La matrice de priorisation (influence/intérêt) recommandée par Randall (2015) permet de faire une réflexion exhaustive entourant le niveau d’intérêt et de pouvoir de chaque acteur, afin d’adapter la stratégie de dissémination des connaissances en conséquence (communications rapprochées pour les acteurs à fort pouvoir et intérêt, informations régulières pour les publics moins influents mais concernés, etc.).
Exemple de catégorisation des publics cibles (Randall, 2015)
| Haute influence | Satisfaction par communication ciblée | Gestion rapprochée, rencontres sur mesure |
|---|---|---|
| Basse influence | Communication via les canaux existants | Information régulière, implication terrain |
| Bas intérêt | Haut intérêt |
Analyse du contexte et des besoins
L’identification des besoins, des attentes et des motivations des publics doit être faite tôt dans le processus : enquêtes, entretiens et ateliers participatifs peuvent être utilisés pour comprendre les préoccupations, les freins et leviers d’adhésion. L’outil proposé par Randall (2015) insiste sur la nécessité de sonder très tôt le contexte local (valeurs, priorités, pratiques) et d’impliquer les publics dans la co-construction des messages et du plan d’action.
La force des leaders d’opinion
La dissémination des connaissances passe aussi par l’utilisation optimale des réseaux humains, notamment les leaders d’opinion et les champions du changement. Ces personnes sont souvent reconnues pour leur crédibilité et leur capacité à mobiliser d’autres acteurs. Leur implication dans le processus favorise l’adoption et la diffusion des innovations.
Dans le même ordre d’idées, les travaux de Metz et al. (2022) mettent de l’avant l’importance de développer des relations de confiance pour faciliter l’identification, la mobilisation et la fidélisation des publics cibles. Les stratégies relationnelles (vulnérabilité, authenticité, échange empathique et bidirectionnel, co-apprentissage) et différentes techniques (fréquence des interactions, réactivité, expertise démontrée, célébration des succès) consolident la dynamique entre les personnes porteuses de projets et leurs publics.
Outils de mesure et de suivi
Divers outils peuvent servir à suivre de près l’engagement et l’évolution des publics cibles. Pour n’en nommer que quelques-uns: les indicateurs de participation, l’auto-évaluation de l’adoption des connaissances, la mesure du climat de confiance et l’évaluation de la pertinence et de l’impact des communications.
En bref, en intégrant ces outils et ressources cartographie, un plan de dissémination des connaissances en santé maximise ses chances de toucher les bons publics cibles et d’obtenir un changement de pratiques réel et durable.
Conclusion
L’identification des publics cibles constitue une étape déterminante dans toute stratégie de dissémination des connaissances en santé. En comprenant leurs caractéristiques, leurs besoins et leur influence, on peut adapter les messages et choisir les canaux les plus pertinents. Cette démarche, lorsque soutenue par des outils comme la matrice de Randall (2015), augmente considérablement les chances que les connaissances produites soient comprises, utilisées et transforment les pratiques.
Pour citer ce chapitre :
Lamoureux, V. (2025). Connaître son public : un pilier de la dissémination efficace. Dans K. Raymond et A. Mélançon (dir.). Dissémination média : concevoir des stratégies de communication pour une dissémination efficace des connaissances. Université de Sherbrooke. https://pressbooks.etsmtl.ca/dissemination-media. CC-BY 4.0.