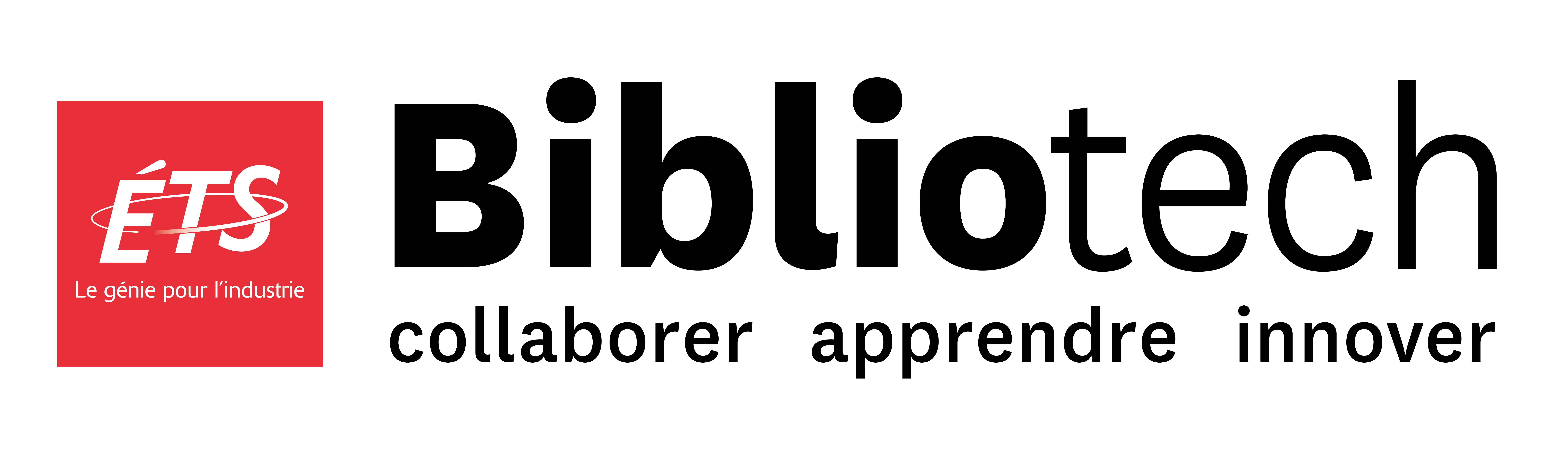4.7 Développer une approche systémique sur l’ensemble de la chaîne de valeur
4.7.1 Évaluer les coûts réels
Pour changer les pratiques linéaires dans une perspective systémique, il est nécessaire d’élargir le cadre de comptabilisation des coûts d’un changement de pratiques ou d’une stratégie de circularité. Il s’agit de sortir de l’estimation des investissements initiaux pour comptabiliser l’ensemble des coûts tout au long du cycle de vie de l’actif bâti et ainsi comparer le coût d’investissement initial en regard des coûts d’opération et de fin de vie, et ainsi tenir compte des gains – qui peuvent intervenir plus loin dans la chaîne de valeur– apportés par la mise en œuvre de stratégies de circularité.
Cela permettrait d’avoir une vision d’ensemble et de dissiper l’idée que la durabilité et la circularité entraînent des coûts élevés.
4.7.2 Approche pour des chaines d’approvisionnement circulaire
Des tensions ont été identifiées au sein des chaînes d’approvisionnement, tant au niveau des ressources humaines que des ressources matérielles.
D’un côté, le manque de compétences en pratiques circulaires chez certains acteurs de la chaîne d’approvisionnement peut ralentir, voire empêcher, la mise en œuvre de nouvelles pratiques. D’un autre côté, la nature spécifique des matériaux circulaires disponibles sur le marché présente de nouveaux défis pour assurer la continuité d’une chaîne d’approvisionnement circulaire et s’adapter aux échéanciers des projets de construction. Par exemple, dans le projet de Rénovation circulaire d’un duplex, les fenêtres qui devaient initialement être réemployées par l’entremise de la chaîne d’approvisionnement circulaire RÉCO, un centre de réemploi de matériaux de construction à Montréal, n’ont finalement pas été mises en place en raison de l’indisponibilité des dimensions nécessaires. D’autres projets[1] ont souligné que la massification des gisements permettrait d’éviter la dispersion des ressources matérielles, améliorant ainsi l’efficacité des chaînes d’approvisionnement circulaires.
Par ailleurs, la définition d’un niveau d’exigence en matière de circularité précis, détaillé et inscrit dans les appels d’offres (c’est-à-dire en amont du processus) doit s’accompagner du développement de filières de repreneurs de matériaux (qui se situe en aval du processus).
Les chaînes de valeur et d’approvisionnement doivent être considérées dans leur totalité, cela en incluant toutes les complexités qu’elles comportent.
4.7.3 Écoconception, durabilité et recyclage : une action conciliée
L’analyse de certaines solutions issues du Lab Construction révèle des tensions intrinsèques entre les concepts de durabilité des matériaux et de recyclage au sein de la chaîne de valeur. Les filières de recyclage actuelles, bien qu’elles soient efficaces pour transformer les matières en nouveaux produits, rencontrent parfois des limitations pour développer des options de seconde vie à long terme, ou sur plusieurs cycles de vie.
Par exemple, une des filières de valorisation du verre issu des portes et fenêtres au Québec est l’intégration dans un processus nommé « microabrasion » qui ne permet de donner qu’une seule nouvelle vie à la matière, alors que le verre est une matière qui peut être recyclée avec peu de pertes matières. Il est donc crucial de ne pas se concentrer uniquement sur les filières de recyclage– qui restent tout à fait pertinentes pour certaines matières ou pour certaines phases de la transition, mais de prendre également en compte la durabilité dans la conception des produits dans une approche intégrée de leur cycle de vie. Une approche durable implique une réflexion approfondie sur l’allongement de la durée de vie des matériaux et l’intensification de leur usage.
En résumé, il est bon de souligner que le développement des filières de recyclage ne doit pas freiner l’innovation en matière d’écoconception de matériaux ou de réemploi. Lorsque ces matériaux atteindront également leur fin de cycle de vie, la question du recyclage devra de nouveau être abordée, illustrant ainsi la complexité et l’approche systémique requise pour une véritable transition circulaire.
Les leviers et les stratégies d’aide à la transition circulaire présentés dans ce chapitre sont complémentaires et couvrent l’ensemble de la chaîne de valeur. Il est donc essentiel de considérer conjointement les stratégies applicables en amont et en aval de la chaîne de valeur. Les constats réalisés dans le cadre du projet de recherche sur le Métabolisme urbain du secteur de la construction de Montréal appuient cette vision : il ouvre la voie à l’exploration des interactions entre les catégories d’impacts environnementaux tout au long du cycle de vie et au-delà des limites de la ville de Montréal. Cette approche systémique permet ainsi d’éviter les effets rebond qui représentent l’un des enjeux majeurs de la transition vers la circularité.
Cette vision systémique permet également d’identifier les implications d’une transition sur les processus, les systèmes et les acteurs.
Au cours des activités de cocréation et d’expérimentation du Lab Construction, il a été constaté que les systèmes et processus actuels soutiennent encore une économie linéaire. Par conséquent, les contextes réglementaires, culturels, techniques et financiers doivent conjointement évoluer pour soutenir le changement de pratiques – et le rôle des décideurs est crucial pour activer ces leviers, tel qu’exploré au chapitre suivant au travers de recommandations spécifiques.
Lire la suite : V. Recommandations pour soutenir le secteur vers plus de circularité
Ensemble des moyens qui peuvent être mis en place pour progresser vers l’économie circulaire.
Ensemble des étapes de la vie d'un produit, d'un procédé ou d'un service.
Ensemble d’activités créatrices de valeur, mises en évidence par l’analyse de l’ensemble des activités d’une organisation, depuis la conception d’un produit jusqu’à son lancement.
Opération par laquelle on utilise une matière résiduelle ou un bien de consommation de nouveau, sans en modifier les propriétés.
Opération qui rassemble les matières résiduelles par flux, de façon à constituer des quantités significatives avant qu’elles soient envoyées en filières spécifiques de traitement.
Ensemble des activités d’une industrie, qui se succèdent et permettent à un produit ou à un service d’intégrer un marché.
Ensemble d’activités créatrices de valeur, mises en évidence par l’analyse de l’ensemble des activités d’une organisation, depuis la conception d’un produit jusqu’à son lancement.
Processus par lequel une matière résiduelle subit des transformations afin d’être utilisée comme matière première dans la fabrication d’un nouveau produit.
Qualité d'un objet, d'une action ou d'une activité qui vise à satisfaire à des principes de respect à long terme de l'environnement physique, social et économique.
Dans le cas du Lab construction, il s’agit de tenir compte de l’ensemble de la chaîne de valeur et de l’ensemble des enjeux d’une problématique donnée, afin de faire les choix les plus pertinents et de tenir compte de leurs effets ailleurs dans la chaîne de valeur. L’économie circulaire, pour fonctionner, doit travailler à l’échelle du système et non à l’échelle d’un produit, d’une organisation ou d’un maillon de la chaîne de valeur.
Ensemble des transformations et des flux de matières et d'énergie qui résultent des activités industrielles et socioéconomiques ayant lieu au sein d'un milieu urbain.
Phénomène par lequel l'amélioration de certains produits et technologies, laquelle vise notamment à utiliser moins de ressources, conduit plutôt, à la suite d'une réorientation des besoins, à une consommation accrue de ressources.
Mode d'émergence des idées dominant au sein du Lab construction - les idées sont créées avec et par les parties prenantes, afin de refléter leurs enjeux et besoins réels.
Système de production, d'échange et de consommation où les ressources sont extraites puis utilisées pour fabriquer des produits qui seront ensuite livrés, consommés puis jetés, sans prise en compte de la capacité de support des écosystèmes.