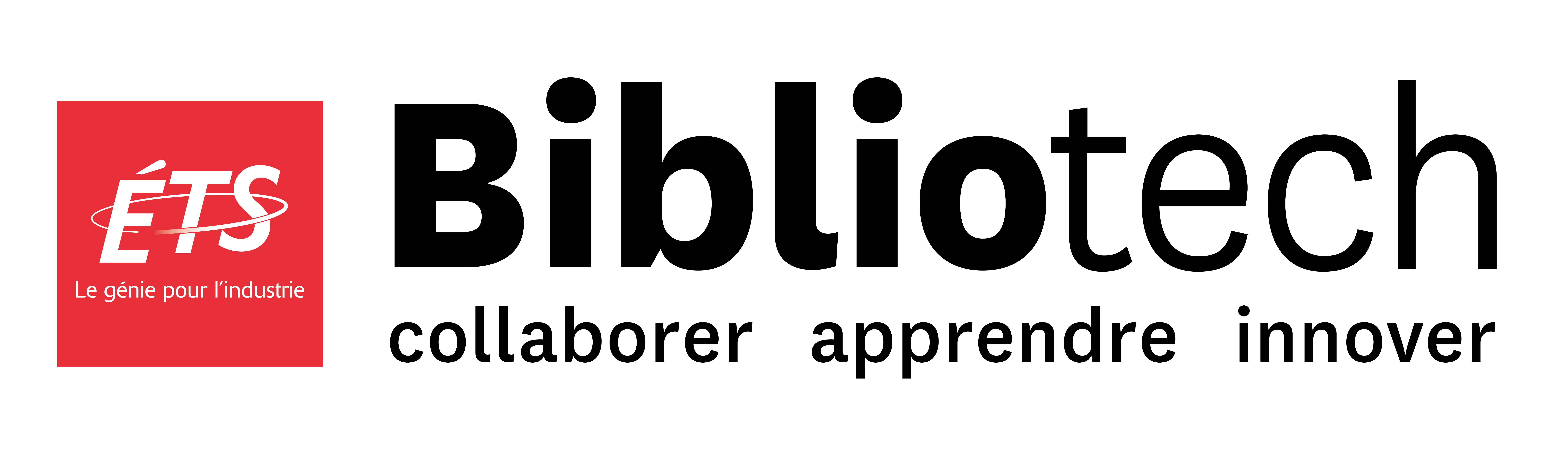Complément : Regards croisés sur les approches de recherche en économie circulaire et construction
Ce chapitre a été rédigé suite à une conversation guidée avec trois chercheurs du Lab construction[1], notamment autour de la thématique de l’interdisciplinarité et de l’interaction entre la recherche et le terrain.
Au cours de cette discussion, le rôle des chercheurs a également été abordé. Ils cherchent avant tout à partager et mettre en lumière les connaissances existantes, à replacer les enjeux dans un contexte historique plus large de la recherche et à faire part du potentiel de certaines solutions.
Les chercheurs peuvent agir alors comme des générateurs et des passeurs de connaissances sur le long terme (tout comme d’autres parties prenantes), tout en éclairant les différentes méthodologies et approches qui se développent au sein d’un domaine. Ces chercheurs jouent un rôle clé en cartographiant les obstacles et en dressant un état des lieux qui permet de prendre la mesure des enjeux. Cette démarche aboutit à la fois à la mise en lumière des perspectives et à l’identification des manquements en termes de connaissances ou d’outils. C’est d’ailleurs en créant un maillage complet entre différentes méthodes de recherche que les chercheurs peuvent obtenir une vision complète et claire de l’écosystème circulaire. Ce travail approfondi de diagnostic et de synthèse offre une base solide pour développer de nouveaux modèles conceptuels et pratiques qui sont adaptés aux besoins évolutifs du secteur. En s’appuyant sur ces perspectives et ces manquements, il devient possible d’imaginer et de construire de nouveaux fonctionnements pour l’avenir.
Les paragraphes suivants explorent les croisements, tensions et points de convergence au sein même de la recherche et en lien avec les parties prenantes du secteur.
Différentes approches pour surmonter les obstacles à la circularité
Les approches théoriques et pratiques apportent chacune une perspective unique qui se complémentent. Alors que la théorie propose un cadre d’idées qu’il est nécessaire de tester face à la réalité, la pratique pour sa part permet de mieux comprendre les contraintes du terrain. En plus de se compléter, ces deux approches s’informent mutuellement et sont indispensables pour trouver des solutions adaptées aux freins à la circularité.
Ces dernières années, la manière de mener la recherche a évolué : autrefois principalement théorique, la recherche devient aujourd’hui plus pratique et collaborative. Pour ce faire, la recherche se fonde maintenant sur des processus itératifs qui mettent à contribution des professionnels, des utilisateurs et les milieux preneurs. Toutefois, la recherche théorique n’a pas été pour autant abandonnée et il existe parfois une séquence temporelle entre ces deux approches. Dans ce contexte, la recherche théorique ou fondamentale permet de « défricher » certaines questions, et par la suite un transfert ou des itérations ont lieu afin de faire le pont vers la recherche pratique ou appliquée dans le cadre de laquelle les parties prenantes terrains intègrent et modifient ces nouveaux apports théoriques. D’autres fois, l’initiation de la recherche se fait plutôt sur le terrain – lequel implique des enjeux dans un contexte territorial spécifique – et cette réalité empirique informe alors et dirige la recherche théorique. L’histoire de la philosophie des sciences nous apprend l’importance de la complémentarité de ces deux approches de recherche (conceptuel vers empirique VS empirique vers conceptuel) et il convient de l’appliquer dans le déploiement de l’économie circulaire dans notre société. Dans le cadre du Lab construction, l’utilisation de différentes approches dans un projet permet à toutes les parties prenantes de mieux communiquer et d’élaborer des recommandations pour aider à la prise de décision. Les méthodes sont ainsi au service du projet, et non l’inverse. Ce dernier point est d’autant plus vrai dans le cadre des recherches sur l’économie circulaire où chaque contexte territorial est unique. Les projets du Lab construction ont permis d’illustrer la manière dont différentes approches méthodologiques peuvent être réunies autour d’objectifs communs même lorsque chaque acteur a ses propres priorités et points de vue.
Des collaborations interdisciplinaires comme leviers pour la recherche d’impacts
L’économie circulaire, du fait de son caractère systémique, ne peut se développer dans des silos disciplinaires. Pour être efficace, elle nécessite une collaboration étroite entre les différents regards disciplinaires, de même qu’un langage commun entre ces disciplines afin d’aborder la complexité des enjeux liés à la transition vers l’économie circulaire. En ce sens, le Lab construction et l’écosystème de recherche qu’il a mis en place constituent de concert une voie qui est intéressante et prometteuse.
Dans ce contexte, il est important de distinguer la multidisciplinarité de l’interdisciplinarité : la première juxtapose les disciplines tandis que la seconde s’intéresse aux relations et communications entre ces mêmes disciplines. La recherche en économie circulaire doit impérativement être interdisciplinaire car elle doit favoriser la rencontre et l’échange entre les disciplines pour générer de nouvelles connaissances et ouvrir des champs de recherche inédits, à la hauteur de la portée des changements nécessaires à la circularité. Ces interactions amènent souvent à questionner et à adapter les méthodes de recherche en fonction des projets, des objets d’étude ou des thématiques abordées. Pour cette raison, c’est souvent à travers les collaborations interdisciplinaires qu’il est possible d’appréhender la nature complexe et globale des défis tout en les relevant. En somme, l’interdisciplinarité est essentielle pour questionner et repenser collectivement un système établi. Ce travail en commun permet de dépasser les limites traditionnelles des disciplines et de coconstruire des solutions qui sont davantage adaptées aux enjeux de l’économie circulaire. En ce sens, le Lab construction illustre bien ce succès de l’interdisciplinarité[2]. Il a non seulement renforcé les liens entre des disciplines – telles que l’architecture, l’ingénierie, le droit, l’urbanisme, l’administration des affaires, la science des données, et le design – mais a également mis en lumière de nouvelles pistes de recherche issues des échanges entre chercheurs de divers horizons. Il a également permis de créer un espace neutre qui permet d’avoir des discussions en dehors des schémas traditionnels de la recherche. La transdisciplinarité, c’est-à-dire le dépassement des frontières disciplinaires pour créer un véritable mélange des savoirs, où l’ensemble des disciplines sont réellement intégrées pour concevoir des solutions cohérentes, est également une approche qui permettrait d’ouvrir la recherche et l’innovation en circularité. Un exemple de transdisciplinarité dans le secteur de la construction est la nouvelle approche de « conception intégrée » qui rassemble les différents corps de métiers associés à un projet de construction (ingénierie, architecture, conception mécanique, entreprenariat général) pour mieux servir les intérêts du projet.
Une confrontation entre les intérêts détaillés de la recherche et la réalité complexe d’un secteur en transition
Dans un système en transition, les échanges et le partage de connaissances entre acteurs sont essentiels pour faire évoluer les pratiques. À cet effet, il est crucial de s’appuyer sur les informations provenant des projets spécifiques, lesquels s’enrichissent à leur tour à partir des défis systémiques identifiés par une approche globale. Ce va-et-vient entre une vision systémique, qui est souvent impulsée par le milieu académique, et des objectifs précis sur le terrain portés par les acteurs du secteur, permet de révéler de nouveaux potentiels de circularité et de mieux comprendre la chaîne de valeur qui y sous-tend. Notons aussi que les implications et engagements varient selon les acteurs offrant ainsi une approche qui est à notre sens bonifiée : les universitaires apportent une vue d’ensemble du système, tandis que les acteurs de l’industrie se concentrent sur un maillon spécifique de la chaîne de valeur. Cette divergence crée des tensions. Cependant, ces frictions sont productives car elles conduisent à des réflexions nouvelles et plus approfondies. Ainsi, le travail de cocréation de début du Lab s’est placé au niveau systémique, par la suite le travail par projets a été de type spécifique, puis la fin du Lab a proposé un retour au niveau systémique, notamment à travers les webinaires[3] qui ont apporté des regards croisés sur les enseignements issus des projets et la présente publication.
Dans une optique d’amélioration du secteur, le Lab construction a instauré une culture de la collaboration et de la co-construction par l’entremise des méthodes de recherche participatives. Il a réussi à accorder le temps nécessaire pour permettre aux acteurs d’échanger, d’évoluer, de réfléchir autrement et de mieux appréhender la complexité du système qui est à la fois multidisciplinaire et multi-acteurs. L’équipe du Lab construction du CERIEC va continuer à mobiliser la force de recherche au sein du Lab construction, la suite du Lab construction en cours de développement. Cette suite prendra en compte ces éléments de réflexion dans la mise en œuvre de son approche.
Des temporalités divergentes
Nous avons pu observer que les tensions entre les milieux académique et professionnel découlent en partie des différences de temporalités. Alors que les professionnels travaillent sur des objectifs à court terme, les chercheurs pour leur part se projettent sur le long terme. Il est cependant intéressant de noter qu’il existe une distinction au sein même des équipes de terrain : les équipes de conception (architectes, ingénieurs, designers) tendent à réfléchir au long terme tandis que les équipes de production (manufacturiers, fabricants) sont plus centrées sur des optimisations à court terme.
Le projet sur la Construction modulaire et circulaire a mis en lumière ces différences. Par exemple, en matière d’économie circulaire, les équipes de conception perçoivent la transition comme étant déjà en cours, alors que les équipes de production la voient plus lointaine en se demandant si elle répond à des besoins immédiats (notamment de rentabilité). Ces divergences influencent directement l’engagement des parties prenantes et doivent impliquer un travail de réconciliation entre les différentes phases d’un projet.
La diversité inhérente à la cocréation : source de complexité… et de richesse
Enfin, les méthodes participatives et de cocréation créent des tensions du fait qu’elles intègrent différentes réalités. Ces tensions vont de pair avec les processus de recherche qui sont plus longs et plus complexes dans le contexte d’approches participatives. Il convient de rappeler que les méthodes de recherche traditionnelles prenaient en compte la seule réalité des chercheurs alors que de nos jours les approches participatives incluent aussi les parties prenantes concernées dans leur démarche. Cette complexité n’est pas un frein en représentant plutôt une opportunité de collaboration entre les milieux académique et professionnel : les équipes de recherche peuvent accompagner les parties prenantes de terrain dans la collecte d’informations et aider dans la prise de décisions justes, éclairées et diversifiées, tandis que les milieux professionnels informent les équipes de recherche des enjeux réels de la transition circulaire du secteur. Ce type de collaboration a notamment été possible par l’impulsion du Lab Construction qui a dès le départ cherché à transformer les pratiques au lieu de s’intéresser uniquement à la production de nouvelles connaissances. En impliquant les parties prenantes, le Lab construction a pu appréhender la pluralité des réalités et ainsi faire émerger des tensions constructives qui alimentent la transition vers la circularité.
Les différents niveaux d’intervention pour la transition vers la circularité : matériaux, bâtiments, territoires
Le Lab construction a mis de l’avant trois niveaux d’intervention que sont les matériaux, les bâtiments et les territoires. L’idée de concevoir un bâtiment adapté à un contexte spécifique aujourd’hui, tout en permettant sa déconstruction dans un autre contexte plus tard, va bien au-delà des questions techniques. Cela soulève des enjeux liés aux conditions climatiques (vent, charges de neige, sismicité) et aux réglementations locales, tout en tenant compte des spécificités géopolitiques et socio-économiques de chaque territoire.
Ainsi, au sein d’un même territoire administratif (comme le Québec, par exemple), les contraintes géographiques, économiques, réglementaires et sociales peuvent varier considérablement d’une région à l’autre. Ces disparités créent un besoin croissant pour un découpage territorial adapté, capable de tenir compte des spécificités locales tout en soutenant une vision globale de l’économie circulaire. Ce constat pose alors une question cruciale : faut-il « sur-concevoir » (over-design) les projets pour préserver leur potentiel de circularité et éviter les limitations futures qui pourraient découler d’un contexte territorial différent ? Cette approche anticipative, bien qu’ambitieuse, soulève néanmoins des inquiétudes quant au risque de gaspillage potentiel de ressources dans le cas où cette circularité, pourtant prévue, ne se concrétiserait jamais.
Ces questionnements mettent en lumière une tension fondamentale entre la nécessité d’innover dans les pratiques et technologies constructives, et l’applicabilité concrète de ces innovations sur le terrain. En effet, certaines solutions conceptuelles, souvent développées dans un contexte théorique ou expérimental, peuvent sembler déconnectées des réalités pragmatiques auxquelles font face les acteurs de la construction : contraintes budgétaires, manque de compétences spécialisées, ou encore inertie des processus traditionnels.
Ces réflexions conduisent à une remise en question plus large de l’ensemble de la chaîne de valeur et d’approvisionnement. Comment garantir que les matériaux, les procédés et les infrastructures nécessaires pour mettre en œuvre ces innovations soient réellement disponibles et accessibles ? Parallèlement, elles interrogent les habitudes constructives actuelles, parfois ancrées dans des pratiques linéaires qui peinent à s’adapter aux exigences circulaires.
Pour réussir cette transition, il est donc essentiel de penser ces trois niveaux d’intervention — matériaux, bâtiments et territoires — de manière intégrée. Cela signifie développer des matériaux innovants et adaptés aux besoins circulaires, concevoir des bâtiments flexibles et démontables permettant une reconstruction optimale dans d’autres contextes, et intégrer ces approches à l’échelle des territoires pour garantir une cohérence entre innovation et réalité terrain. Une telle démarche favoriserait ainsi une transition réaliste, adaptée et durable vers une économie circulaire.
- avec les chercheurs Mathias Glaus (ÉTS), Bechara Helal (UdeM) et Carlo Carbone (UQAM) en octobre 2024, sous forme de deux entrevues ↵
- Voir par exemple le projet Économie circulaire à l’échelle d’un quartier ↵
- L'équipe du Lab construction a diffusé une série de 8 webinaires abordant de manière croisée les résultats des projets du Lab ↵
Interaction de deux ou plusieurs disciplines ou spécialités à la fois, organisées en fonction d'un projet à réaliser ou d'un problème à résoudre.
Les parties prenantes sont l’ensemble des personnes ayant un intérêt plus ou moins direct dans les thématiques traitées par le Lab, et ses projets. Le niveau de participation au Lab des parties prenantes est variable.
Dans le cas du Lab construction, il s’agit de tenir compte de l’ensemble de la chaîne de valeur et de l’ensemble des enjeux d’une problématique donnée, afin de faire les choix les plus pertinents et de tenir compte de leurs effets ailleurs dans la chaîne de valeur. L’économie circulaire, pour fonctionner, doit travailler à l’échelle du système et non à l’échelle d’un produit, d’une organisation ou d’un maillon de la chaîne de valeur.
Juxtaposition de disciplines diverses.
Pratique visant à rassembler les différents intervenants d’un projet de construction, et ce de la planification initiale à l’occupation du bâtiment. Ainsi, les gestionnaires, les promoteurs, les architectes, les ingénieurs, les experts-conseils, les urbanistes, les entrepreneurs et les clients collaborent entre eux pour atteindre un objectif commun, soit l’optimisation du processus de conception et de construction du bâtiment.
Ensemble d’activités créatrices de valeur, mises en évidence par l’analyse de l’ensemble des activités d’une organisation, depuis la conception d’un produit jusqu’à son lancement.
Mode d'émergence des idées dominant au sein du Lab construction - les idées sont créées avec et par les parties prenantes, afin de refléter leurs enjeux et besoins réels.
Processus par lequel divers acteurs, sur un pied d'égalité, collaborent de manière volontaire en vue de l'atteinte d'un but commun.
Démantèlement sélectif d'un bâtiment ou d'un ouvrage, effectué de manière à récupérer certains de ses éléments constitutifs en vue de leur remploi ou de leur recyclage.