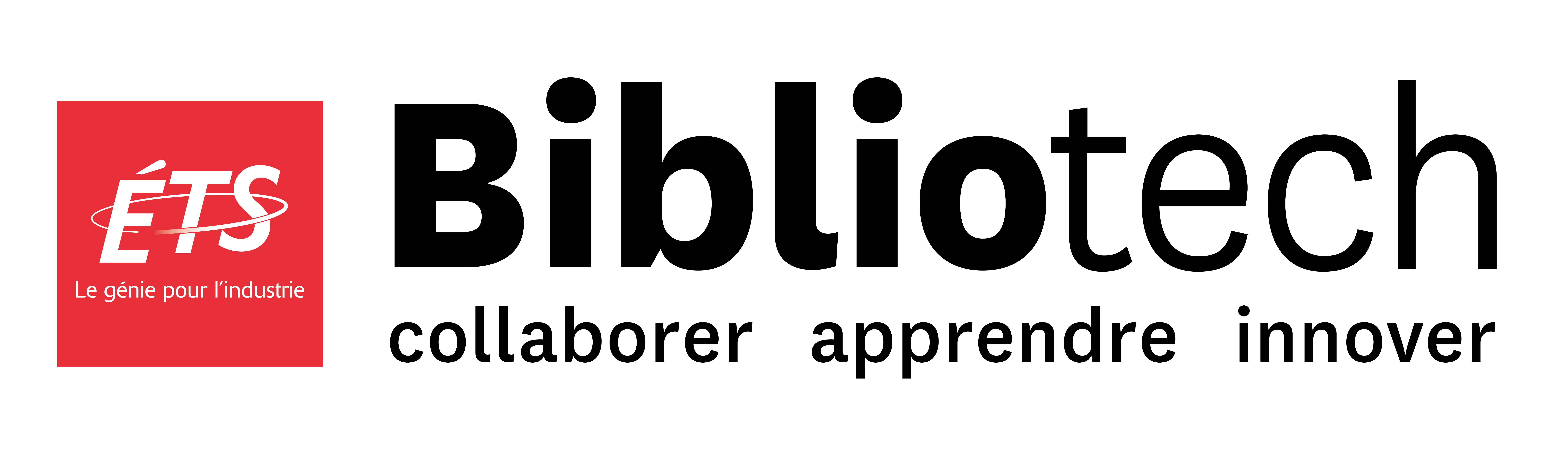5.3 Déployer des outils numériques et de quantification pour soutenir la transition
5.3.1 Opérationnaliser un cadre de traçabilité des matériaux
Un cadre de traçabilité a été développé dans le cadre du Lab construction. À ce stade-ci, il reste désormais à l’opérationnaliser pour suivre les matériaux tout au long de leur cycle de vie. Ce cadre doit inclure des processus clairs et des outils spécifiques pour capturer, gérer et analyser les données relatives aux matériaux utilisés dans les projets de construction et ainsi faciliter leur exploitation dans plusieurs cycles de vie.
Pour une traçabilité efficace, il est impératif d’améliorer l’interopérabilité des données et des outils utilisés dans le secteur de la construction. En ce sens, les systèmes de gestion des données doivent pouvoir communiquer entre eux de manière transparente, ce qui facilite ainsi l’échange d’informations et la collaboration entre les différents acteurs du secteur.
Depuis 2024, l’Union européenne établit progressivement une nouvelle réglementation exigeant que presque tous les produits vendus dans l’UE soient dotés d’un passeport numérique des produits (Digital Product Passport – DPP), incluant les matériaux de construction. Ce passeport numérique est en cours de déploiement en Europe[1], et représente donc un modèle intéressant pour l’opérationnalisation d’un cadre de traçabilité des matériaux au Québec. Les marchés européens et canadiens d’importation et d’exportation de matériaux étant interreliés, il est nécessaire d’anticiper l’interopérabilité des données et la compatibilité des systèmes de traçabilité déployés dans les deux zones. Le gouvernement fédéral pourrait faciliter la mise sur pieds d’un tel outil, tandis
Finalement, la faible numérisation des petits projets constitue un défi majeur pour la traçabilité des matériaux. Il est possible d’aider à relever ce défi en faisant la promotion de l’utilisation d’outils numériques accessibles et faciles à utiliser pour les petites entreprises.
5.3.2 Développer des bases de données robustes
L’absence de données fiables sur les matériaux complique le calcul des indices de circularité, la mise en œuvre de la traçabilité et le développement de logistiques circulaires. Des bases de données exhaustives et précises des matériaux de construction doivent être développées. Celles-ci devront notamment inclure des informations sur leur impact carbone et leurs caractéristiques principales. Il est important de développer et de maintenir des bases de données détaillées sur les flux de matériaux, et particulièrement à l’échelle provinciale et régionale. Ces données permettent d’identifier les opportunités de réutilisation et de valorisation des matériaux et ont le potentiel de promouvoir une plus grande sobriété dans l’utilisation des ressources vierges.
5.3.3 Quantifier les bénéfices environnementaux de la circularité
Il est également recommandé de mettre en place des méthodes de quantification des bénéfices environnementaux de la circularité, notamment en matière de réduction des émissions de GES, de préservation des ressources et de la biodiversité. Les résultats de ces quantifications doivent être utilisés pour éclairer les décisions politiques et les stratégies de développement urbain afin d’éviter le déplacement d’impacts, au sein du territoire en question ou bien à l’extérieur de celui-ci. Des bases de données robustes sont nécessaires pour assurer la fiabilité et l’utilité de ces méthodes quantitatives (voir 5.3.2 Développer des bases de données robuste) et le développement de ces bases et de ces méthodes devrait être soutenu par les gouvernements provincial et fédéral.
5.3.4 Systématiser l’ACV circulaire
Le déploiement de l’ACV comme outil de quantification des impacts doit être généralisé au secteur de la construction. Pour cela, les donneurs d’ouvrage et les autorités réglementaires doivent exiger l’intégration des résultats de l’ACV dans les projets de construction neuve et de rénovation pour évaluer les impacts environnementaux globaux. Pour faciliter ce déploiement, il est nécessaire de développer des outils et des guides pour faciliter l’utilisation de l’ACV par les professionnels du secteur.
Dans cet esprit, la collaboration entre les chercheurs, les donneurs d’ouvrage et les concepteurs doit être encouragée. Cette collaboration doit viser le partage des connaissances et les meilleures pratiques en matière d’ACV circulaires pour tendre vers une démocratisation de l’utilisation de l’ACV comme outil d’aide à la décision et ainsi éviter le déplacement d’impacts dans les décisions de conception ou de rénovation.
5.3.5 Officialiser des objectifs de réduction du carbone intrinsèque
Les ACV démontrent qu’une part importante de l’impact environnemental des bâtiments au Québec est liée aux matériaux de construction. Deux mesures sont essentielles pour réduire l’impact carbone des bâtiments tout au long de leur cycle de vie :
- fixer des objectifs clairs de réduction du carbone intrinsèque des bâtiments dans les réglementations municipales, provinciales et fédérales et dans les codes de construction, et
- encourager les donneurs d’ouvrage à adopter des matériaux et des techniques de construction à faible teneur en carbone.
Lire la suite : 5.4 Soutenir la déconstruction et le réemploi des matériaux
- CIRPASS Project. (n.d.). Accueil. https://cirpassproject.eu/ ↵
Ensemble des étapes de la vie d'un produit, d'un procédé ou d'un service.
La capacité de suivre et de tracer l'historique, l'emplacement, l'application et le mouvement des matériaux, des produits ou des systèmes, du point d'origine au point de consommation ou d'élimination, tout en fournissant des informations détaillées sur les processus de transformation, les intermédiaires et les acteurs impliqués à chaque étape de la chaîne de valeur.
Capacité que possèdent des systèmes de données hétérogènes à fonctionner conjointement, grâce à l'utilisation de langages et de protocoles communs, et à donner accès à leurs ressources de façon réciproque.
Fiche produit numérique et dynamique qui fournira des informations sur l'origine, la composition, les options de réparation et de démontage d'un produit ainsi que la manière dont les différents composants peuvent être recyclés. Le passeport numérique des produits (DPP) est une exigence du règlement européen sur l’écoconception pour des produits plus durables - (ESPR). dont l’entrée en vigueur est prévue de façon progressive à compter de 2027.
Mesure de la quantité de ressources provenant de matières circulant en boucle dans un système économique défini, pour une période donnée, par rapport à la quantité totale de ressources utilisées dans ce système, pendant cette même période.
Processus de planification, d'implantation, de suivi et de contrôle qui vise à maximiser la création de valeur et la réduction ou l'optimisation de l'utilisation des ressources. Cela peut passer par l'emploi de procédés adéquats de traitement des flux au moyen d'une gestion efficiente des matières premières et de leur transport, des encours de production, des produits finis et de l'information pertinente, sur l'ensemble de la chaîne de valeur.
Opération par laquelle on utilise une matière résiduelle ou un bien de consommation de nouveau, sans en modifier les propriétés.
Opération qui consiste à donner une utilité à des matières résiduelles, à des coproduits ou à des sous-produits, ou à en augmenter la valeur. La valorisation énergétique consiste à leur faire subir un traitement thermique ou chimique et à récupérer l’énergie ainsi produite.
Démarche individuelle ou collective qui vise une consommation modeste en ressources, dans le but de réduire les besoins en ressources d'une collectivité ou, plus généralement, de limiter l'incidence des activités humaines sur l'environnement.
Ressources ou matières premières directement issues des ressources naturelles.
Le fait de transférer des impacts environnementaux d'une étape du cycle de vie à l'autre ou d'un critère d'impact à l'autre.
Analyse du cycle de vie : analyse visant à déterminer et à mesurer les impacts environnementaux, les conséquences sociales ou les coûts d'un produit ou d'un procédé tout au long de son cycle de vie.
Le fait de transférer des impacts environnementaux d'une étape du cycle de vie à l'autre ou d'un critère d'impact à l'autre.