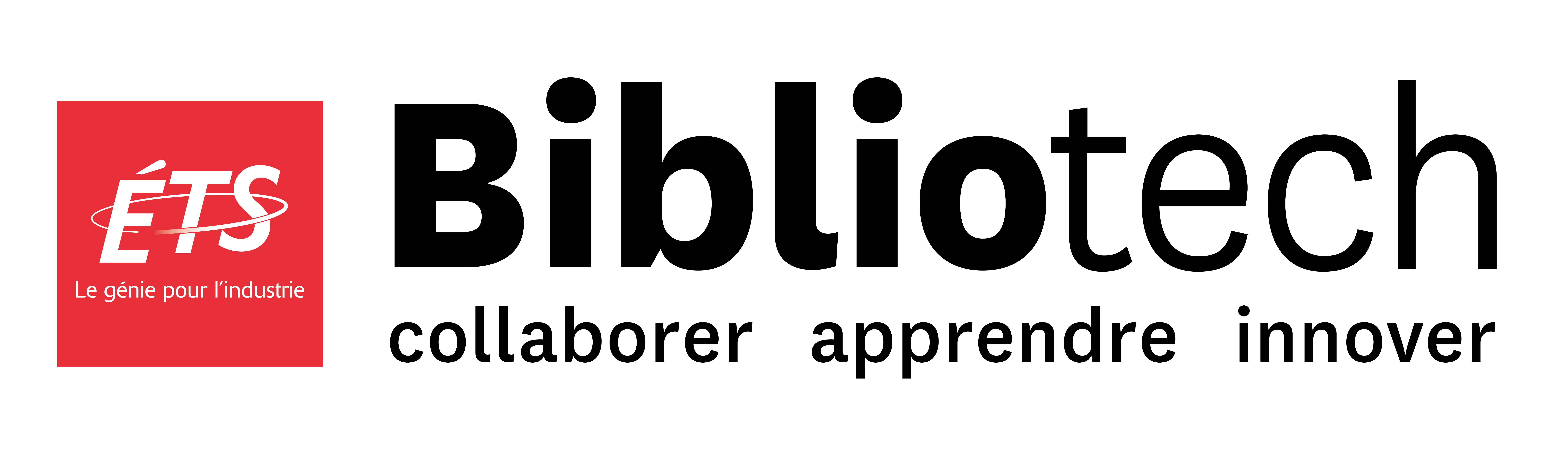3.4 Donner une nouvelle vie aux matières
3.4.1 Tri à la source sur chantier (Écotri)
La Municipalité régionale de comté (MRC) Brome-Missisquoi, comme beaucoup d’autres instances municipales au Québec, est confrontée à un défi majeur : l’absence de ressources dédiées au tri ou à la récupération des résidus de CRD, ce qui conduit à l’enfouissement direct de ces résidus. Cette situation alarmante est en contradiction avec les objectifs de valorisation fixés par la Politique québécoise de gestion des matières résiduelles. Face à ces enjeux, Transport Désourdy a initié un projet pilote de tri à la source des résidus de CRD sur chantier dans l’optique de maximiser le réemploi et la valorisation des matériaux triés, accompagné par une équipe de recherche d’HEC (Emmanuel Raufflet, prof., et Marie-Dominique Côté, étudiante.)
De manière plus concrète, ce projet a quatre objectifs :
- proposer des formations, des outils et des équipements pertinents et adaptés aux travailleurs sur chantiers,
- évaluer l’efficacité des mesures de tri et du potentiel réemploi,
- documenter la faisabilité de collecte sélective municipale sur les chantiers, et
- formuler des recommandations quant à la sensibilisation et à la formation des employés de chantier, le choix des équipements et des procédures de tri.
Pour y parvenir, l’impact des initiatives d’encadrement sur l’adhésion des travailleurs et la qualité du tri effectué a été analysé sur différents types de chantiers du territoire de la ville de Bromont. Cette analyse a été documentée et permet aujourd’hui d’envisager la faisabilité et la rentabilité environnementale de l’initiative et plus particulièrement la reproductibilité du modèle à d’autres municipalités et régions.
Le succès du projet repose notamment sur la participation engagée des travailleurs et le soutien des partenaires du recyclage, de même que sur des leviers opérationnels mis en place par Transport Désourdy. Parmi ces leviers, il apparaît essentiel de fournir aux travailleurs la formation, les outils et les équipements adaptés afin de pouvoir observer de réels changements de comportement et les accompagner en ce sens. Plusieurs équipements ont ainsi été conçus spécifiquement afin d’être utilisés sur les chantiers, comme des conteneurs compartimentés en trois sections et des bacs de tri mobiles ayant des capacités et destinations différentes (déchets compostables, déchets domestiques dangereux, etc.), tel que montrés à la figure 23.

Ces équipements ont permis de faciliter le tri des matériaux de façon sécurisée et adaptée aux contraintes réelles des chantiers. Afin d’assurer une bonne adhésion au projet, des séances de formation ont également été organisées pour expliquer les nouvelles procédures, répondre aux questions et établir un lien de confiance avec les travailleurs. Une ligne téléphonique de soutien a également été mise en place pour soutenir le personnel de chantier.
Les résultats obtenus témoignent de l’efficacité du projet :
- 14 entreprises réparties à travers 29 chantiers ont participé, ce qui a permis de réduire significativement la contamination des matériaux grâce au tri à la source.
- Les procédures mises en place se sont traduites en une diminution de 75 % des résidus CRD envoyés à l’enfouissement et,
- dans le cas des chantiers de constructions neuves, cette réduction s’est élevée jusqu’à 80 %.
- L’initiative a aussi permis de réduire de 24 % les émissions de gaz à effet de serre.
Afin de pérenniser le service de tri à la source chez Transport Désourdy, le projet a souligné plusieurs perspectives de développement futures, notamment le développement d’une filière de recyclage du gypse en collaboration avec CertainTeed Canada et d’un guide méthodologique pouvant être généralisé à l’ensemble des territoires du Québec. L’objectif de ces perspectives est de reproduire le succès du projet à plus grande échelle.
Consulter le projet et les livrables via : https://constructioncirculaire.com/projet/tri-a-la-source-sur-chantier-ecotri/
3.4.2 Démantèlement des portes et fenêtres en vue du recyclage
Mathias Glaus (prof.), Maël Lahmar et Domitille Belz (étudiants) de l’ÉTS et Synergie Économique Laurentides ont collaboré avec Recyclage Boreaxe et Interaction au travail afin de tester la mise en place de plateformes de démantèlement des portes et fenêtres issues de la déconstruction.
L’initiative a mobilisé des acteurs locaux tout au long de la chaîne de valeur pour développer une démarche de valorisation des produits en fin de vie. En effet, certaines portes et fenêtres issues de la déconstruction ne correspondant pas aux exigences de la filière réemploi. En démantelant et séparant les différents éléments les composant (verre, bois, PVC, métal…), ceux-ci peuvent alors intégrer des filières de recyclage, ce qui permet de réduire les résidus envoyés à l’enfouissement.
À cette fin, le projet a trois objectifs :
- caractériser des scénarios possibles pour chaque territoire à l’étude,
- documenter les étapes de déploiement des plateformes et évaluer leur performance opérationnelle, et
- diffuser des apprentissages auprès des parties prenantes concernées à travers une revue critique des cas d’étude.
L’équipe de recherche a documenté le processus de démantèlement afin d’évaluer la faisabilité technique et économique de cette filière de circularisation des matériaux (voir figure 24).

L’expérience des travailleurs en déconstruction pour améliorer l’efficacité des processus et la collecte en écocentre fournissant un grand nombre d’échantillons pour le démantèlement ont été essentielles dans la réalisation du projet.
Pour les deux sites pilotes testés, chez Recyclage Boreaxe et Interaction au travail dans les Laurentides, plus de mille unités ont été démantelées, ce qui a permis de réduire de 85 % les matériaux enfouis en plus de pouvoir développer un outil de suivi de la quantité démantelée.
Plusieurs freins ont toutefois été rencontrés durant la réalisation du projet, notamment le faible prix des matières récupérées, la complexité de la séparation des matériaux et le besoin de massification des gisements pour optimiser les coûts de transport. Bien que les résultats du projet aient permis de démontrer la faisabilité technique du démantèlement des portes et fenêtres, l’opération n’est pas rentable dans sa forme actuelle. La mise en place d’une filière dépend de conditions logistiques, normatives et financières et du contexte local de recyclage. Par ailleurs, les défis en termes de démantèlement restent nombreux, notamment le fait que la plus-value effectuée grâce à la revente des matériaux demeure trop faible pour compenser les coûts d’opération de la plateforme. Pour cette raison, il sera nécessaire de trouver un équilibre entre les critères opérationnels suivants : précision du démantèlement, conditions minimales pour le recyclage et rapidité d’exécution.
Pour implanter efficacement ce genre de filière, il sera impératif à l’avenir d’améliorer la rentabilité en réduisant les coûts d’opération ou en augmentant le prix de reprise, d’explorer les gisements postproduction auprès des fabricants de portes et fenêtres et d’évaluer les cadres réglementaires favorisant l’exploitation des gisements.
Consulter le projet et les livrables via : https://constructioncirculaire.com/projet/demantelement-des-portes-et-fenetres-en-vue-du-recyclage/
3.4.3 Rénovation de bâtiments administratifs et valorisation des matériaux
La direction de la Gestion des immeubles d’Hydro-Québec est engagée dans la réfection de plusieurs de ses bâtiments administratifs, y compris une rénovation majeure de l’intérieur de son siège social. Cette dernière s’inscrit dans une démarche réflexive sur les processus de revalorisation et d’optimisation des matériaux au sein de l’entreprise et représente une opportunité de mettre en œuvre une démarche de réemploi des matériaux générés par les travaux afin de réduire les émissions de GES et le recours aux ressources nouvelles.
Le projet de recherche, porté par Hydro-Québec avec Emmanuel Raufflet (prof.) et Augustin Fanier (étudiant) d’HEC, et Mathias Glaus (prof.) de l’ÉTS, a trois objectifs majeurs :
- documenter un processus de mise en œuvre du réemploi dans les projets de rénovation d’immeubles de bureaux et identifier les obstacles et facteurs de réussite,
- développer un outil pour recenser les flux de matières dans un projet de rénovation pour permettre de dresser un bilan prétravaux des matériaux générés et de cibler les mesures de réemploi/revalorisation, et
- mesurer les pourcentages de réemploi, de recyclage et autres taux pertinents pour les rapports de gestion des matières résiduelles.
Pour atteindre ces objectifs, un processus de mise en œuvre du réemploi dans la rénovation de trois immeubles de bureaux d’Hydro-Québec, dont son siège social, a été proposé.
Ce processus comprend quatre étapes :
- l’inventaire prédéconstruction,
- la conception,
- les travaux, et
- les bilans.
Plusieurs obstacles au réemploi des matières ont été mis en évidence lors de la phase d’inventaire tels que : le trop grand investissement de temps pour compléter la collecte des données sur les gisements, l’incertitude des premiers inventaires et le manque d’outils adéquats. Aussi, lors des phases de travaux et bilans, il est apparu que la logistique de mise en œuvre des mesures prévues, la coordination avec les repreneurs et le suivi des futurs usages des matières résiduelles représentent des enjeux majeurs.
Au cours du projet, les inventaires et l’évaluation des flux de matières des trois immeubles de bureaux ont permis d’identifier la laine isolante, le gypse et les carreaux acoustiques de plafond comme matériaux critiques.
Le projet a donc visé à mettre en évidence les opportunités et barrières liées au réemploi ou au recyclage de ces trois matériaux.
- Le réemploi du gypse n’est pas envisageable en raison de sa fragilité et de sa faible valeur économique, bien que des pistes d’écoconception des produits en gypse puissent être envisagées et développées par les fournisseurs de matériaux pour faciliter leur réemploi en fin de vie utile.
- Pour les carreaux acoustiques, le recyclage reste la solution la plus avantageuse économiquement dans le contexte québécois, des solutions techniques de valorisation étant par ailleurs disponibles en France par exemple.
- Quant à la laine de verre, son réemploi est limité par le manque de marché et de données sur le maintien de ses performances acoustiques.
L’équipe du projet recommande d’ailleurs d’expérimenter le réemploi interne des tuiles de plafond et de la laine de verre dans un bâtiment d’Hydro-Québec afin de pouvoir valider empiriquement les propositions formulées dans ce projet de recherche. Aussi, il serait possible de prioriser le réemploi externe des carreaux acoustiques de plafond, notamment grâce à des plateformes de dons ou de revente de seconde main. D’autre part, il est recommandé que les recycleurs incitent et encouragent au recyclage du gypse en s’inspirant notamment du modèle français. Le gypse apparaît en effet être le matériau le plus problématique en ce qui concerne le réemploi.
En conclusion, cette étude a souligné l’importance fondamentale de quantifier les flux de matières résiduelles sur les chantiers afin de guider les initiatives de réemploi ou de recyclage à mettre en œuvre. Elle a également mis en évidence que les coûts d’enfouissement trop faibles contribuent à retarder l’émergence et la mise en place de nouvelles solutions de valorisation.
Consulter le projet et les livrables via : https://constructioncirculaire.com/ressource/analyse-du-processus-de-valorisation-des-materiaux-et-recommandations-doptimisation/
3.4.4 Valorisation des bardeaux d’asphalte post-consommation (BAPC)
Le projet, mené par Jean-Claude Carret (prof.), Alan Carter (prof.), Michel Vaillancourt (prof.) du Laboratoire sur les Chaussées et Matériaux Bitumineux (LCMB) basé à l’ÉTS et de leurs étudiants, se penche sur la valorisation du bardeau d’asphalte postconsommation (BAPC) dans des matériaux de chaussées non revêtues. Il a été appuyé par la Régie Intermunicipale de Traitement des Matières Résiduelles de la Gaspésie (RITMRG) et le Groupe Bauval.
Le bardeau d’asphalte postconsommation est un matériau issu de la démolition ou de la réhabilitation des toitures des bâtiments. Environ 250 000 tonnes de BAPC sont produites annuellement au Québec. Bien que selon la réglementation du Ministère des transports et de la mobilité durable (MTMD) le BAPC puisse être utilisé à hauteur de 5 % de masse dans certains enrobés bitumineux, sa valorisation demeure peu courante au Québec et est actuellement limitée à la valorisation énergétique comme combustible alternatif pour des cimenteries. De ce fait, l’enfouissement du BAPC demeure toujours prévalent de nos jours (voir Figure 25[1]).
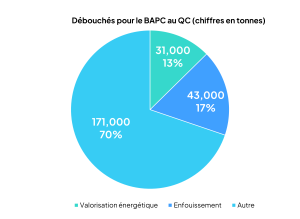
L’objectif du projet est de réutiliser le BAPC comme matériau de recouvrement pour les chaussées non revêtues ou endommagées dans l’optique de contribuer à réduire les défauts de surface et à améliorer la sécurité et le confort des usagers de la route. Pour ce faire, ce projet vise à développer un matériau de microsurfaçage à partir de BAPC reconditionnés. La RITMRG dispose d’un gisement important de bardeaux d’asphalte majoritairement envoyé à l’enfouissement. C’est elle qui a donc pu fournir du BAPC broyé à l’équipe de recherche pour soutenir l’expérimentation du projet.
Dans une perspective de répondre aux enjeux environnementaux et de transition circulaire du secteur, le projet a d’abord visé à développer un enrobé avec une formulation à froid afin de réduire les émissions de gaz à effet de serre liées à la consommation énergétique de production du matériau. Cependant, des difficultés sont survenues lors de la formulation d’un matériau à froid, notamment en raison de problèmes liés à l’émulsion de bitume. Aussi, l’industrie des travaux routiers a montré peu d’intérêt pour les matériaux formulés à froid et pour l’utilisation du BAPC. Cela a donc remis en question la pertinence d’une formulation à froid.
Des essais de formulation standard (à chaud) ont par la suite été réalisés en laboratoire pour développer un enrobé performant. Afin que cet enrobé puisse être applicable à la réalité terrain, il a été nécessaire de tester s’il était faisable de le produire à l’échelle industrielle. Cette étape a été rendue possible grâce à la participation de l’entreprise Bauval, qui a permis la réalisation de mélanges à chaud en centrale d’enrobés.
Les constats issus du projet ont souligné que la valorisation du BAPC dans les chaussées est techniquement possible. Elle est toutefois entravée par des obstacles réglementaires et économiques, notamment le manque d’intérêt des entreprises de travaux routiers pour la formulation à froid. Les résultats obtenus ont montré que l’incorporation de BAPC dans les enrobés est réalisable et ses teneurs peuvent atteindre jusqu’à 10 % dans le cas de la formulation d’un enrobé à chaud, la limite d’incorporation de BAPC des technologies actuelles des centrales étant de 10 à 15 %. De plus, l’utilisation de BAPC a un impact positif direct sur l’environnement, car il permet de réduire la quantité de bitume neuf nécessaire.
Des essais en conditions réelles ont permis de valider ces résultats, ce qui laisse penser qu’il serait possible d’appliquer cette approche à grande échelle. Pour l’avenir, il est recommandé de créer un groupe de travail réunissant tous les acteurs de la chaîne de valeur du BAPC, d’approfondir les études en laboratoire et de proposer des modifications réglementaires pour favoriser une meilleure structuration de cette filière circulaire.
Cette structuration pourrait ainsi faciliter l’intégration systématique de BAPC dans les enrobés, à hauteur de 3 à 5 %, tel qu’il est autorisé dans la réglementation du MTMD. Cela permettrait de valoriser l’intégralité du BAPC généré chaque année, tout en réalisant des économies de bitume significatives d’environ 10 000 tonnes, équivalentes à environ 2-3 % de la consommation annuelle au Québec.
Consulter le projet et les livrables via : https://constructioncirculaire.com/projet/valorisation-des-bardeaux-dasphalte-post-consommation-bapc/
3.4.5 Intégration des granulats bitumineux recyclés (GBR) dans les travaux routiers
Le projet de recherche s’est intéressé à la valorisation des Granulats Bitumineux Recyclés (GBR), lesquels sont les déchets produits par le planage des couches d’enrobés bitumineux dans les travaux routiers municipaux. Il a été mené par Éric Lachance-Tremblay (prof.), Diego Ramirez Cardona (prof.), et Michel Vaillancourt (prof.) de l’ÉTS, en partenariat avec la municipalité de Saint-Hippolyte. Le projet a pour but de généraliser et standardiser l’utilisation des GBR dans les travaux routiers municipaux au Québec, à hauteur de plus de 20 %. En effet, l’utilisation des GBR dans la production d’enrobés bitumineux neufs permettrait de réduire la production de déchets et les émissions de gaz à effet de serre, impliquant ainsi deux bénéfices environnementaux notables. Cependant, au Québec, cette pratique demeure variable et elle est souvent entravée par le manque de référentiel adapté au contexte local.
Le projet a ainsi deux objectifs principaux :
- assister la municipalité de Saint-Hippolyte dans la vérification et la validation technique des matériaux, et dans l’intégration d’au moins 30 % de GBR dans le cadre d’un projet routier pilote, et
- réaliser une étude de caractérisation des performances mécaniques des enrobés bitumeux à fort dosage en GBR.
Pour cela, un recueil historique des usages et une étude comparative des pratiques au Québec en matière d’utilisation des GBR ont été réalisés. Le recueil illustre les évolutions dans la réglementation concernant le taux de GBR permis dans les enrobés bitumineux. Une diminution progressive s’est faite à partir de 2009, avec un maximum de 15 % de GBR autorisé pour certains cas d’usage, alors que le taux permis en 1986 était de l’ordre de 60 %. Aussi, le projet a mis en évidence des disparités entre les villes québécoises : alors que certaines sont restrictives, d’autres le sont moins, comme c’est le cas de Montréal. De même, certaines villes et certains états frontaliers étasuniens qui ont des contextes climatiques similaires à celui du Québec sont plus progressistes sur les taux autorisés. Cette analyse a ainsi permis de mettre de l’avant la présence de lacunes existantes, et les opportunités de développement qui en découlent.
La complémentarité des analyses en laboratoires et de la mise en œuvre sur le terrain a permis d’apporter une compréhension complète sur les performances mécaniques des enrobés à fort taux de GBR, cela plus particulièrement sur la résistance à l’orniérage, la résistance à la fissuration thermique et la tenue à l’eau. D’un point de vue opérationnel entre la municipalité et l’entrepreneur, l’approche s’est basée la définition précise des spécifications des exigences selon une approche de type « performance », ainsi que sur une caractérisation rigoureuse à l’étape de la conception et lors de la réalisation des travaux (voir figure 26).

Toutefois, plusieurs freins ont été rencontrés tout au long du projet malgré les efforts déployés et la volonté initiale de rédiger un guide de référence dans l’usage des GBR pour les projets routiers municipaux au Québec. Parmi ces freins se trouvent notamment des lacunes qui ont été observées quant à la compréhension, l’interprétation des clauses et la prise en compte des spécificités du projet par l’entrepreneur, ce qui a souligné le besoin d’une approche davantage collaborative entre le donneur d’ouvrage et l’entrepreneur responsable des travaux, dès la phase d’appel d’offres.
D’un point de vue technique, les constats issus du projet mettent en évidence la nécessité d’une flexibilité dans la formulation des enrobés à base de GBR, ce qui implique d’avoir une marge de manœuvre face aux exigences de performances pour compenser la dégradation liée aux usages et aux conditions météorologiques. Par ailleurs, l’avancement dans la recherche requiert d’assurer l’imperméabilité et la résistance des enrobés face aux fissurations thermiques et à l’orniérage. La qualité a ainsi dû être vérifiée en deux étapes, l’une en laboratoire et l’autre sur le terrain, afin de réduire les écarts de performance.
Un autre constat est le manque de ressources temporelles des services techniques des villes pour pouvoir faire face aux exigences supplémentaires qui découlent de l’utilisation de nouveaux matériaux. Aussi, il y a un besoin urgent de sensibiliser le secteur de la construction québécois sur les avantages et défis liés à l’utilisation de matériaux recyclés. Une attention particulière doit également mettre l’emphase sur les pratiques communes des entrepreneurs de taille moyenne qui représentent la majorité des entrepreneurs au Québec. En effet, il a été constaté un manque d’analyse détaillée des projets auxquels les entrepreneurs répondent. Ces derniers ont tendance à fournir des devis d’appel d’offres standard sans tenir compte des particularités de chaque projet. Cette pratique est peut-être liée à la contrainte de rentabilité des entreprises et compromet la durabilité des initiatives de construction.
Afin de « démarginaliser » l’usage des GBR, il sera nécessaire à l’avenir de définir préalablement le rôle de chaque partie prenante, en particulier dans le cadre de projets pilotes, et de favoriser leur proactivité. Une collaboration accrue entre les donneurs d’ouvrage et les entrepreneurs favoriserait le déploiement des enrobés contenant un fort taux de GBR. De même qu’il convient de s’écarter des modèles conventionnels d’appels d’offres, en intégrant dans ces derniers une approche basée sur la performance des matériaux souhaitée plutôt que prescriptive. Enfin, il apparaît nécessaire qu’il y ait un changement de mentalité de la filière de construction routière, en quittant l’objectif ultime de la rentabilité absolue par des projets à la chaîne. Pour y parvenir, une sensibilité à l’économie circulaire et à la collaboration pourra être assurée par le partage et l’émergence de projets pilotes, qui permettront d’augmenter la connaissance et la compréhension des bénéfices de l’utilisation des GBR.
Consulter le projet et les livrables via : https://constructioncirculaire.com/projet/integration-des-granulats-bitumineux-recycles-gbr-dans-les-travaux-routiers/
Lire la suite : 3.5 Projets transversaux
- RECYC-QUÉBEC. (2020). Étude sur la mise en marché et la gestion de fin de vie des revêtements de toitures. https://www.recyc-quebec.gouv.qc.ca/sites/default/files/documents/etude-revetements-toitures-2020.pdf ↵
Construction, Rénovation, Démolition. Par extension, le sigle CRD désigne les matières résiduelles issues des activités de Construction, Rénovation, Démolition.
Dépôt définitif de matières résiduelles sur ou dans le sol.
Résidus, substances ou objets qui sont abandonnés ou destinés à l'abandon, et qui sont susceptibles d'être valorisés.
Ensemble des activités d’une industrie, qui se succèdent et permettent à un produit ou à un service d’intégrer un marché.
Démantèlement sélectif d'un bâtiment ou d'un ouvrage, effectué de manière à récupérer certains de ses éléments constitutifs en vue de leur remploi ou de leur recyclage.
Opération qui rassemble les matières résiduelles par flux, de façon à constituer des quantités significatives avant qu’elles soient envoyées en filières spécifiques de traitement.
Conception de matériaux, de bâtiments, quartiers ou procédés caractérisée par le souci de réduire ou de prévenir les impacts environnementaux tout au long de leur cycle de vie.
Bardeau d’asphalte postconsommation.
Toute route (ou chemin) dont la surface est faite de terre, d'argile, de gravier ou de sable.
Le micro-surfaçage est composé d’émulsions de bitume modifiées aux polymères mélangées à des granulats concassés bien calibrés, des charges minérales, de l’eau et des adjuvants.
Granulats Bitumineux Recyclés.
Le donneur d'ouvrage est la personne qui engage l'entrepreneur pour des travaux de conception, construction, rénovation, démolition ou déconstruction.