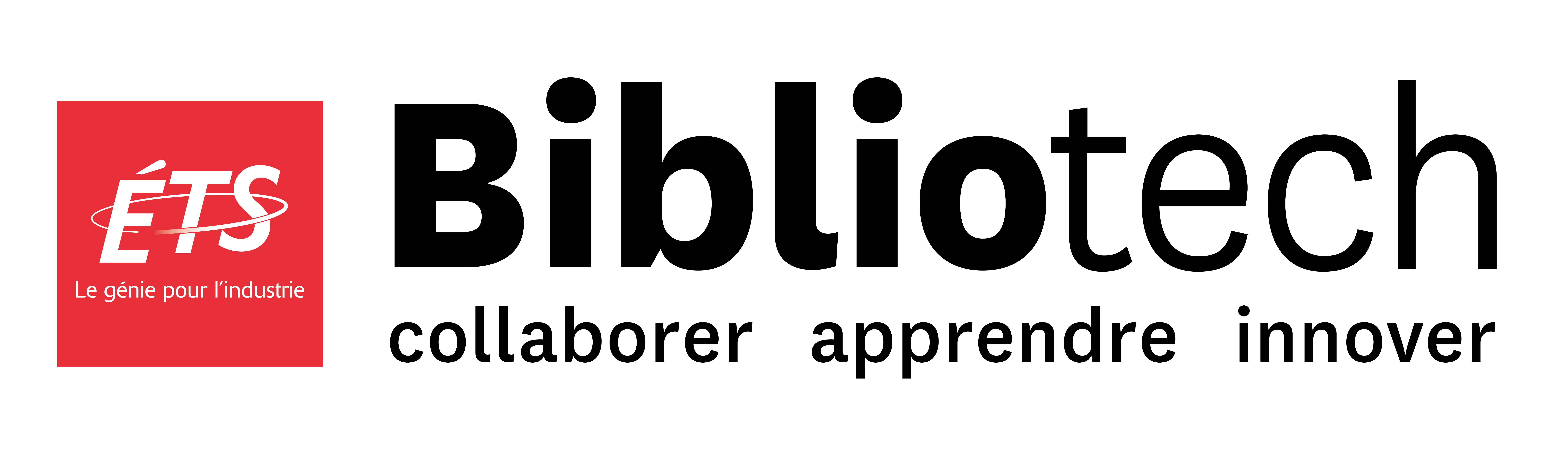3.2 Intensifier l’usage des équipements et des bâtiments
3.2.1 Bénéfices de l’économie de fonctionnalité
Le projet de recherche mené par Marc Journeault (prof.), Chloé Steux (étudiante) et Rim Khlifa (professionnelle de recherche) de l’Université Laval et Annie Levasseur, Danielle Monfet (profs.) et leurs étudiants de l’École de technologie supérieure, en partenariat avec Énergir et le Consortium EFC, s’est concentré sur les bénéfices économiques et environnementaux de l’économie de fonctionnalité appliquée aux opérations énergétiques des bâtiments.
L’économie de fonctionnalité est un modèle économique reposant sur la vente de la mise à disposition d’un bien matériel ou d’un service plutôt que sur la vente du bien ou du service lui-même, notamment dans le but d’éviter la surconsommation de ressources et de favoriser la production de biens durables et réparables.
Le présent projet s’intéresse ainsi à la mise en place d’une économie de la fonctionnalité dans les opérations énergétiques de deux bâtiments, l’un de la Ville de Montréal, l’autre de l’ÉTS, en tentant de démontrer les bénéfices économiques et environnementaux éventuels liés à la consommation énergétique d’un bâtiment. Concrètement, il s’agit d’analyser deux scénarios possibles (voir figure 18):
- le premier scénario de l’économie linéaire où le gestionnaire du bâtiment est propriétaire de l’installation de production énergétique (réseau « bâtiment »), et
- le second de l’économie circulaire où le gestionnaire achète le service de livraison de chaleur auprès d’un prestataire tierce(réseau urbain), ici Énergir.
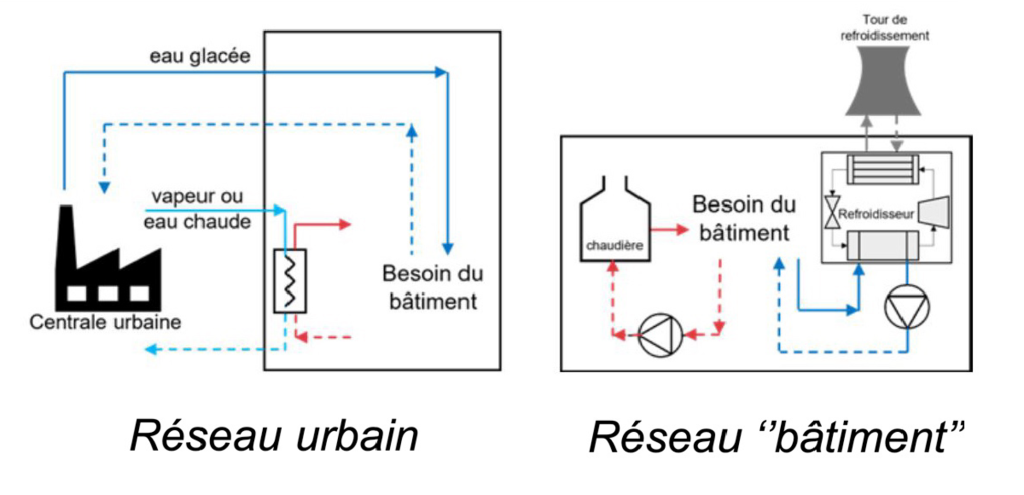
Pour être mené à bien, ce projet s’est appuyé sur des données de l’ÉTS et d’Énergir, ainsi que sur l’utilisation de guides ASHRAE comme références pour la prédiction des consommations énergétiques. Aussi, cette initiative répond à un besoin crucial visant à limiter la surconsommation des ressources et à promouvoir des modèles d’affaires innovants et résilients. Dans cette perspective, le projet identifie plusieurs enjeux, notamment le peu de recherches sur les impacts économiques et environnementaux de l’économie de la fonctionnalité, ainsi que le faible développement de ce modèle d’affaires au Québec.
De nombreux avantages stratégiques, économiques et environnementaux de l’économie de la fonctionnalité ont été identifiés.
Parmi les avantages environnementaux, les éléments suivants reviennent régulièrement :
- la réduction de la consommation de gaz naturel pour le chauffage et d’électricité pour le refroidissement,
- la réduction des émissions de GES associées, et
- la réduction des risques environnementaux et sociaux.
Au point de vue économique, les avantages sont présents pour le client et le fournisseur de services puisque l’économie de fonctionnalité permet :
- la réduction des coûts associés aux infrastructures et à l’énergie,
- l’accroissement de la résilience et de la fiabilité,
- une meilleure collaboration entre les parties prenantes du projet,
- une accessibilité accrue des compétences, et
- des économies d’échelle (besoins de chauffage, refroidissement, nouvelles technologies, réseau de chaleur).
Le projet a permis d’offrir une vision plus précise des impacts environnementaux liés au chauffage et à la climatisation, de même qu’une grille d’analyse des bénéfices de la mise en œuvre de l’économie de fonctionnalité. Aussi, en se concentrant sur les avantages environnementaux et économiques de l’économie de fonctionnalité dans le contexte du chauffage et du refroidissement des bâtiments, l’étude souligne la nécessité d’élargir les recherches futures pour inclure les impacts sociaux de même que la nécessité d’explorer le potentiel de l’économie de fonctionnalité dans d’autres usages opérationnels des bâtiments (ascenseurs, sécurité, recouvrement de plancher, éclairage, etc.). Conjointement à cela, l’équipe de projet souligne la nécessité de clarifier la définition de l’économie de la fonctionnalité pour faciliter son application et recommande d’analyser les impacts environnementaux des infrastructures pour poursuivre le développement et la mise en œuvre de ce modèle prometteur.
Consulter le projet et les livrables via : https://constructioncirculaire.com/projet/benefices-de-leconomie-de-fonctionnalite/
Lire la suite : 3.3 Prolonger la durée de vie des bâtiments et des matériaux
Modèle économique reposant sur la vente de la mise à disposition d’un bien matériel ou d’un service plutôt que sur la vente du bien ou du service lui-même, notamment dans le but d’éviter la surconsommation de ressources et de favoriser la production de biens durables et réparables.
Système de production, d'échange et de consommation où les ressources sont extraites puis utilisées pour fabriquer des produits qui seront ensuite livrés, consommés puis jetés, sans prise en compte de la capacité de support des écosystèmes.